
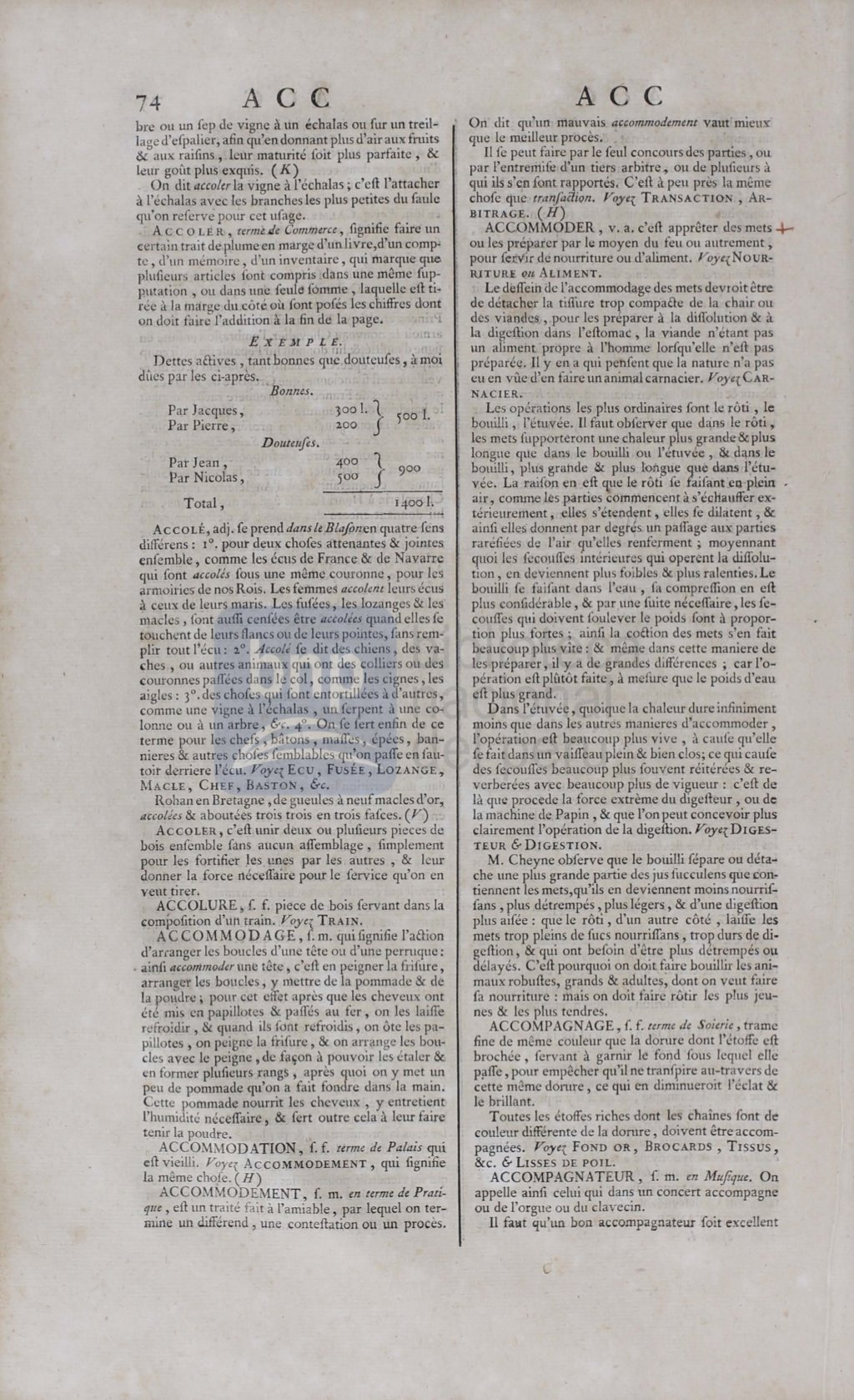
74
ACC
bre ou un fep de vigne
a
un échalas ou fur un treil–
lage d'efpalier, afin qu'en donnant plus d'airaux fruits
& aux raifms, leur maturité foit plus parfaite,
&
leur gOllt plus exquis.
(K)
On dit
aecoler
la vigne
a
l'échalas ; c'efi I'attacher
a
l'échalas avec les branchesles plus petites du faule
qu'on referve pOlU cet ufage.
A CCOLER ,
t1!rnú.-"~
Commerce,
fignifie faire un
certain trait de plume en marge d'unlivre,d'un comp'
te, d'un mémoirc , d'un inventaire, qui marque qu.e
plufieurs articles font compris dans une meme fup·
putation , ou dans une feulé fómme , laquelle eft ti·
I'ée
a
la marge du.cote olt font pofés les chiffres dont
on doít faire l'addítion
a
la fin de la page.
I
E
X EM
P
L E.
Dettes aél:ives , tantbonnes
qu~
douteufes ,
a
moi
dllcs par les ci.apres. .
Bonnes.
Par
J
acques ,
3°°1. } 5° 0
1.
Par Pierl'e,
200
Douteufis.
Par Jean ,
4°0
}
9°0
Par Nicolas ,
5°0
Total,
1400
1:
I
AccoLÉ, adj. fe
prenddansleBlaJimen
quatre fens
diJférens:
1°.
pOlU deux chofes attenantes & jointes
enfemble, comme les écus de France & de Navarre.
qui font
aecolés
fous une meme couronne, pour lcs
armoil'ieS'de nos Rois. Les femmes
aecolem
leurs écus
a
ceux de lelUs maris. Les fufées, les lozanges & les
macles, font auffi cenfées etre
aci:.oLies
quand elles fe
touchent de leuts flanes ou de leurs pointcs, fans remo
plir tout l'écu:
2°.
Aecol¿
fe dit des chiens, des va·
ches, ou autres animaux qui ont des colliers ou des
couronnes palfées dans le col, comme les cignes, les
aigles: 3
0.
des chofes 9ui (ont entortillées
a
d'autrcs,
comme une vigne
a
l'echalas , un
íi
rpent
a
une co·
lonne ou
a
un arbre,
&c.
4°. On (e (ert enlin de ce
terme pOlU' les chefs , batons , malles, épées, ban–
nieres & autres chofes (emblables qu'on paífe en
filU·
toit derriere l'écu.
Voye{
Ecu, FUSÉE, LOZANGE?
MACLE, CHEF, BASTON,
&c.
Rohan en Bl'etagne ,de gueules
a
neufmacles d'or,
accoUes
& aboutées trois troís en troís fa(ces.
(V)
ACCOLER, c'ea unir deux ou plufieurs pieces de
bois en(emble (ans aucun aífemblage, fimplement
pOlU' les fortiller les l!neS par les autres , & leur
donner la force rtéceíraire pour le fervice qu'on en
vent tirer.
ACCOLURE;
f.
f. piece de bois fervant dans la
wmÍ)ofition d'uh train.
Voye{
TRAIN.
ACCOMMODAGE,
f.
m. quiíignifie l'aéEon
d'arranger les boudes d'une tete ou d'une permque:
ainú
acconlmoder
une tete, c'e11: en peigner la fri(lue,
arranger les boudes, y mettre de la pommade & de
la poudre; pour cet elfet apres que les cheveux ont
éré mis en papillotes & paífés au fer, on les laiífe
refroidir , & quand ils [ont rerroidis, on ote les pa–
pillotes , on peigne la fri(ure ,
&
on arrange les bou·
eles avec le peigne ,de fason
a
pouvoir les étaler &
en former pluíieurs rangs, apres quoi on y met un
peu de pommade qu'on a fait fondre dans la main.
Cette pornmade nourrit les cheveux , y entretient
l'humidité néceífaire, & fert outre cela
a
leur faire
tenir la poudre.
ACCOMMODATION, f. f.
arme de Palais
qui
efivieilli.
Voye{
ACCOMMODEMENT, quí figniJie
la meme chofe.
(H)
ACCOMMODEMENT,
f.
m.
en arme de Pratí.
1
11•
e
,
ea
un.
tr~ité
fait
a
l'amiable, par lequel on ter–
mme ul1 clifferend , une conte11:ation ou un proceso
ACC
On dit qu'un mauvais
accommodemem
vaut miel1x
que le meilleur proceso
Il fe peut faire par le feul concours des parcies , ou
par l'entrBmife d'un tiers arbitre. ou de pluíicurs
a
qui ils s'ell font rapportés. C'efi
a
peu pres la meme
chofe que
tra'!failion. Voye{
TRANSACTION , AR–
BITRAGE.
(H)
ACCOMMODER,
V.
a. c'efi appreter des mets
+-–
oules préparer par le moyen du feu ou autrement )
pour fellvír de nourriture ou d'aliment.
Voye{
NOUR·
RJTURE.
on
AUMENT.
Le deffein de l'accommodage des mets devroit etre
de détacher la tiirme trop compaél:e de la chair ou
des víaocles , pour les préparer
a
la diífolution &
a
la
digeilion dans l'e11:omac, la viande n'étant pas
un alíment proprc
a
I'homme lorfqu'elle n'e11: pas
¡
préparée. Il y en a qui penfent que la nature n'a pas
euen vited'enfaireunanimalcarnacier. V""e{CAR–
NACIER.
Les opératíons les plus ordinaires font le roti , le
bouilli, l'étuvée. Il faut obferver que dans le roti ,
les mets (upporreront une chaleur plus grande
&
plus
longue qne dans le bouilli ou l'eUlvée,
&
dans le
bouilli, plus gmhde &: plus longue que daos l'étu–
vée. La raifon en ea que le roti fe faifant.cll plein
air, comme les partíes cómmencent
a
s'édlauffer ex·
térieurement. elles s'étendent, elles fe dilatent ,
&
ainfi elles donnent par degtés un paífage aux parties
raréllées de l'air <¡u'elles renfe;rment; moyennant
'luoi les fecoulfes Il1térieures qui operent la diífolu–
tion, en devíennent plus foibles & plus ralenties. Le
bouilli fe faifanr dans l'eau , fa compreffion en eft
plus con(¡dérable , & par une fuite nécelfaire, les fe–
cOllífes
c¡tlÍ
doivent foutever le poids font
a
propor–
tion plus forres; ainfi la coaíon des mets s'en fait
bcaucollp plus vlte: &
m~me
dans cette maniere de
les préparer,
il
Y a de grandes dífférences ; car
1'0-
pération efi pllnot faite,
a
mefure que le poíds d'eau
ea
plus grand.
Dans l'étuvée, quoique la chalelu dure infiniment
moins que dans les autres manieres d'accommoder ,
l'opération e11: beaucoup plus vive,
a
caufe qu'elle
fe faít dans un vailfeau pleín & bien dos; ce
~ui
cauCe
des fecouífes beancollp plus fouvent réitérees & re–
vcrberées avec beaucoup plus de
vi~ueur:
c'ea de
la
que procede la force extreme du digefteur , ou de
la machine de Papin , & que l'on pent concevoir plus
elairement l'opération de la digeilion.
Voye{DIGES–
TEUR
&
DIGESTION.
M. Cheyne obferve que le bouilli fépare ou
déta~
che une plus grande partíe des jus fucculens que con·
tiennent les mets,'lu'ils en deviennent moins nourrif–
fans, plus détrempés, plus légers , & d'une digeilion
plus auée : que le roti, d'un autre coté , laiíre
les
mets trop pleins de fucs nourriífans ,
tr0P
durs de di·
geaion, & qui ont befoin
d'~tre
plus detrempés Ol!
délayés. C'eft pour'luoi on doit faire bouillir les ani–
mauxrobuftes, grands & adLlltes, dont on vellt faire
fa nourriUlre : mais on doit faire rotir les plus jeu–
nes & les plus tendres.
ACCOMPAGNAGE, f. f.
tume de Soierie,
trame
fine de meme couleur que la dorure dont l'étoffe
ea
brochée, fervant
a
garnir le fond fous lequel elle
p¡¡ífe, pOlU empecher qu'il ne tran(pire au-travers de
cette
m~me
domre , ce 'lui en diminueroit l'édat &
le brillant.
Tontes les étolfes ¡-jches dont les chames font de
couleur différente de la domre, doivent etre accom·
pagnées.
Voye{
FOND OR, BROCARDS , TISSUS,
&c.
&
LISSES DE POIL.
ACCOMPAGNATEUR,
f.
m.
en Muju¡ue.
On
appelle
ainfi
celui qui dans 1m concert accompagne
ou de l'orgue ou dll clavecin.
Il
fa~t
qu'un bon accompagnateur foit excellent
















