
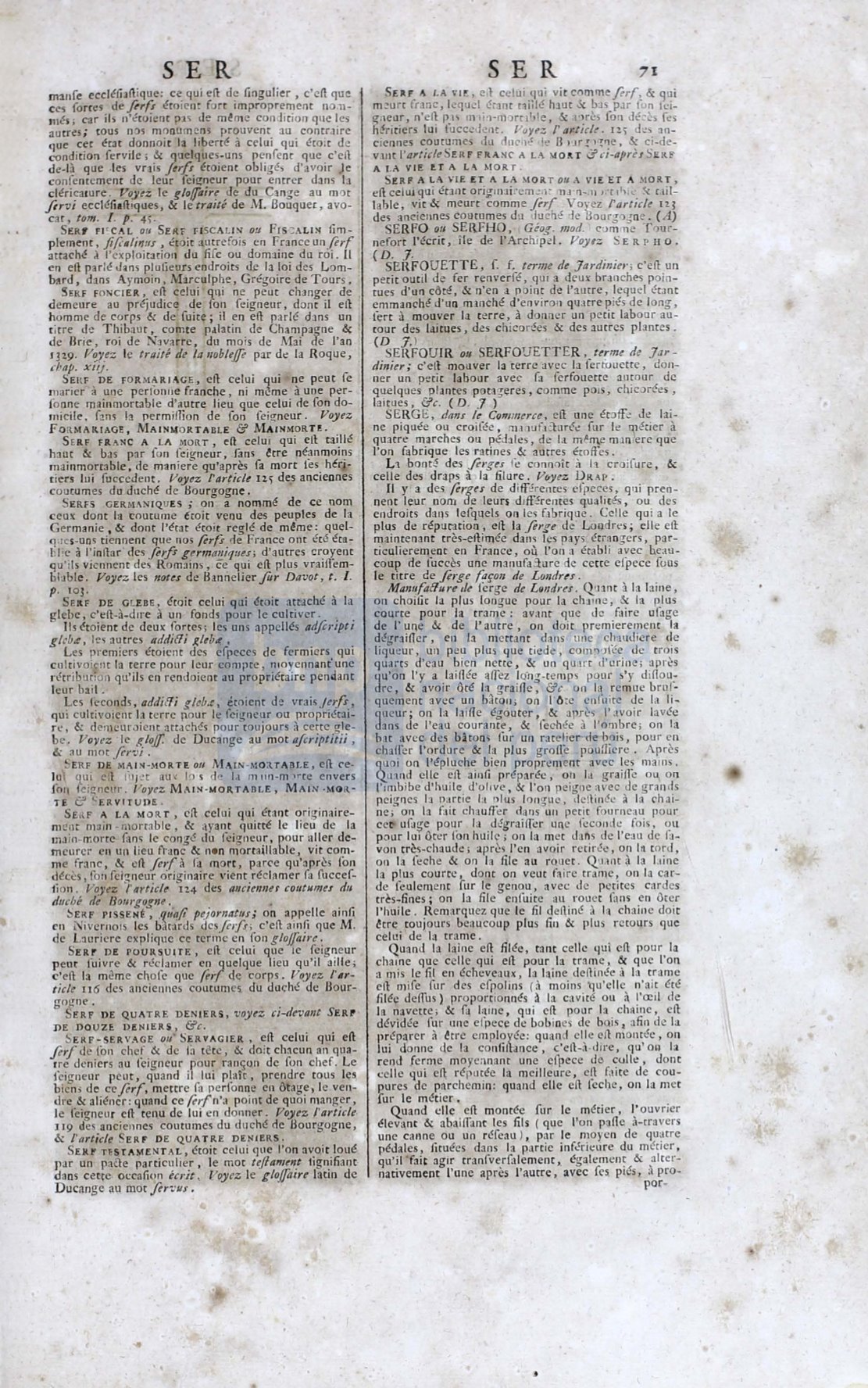
S E R
m~nfe eccl~liallique:
ce quí en de lingulier, c'c(i que
ces
(orces
de
flr{r
éroienr forc improprernenr non–
més;
car
il> n'écoienr
p1s
de
rn~me
condirion que les
aurres;
rous nos monurncns prouvenr au conrraire
que cer
ér~r
donnoi r la
libere~
ii
celui qui éroir de
condirion fervile;
&
9uelques-uns penfenr que c'eíl
de-la que .les vrais
Jerfi
éroienr obligé; d'avoir Je
confememenr de leur feigneur pour correr daos la
cléricarure.
Voytz
le
glol[aire
de du Canue au mor
firvi
eccléliaíltques,
&
le
traité
de
M.
Bo~quec ,
avo–
car,
tom.
l .
p.
4).
SERf FJ ' CAL
011
SEKF FISCALJN
otJ
PJS : ALI II
lim–
plemenr,
fifoaiÍ!JIIf
,
cétoir
;~.mrcfois
en France un
(erf
arcaché
;¡
l'exploicariOII du
tire
ou domaine du roi .
ll
en eíl parlé Jans pl ufieurs endroirs
<k
la loi des Lom–
bard, daos Aymoin, Marculphe , Grégoirc de Tours,
5ERF FONCJER '· efi celui qtli ne. peur changcr de
demeure au pré¡ud1ce de fon
fe1gneur, donr il ell
hornme de corps
&
de fuire;
il
en eíl parlé daos un
riere de Thibaur, comte palacio de Champagne
&
de llrie,
coide
1
avarre, du rnois de Mai de l'ao
JJ19·
f/~
y.ezle
traité de la
uoblejfe
par de: la Roque,
I'!Jnp.
XII).
SEI\F DE FORMARJAGE,
cfl
celui quí ne peur fe
marier
a
une perlonue fran<:he , ni mi!me
ii
uoe per–
foone rnainmorrable
~·a,urre
lieu que celui ele fon do–
HilCtle .
r~ns
la perrndlJOn de fon
feigneur.
Voyez
FoRMAilJAG!, MArNMORTABLE
&
MAJNMORT!.
SE&F FRANC A LA MOR.T, efi celu1 qui Cll raillé
haur
&
bas par fon feigneur, fans
~rre
né:mmoins
mainrnorrable , ele maniere gu'apres fa more les hér'–
riers luí fucccdent.
Voy•z l'articü
Il)
des anciennes
courumes du duché de 6ourgogne.
SERFS
GER~L~N IQUES
; On a nommé de ce nom
ceux done la courume t'roir venu des peuples de la
Germanie,
&
done l'érar écoir reglé de
m~rne :
quel–
'l·•<s-un< riennent que nos
forfi
de France onr érá écn–
l.l!e
a
l'infiar ' des
fl,j'r
gemumÍr¡tJU;
d'autres croyenr
q u' ils vicnnenr des Romains , ce qui en plus vraiflem–
bliible.
Voy~:r,
les
/lOtes
de
6annelier
for
Dnvat,
t. l .
p.
l OJ .
SEII.F DE GLI!BE, étoír celui quí ároit atiO'aché
a
la
glebc' c'en-a-dn·e
a
un fonds pour le culriver.
lis écoient de deux fortes; les uns appellés
ndfiripti
glcb<!!,
le< aucres
tldt(iEli ¡¡leb4 ,
Les premiers écoienr des efpeces de ferrniers quí
culrivoi nr la rerre pour leur compre, ntoyennanr' une
rérriburio n qu'ils en rendoienr au propriéraire pendanr
leur bail .
·
Les feconds,
addi{li
gtcb~t,
t,\roienr de
vrais.Jerft ,
qu; culcivoienr la cerre [lOUr le fcigneur ou propriérai–
r e.
&
demelli'Jienr arcachés pour coujours
a
cerrc ale–
be .
V oyez
le
g toff.
de Ducange au mor
afiriptitii ,
&
a
u mor
.fcr':JÍ
.
~ERF
DE MAJN-MORl'l'.
o11
MA,rN-MORTADT-E, eíl ce–
lul qui e,}
l'u¡~r
au< lo s de la m un-m >rce envers
fot
fergncur.
Voyez
MAJN -MORTABLE, MAIN·MGR. –
TE
f:J'
" ERVITUI>E .
SE.¡
F
A
LA J>IO RT,
cfl
celui qui écanc originaire–
menr
main - morrable,
&
~yan~
quieté le lieu de
la
maín-morre fans le congé du fei gneur, pour aller-
de~
meurcr
<m
uu lieu fl'anc
&
n• n 0'10rtaillable, vir com–
me franc ,
&
efi
Jáfa
fa
0'10rt, paree qu'apres fon
déces ' ro n felgneur o'ríginaire vient réclamer fa fuccef–
lion .
Voyez
l'articl~
124
des
mscienner
coutumu
du
du.·!Jé dé Borsrgog11e
.
.
SERF PISSJ;l\É;
.~ría(l p~jornatJu;
on appelle ainli,
en t 'ivernors les bacards des
(crft ;
c'eíl ainfi que
M.
de Lauríere explique ce ternic en fon
glojfoire.
5ERP' DI! POUR,S,U\TE, eíl celui que IC
feigneur
peur luivre
&
réclamer en¡uelque lieu qu'il aille ;
c'eíl la
rn~rne
chofe que
{er
<le
corps.
V~yez
l'•r–
ticle
116
des anciennes courumes <fu da<;hé de
Bour~
gogne.
SERf DE QUATRE DENIERS,
voy~z
ci-devant
SER.!'
DE DOUZE UI!NJERS,
&c.
~ERF-SERVAGE
ou·
SERVAGJER, eíl celuí qui e!l
flrf
de Ion chef
&
de la tere,
&
doir chacun an q\la–
rre deniers au feigneur pour ran<,¡on de fon chef. Le
i'eigneur pene, quand il lui plalr, prendre rous
le~
biens de ce
flrf,
metrre fa perfonne en otage, le ven–
u
re
&
aliéner: quand
ce
{erf'n'a
point de quoi manger'
le feigneur eíl ren.u de lui en donner.
f/oyez /'artide.
II9
del anciennes couturnes du duché de Bourgogne,
&
J'nrtic/e
5ERF DE QUATRE DENJRRS.
SER!' l'ES TAMENTAL, éroir celui que l'on avo,ir loué
par un pa(le parriculter, le mor
tejlammt
tignifianr
daos
ce~¡e
occalion
écrit.
Voyez
le
glojfoir~
latín de
Ducange
~u
mor
flr vsu.
..
S
E R
71
51!11.1' A LA VIl!: , e.l celui qui vie Ct'\mme
flrf,
&
qui
m ~u rr
franc , lequel éranr n iilé hlur •' bas pJr
Io n
l'ci–
gaeur, n·en
P"
m·ti ,J-mortll,le ,
&
:t•>res Ion
dé:~s
fes
héririers lui fuccedi!nt.
Voyez
/'
m·tid•.
H )
d~s
an–
cic11nes courumes du
cln<'hé lt>
13
J•Jr!
>~ne,
&
ci-de–
v,tur l'artideSERF FRA NC A LA MO llT
0fr:i-apreJ
Sl!!lF
A
I.A VIE f.T A Lo\ MOR T.
SERPA LA
HE f.T
A LA MOR
T
011
A VIE ET A ,\10R T ,
en cel ul qui éranr
origlllakcm~n-
'lid
n-
ll . ..
r
'"'~
!<
rai l–
lable, vir
&
meurc cornrne
flrf
oyez
l'articl~
123
des ancicnnes coucurnes dtJ duché ·le Bourgo,ne .
( A)
SERFO
011
SER.FHO,
Géog.
mod.
cornm~e
Tr¡ur–
neforr l'écric , lle de
1'
Archipel.
f/oytz
S
E
R
p H
o .
(D.
J.
SERFOUETTE,
f.
f.
terme
de Jnrdinier ;
c'eíl un
perir ouril de fer renverfé , qut
a
deux branches poin–
cues d' un ellté,
&
n'en
a
poinr de l'aurrc , lequel écanr
cmmanché d'un manché d'enviro n quarre piés de long,
ierr
a
mouver la rerre,
a
donncr un perir laboor au–
rour des J.¡icues, des chicorées
&
des aurres planees .
(D
J,l
.
ERFOUIR
ors
SERFOVETTER,
ttrme
de J nr –
di11ier;
c'ell mouver la rerre avec
la
fertouctce , don–
ller un perir
labour avec
fa
ferfouertc au cour de
quelques plantes pota"eres, comme po1s, chicorées ,
klirues,
&c.
(
D. .
1
)
~
SERG E ,
datJJ
l.
Commerce,
en une
éroff~
,le lai–
ne piquée OU CrQilee ,
nJd
1U fafruré~
fur le 1:11étier
a
quatre marches ou pédales , de l<t
m~rn,e
ma11lerc que
l'on fabrique les rarines
&
aurres
~coffes.
L1
boor~
des
firgN
i'i!
co nnoir
il
h
croifure
&
celle des draps
a
la 61ure.
f/&yez
DRAP.
'
Il
y
a
de
forgu
de
dílf~renres
elj,eces, q1i pren–
nenr leur norn de leur$
d ,ff~renres
qualicés , o u des
endroirs d>HJS lefqQels on les f.tbrique. Celle qu i a le
plus de répurarioo , eíl la
fo"ffe
de Londres ; elle e!l
mainrenant rres-eflirnée dan< les pays érra ngers' par–
ricul1ere0'1CQ[ en Francc, o4 l'on
a
érabl i
avec
he:tu–
coup de fucces une manufa.'lurc de cerrc el'pece fuus
le
mre
de
flrge
faf01J
de
Londrn .
MamifaElure tle
terge
de
Lu11dres .
Q u1nr
a
la laine ,
on choitir la plus langue pour la
ch:~me ,
&
la plus
caQrre pour ta
rrame: avanr que
do
fitirc ufage
de
1'
ur¡e
&
de
l' autre , on doit prernieremenr la
dég raiflcr, en
la mettanr dans une chat¡diere de
liqueur , un peu plus que riede , com;>'Jl"ée de rrois
quarrs d'ca u bien nene,
&
un quarr-d' urin ; ap r/:s
qu'on l'y a laiflée
~Qez
l<inz -temps pa ur
s'y
diflo u.
dre ,
&
avoir &ré la graiQe,
&.·
on
1~
remue
brnl~
qnemenr avec un
b~ton ;
on
l'ó ;e cnli1 ire de la li–
queur; on la
l~i fle
égourer,
&
apres 1' avoir lavée
dans de l'eau couranre,
&
fechée
a
l'ombre ; o
o la
bar avec des ba roos i'nr un rarel ie de bois, pour en
chafler l'ordure
&
la plus grofl.e poufliere. Apres
q_uoi on l'épluche bien propremenr avec les matns .
<.¿ua11d elle efi ainli préparée , on la graifle o
u,
on
l'•mbibe d'huile d'ollve,
&
l'on peigne avec de g ranos
peigne~
la narcie
i:J
olus lonaue, <le!linée
a
la C'hai–
ne; on la faic chauffer dans"uu perir fourneau pour
cet.>
ufa~e
pour la dégrailfer une leconde fois , o
u
pour
IUJ
oter Ion
huil~;
on la rner dans de l'eau de fa–
von rres-chaude; apres l'en avQÍ I' rerirée, on
In
rord,
ou la [eche
&
on la file au rouer . Q uant
~
la l:tine
la plus courre, done on veur fa ire
rran~e,
on la qr–
de feulell'1enr fur le genou, a
ve
e
de pecires cardes
cres,llnes
¡
on
la file enfuire au rouer
(qns
en llrer
l'huile . !{emarquez que le fil deJliné a la chaine doic
~rre
cou¡ours beaucoup plus fin
&
plus rerours que
celei de la rrame.
Quand la laíne en filée, tallt cellc qul eíl pour la
cha1ne que celle qui e!l pour la rrame,
&.
que l'on
a
mis
le fil en écheveaux, la 1'\íne deílinée
a
la rrame
el\ mife fur des efpolins
( a
moins 'qu'elle n'air éré
filé~
de{fus ) pro porrionnés
a
la cavi ré 011
~
l'reil de
la naverre;
&
fa
l:1ine , qu i eíl pour la chaine, efi
dévidée fur une el'pece de bobines de bQis ,
a
fin
de
la
prépqrer a
~ere
employée: quan
d el le eílnionrée. on
lui donne
<!_e
la confiílance, c'
eJl-a.dn·e, qu' m1
la
rend ferme moyenQanr une efpece de culle , dont
celle qui etl; répurée la mcilleure , efi faire de cou–
pures de parchemio: quand elle eíl leche, on la mee
fur le mécier.
Quand elle en monrée fur le rnérier,
l'ouvrier
élevanr
&,
abaHfa11t tes fils
e
que l'o n palie a-rravers
une
ca~me
ou un réfeau ) '· par le moyen de quarre
pédales,
litUt~es
daos
la parrie i11férietire du mérier,
qu'il 'fait ag1r rra11fverf:llemenr '· égalemenr
&
alrer–
narivernenr !'une apres l'aurre , avec
fe~
piés,
i\
pro-
por-
















