
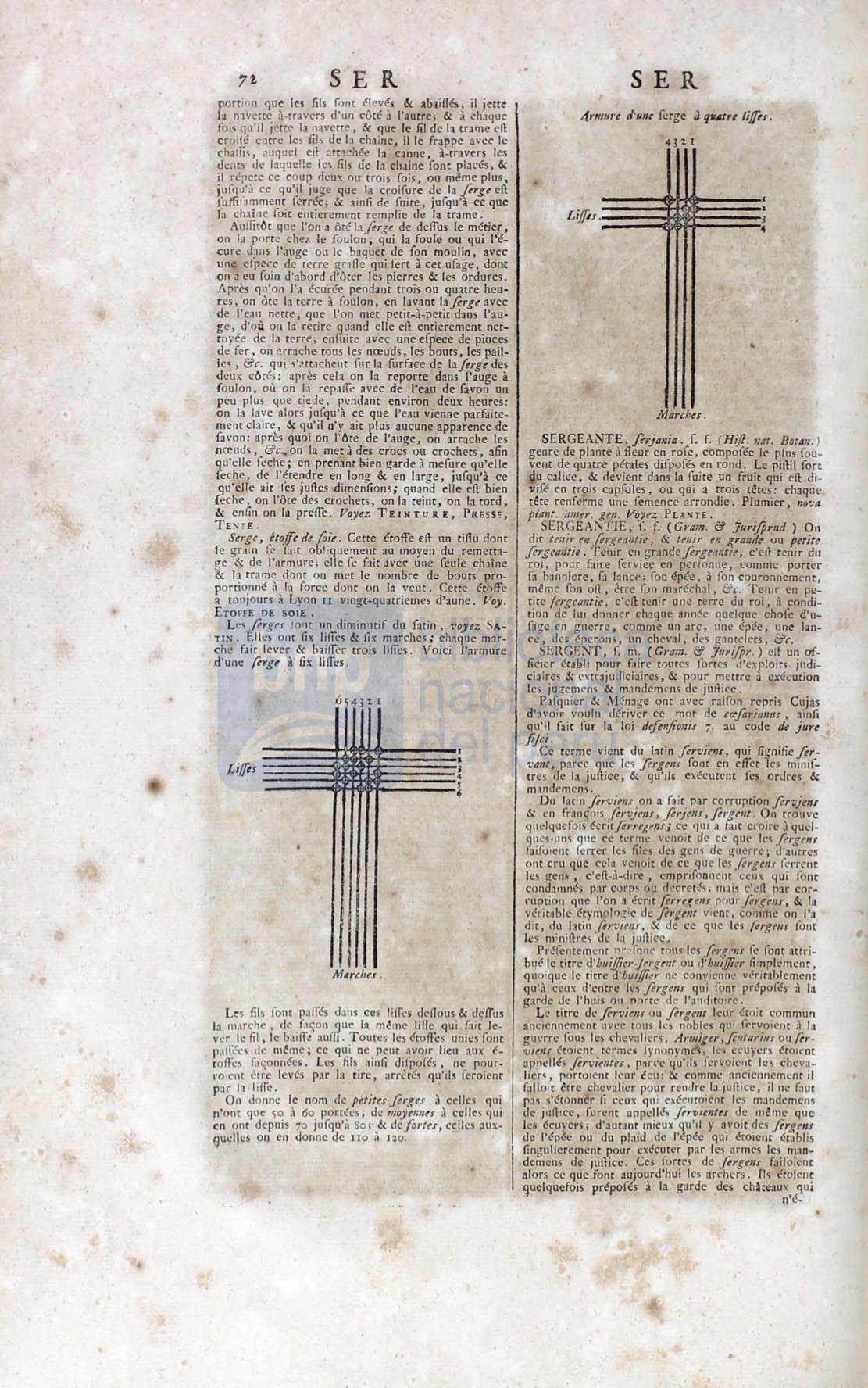
S
E R
porrioo que les fíls font élevés
&
abaífiés, íl íette
b
nwettc a-travers d'un cOté
a
l'autre;
&
a
.:haque
foí~
qu'il jcttc la 11avcne,
&
que le lil de la trame efl
cwdé entre
les
lils de
il
chaine, il le frappe avec le
challis, auqucl e1l
att~chée
la canne, a-travers les
dcnts de laque!
Le
les lils de
la
clldine font placés,
&
il répctc ce coup dcux ou trois [ois, ou meme plus,
jufq~·a
ce
qu'il juge que la croifure de la
ftrg~
en
futfi lamment fcrrée;
&
a
inri de fui te, jufqu'a ce que
la
cha!nc fllit enríeremcor rcmplie de la trame .
Anlfirót qne l'on a 8té
la j'trg~
de delfus le métier,
011
la port.: ehez le foulon ; qui la foule ou qui l'é–
cure d:1ns l'auge ou le baquee de fon moulin, avec
une cfpecc de rerre grn fl c qui ferr
a
cer u(age, dont
.011 a cu foin d'abord d'óte1· les
pi
erres
&
les ordures .
Apres qu'on l'a écurée pendanr trois ou quarre heu–
res, on 8tc la rerre i\ foulon, en la·vanr
lafl,.gt
avec
de l' eau netre, que l'on mer perit-a-perit daos l'au–
ge, d'ou on la retire qu:1nd elle en enrieremenr net–
toyée de
la
rerre; cníuire avec une efpece de pinces
de fer, on arrache ron
les nreuds, les bouts, les pail–
lcs,
&c.
qu\ s'attachent fur la íurfaee de
laftrgt
des
dcux c:Otés :
apr~s
cela on la reporte dans l'auge
a
foulon, oú on la repalfe avec de l'eau de favon un
pcu plus que tiede, pen<lant enviran deux heures:
on la lave alors jnfqu'i\ ce que l'eau vienne parfaire–
menr ciaire,
&f.
qu'i·l n'y air plus aucline apparenee de
favon : apres quoi on l'óte de l'auge, on arrache les
nreuds,
&,·.•
on la mera des croes ou cmchets, afin
qn'elle feche; en prenant bien garde i\ meíure qu'elle
ieche,
d~ l'~te~dre
en. long
&
en large, jufqu'a ce
c¡u'elle lllt les ¡utres dunenlions; qnand elle en bien
feche, on 1'8te des crochets, on la teint, on la rord,
&
enÍin on la prelfe.
Voytz
TI!:INT URE, PrussE,
TENTE .
Serge,
ét~fft
dt
(oit.
Cene érofre e(l un tiftu done
le gram fe
t:11t obliquemem au moyen du remetta–
gc
&
dr.
l'armLH"e; elle fe fait avee une feule cha!nc
&
la
trame dont on met le nombre de bours pro–
porrionné
it
la force done
(Jil
la
veur . Cetrc étolfe
.a
toujours
a
Lyon
11
vingt-quarriemes d'aune.
Voy.
ETOFFE
DE SOIE •
•
Les
.fergts
lonr un diminutif du íatin,
voyez
S.-.–
TIN.
Elles ont fix liflcs
&
lix
marches; C?haque mar–
che fa ir lever
&
bailfer trois lilfcs . Voici Par;¡¡ure
.d'
une
ferge }
fix
li
!fes .
·
.Ó~4P
1
Les fils fonr palfés dans ces lilfe s de!lous
&
dclfus
la
marche ,
de
fa~on
que la
m~me
li lle qui f.1it le–
'1/er le fil, le baifl".! aulli . Toures les éroftcs unies fonr
palfées
de
méme ; ce qui ne peut avoir lieu aux é–
toffes
f:1~onnées.
Les lils ainfi dilpofés, ne pour–
rolent eri·e levés par la tire, arrerés qu'ils feroient
p:1r la li!lc .
On donne le nom de
p!Jtites .fergu
a
celles qui
r'ont que
50
a
6o
portées; de
moyemus
a
celles qui
en ont depuis
70
juíqu'a So;·
&
defortes,
c:elles
~ux¡:¡uclles
Pll
e1¡
do~ne
qe
110
a
120.
SER
4mmrt
J·unt
íerge
()
qutrt
lijfu.
Marcbu .
SERGEANTE,
fl•ja>zia ,
í.
f.
(
Hijl.
11at.
Botan. ¡
genre de plante i\ fleur en roíe, compoféc l.e plus íou–
vent de quarre pérales diípofés
~n
rond. Le pinil forr
QU
callee,
&
cfevient dans la fui te Un fruit qui en di–
vifé en troís capiules, ou qui a rrois t!tes: chaqn e
t~re
renf..-rmc une femencc arrondie. Plumier,
nova
plant. am1r.
gen.
1/oyez
PLAN TE.
SERGEAN'fiE,
(.
f. (
G•·am.
&
Junfimd. )
On
d}t
tmiJ: m
.fergeantie,
&
tenjr en
~rande
ou
petitc
Jcrgranttt.
Tl·n•r en
gr~nde fergermt~e,
e:•
en tcnir du
ro1, pour fa ire íervice en pcrlonne, comme poner
li1 hannicre, fa lnnce; foo ép€e,
a
fon couronnemcnt,
m~
me fon on, erre Ion maréchal,
&c.
Tenir en pe–
tire
férgcantie ,
e·en tenir une rerre du roi, ;\ condi–
rion de lui donner G"haque annéc quelquc chofe d'u–
fage en g11crre , comme un are, une épée, une lan–
qc,
de~
éperons, lln cheval,
de~ ~onrelets,
&c.
SERGENT,
í.
m. (
G•·am.
&
Jtt•iJPr.)
el! un
CJf–
licier établi pour faire toures forres J'cxploirs jndi–
cia lres
&
extqjudici~ircs,
&
pour mettrc
a
exécution
les
jugemens
&
mandcm ens de jullice.
Pafquier
&
Ménage ont avec raifon rcpris Cujas
d'avoir voulu dériver ce mor de
co:.fariaiJUI,
ainfi
qu'il fait fur la Joi
defm.fio•zis
7·
au code
tk
}urt
fijci.
Ce termc vient
du
latin
.fervin;s,
qui fiunilic
fir–
vant,
paree que les
.fergem·
font en etfet les minif–
tres de la juniC?e,
&
qu'Jis exéaurenr fes ordres
&
mandemens.
Du latín
firvienr
on a fa it par corruption
.fervjenr
&
en fransois
.ferv}ens, flrjens, fi>"!etzt .
On trouve
qnelquefois
éc:rir.fen·egens ;
ce 'lllÍ a lair croire a quel–
ques-uns que ce terme venoir de ce que les
.fergenr
faifoient ferrer les files des
gens
de guerrc; d"aurres
onr cru que cela vcnoir
de
ce que les
.fergms
fcrrent
les ¡rens , c'e_ll-:l-dire , emprifonnenr ceux qui fonr
conaamnés p;¡r
COI"['S OU
decretés;
ffiJÍS
c'efl par
COr–
l"llj)tiOn que l'on
a
écrit
.ferre~ens
pour
jitrge11s,
&
In
véritable étymolog-'c de
.fer¡mt
v•ent, comme on l'a
dit, du larin
fi,.vims,
&
de Cle que les
¡e,.gnu
lonr
les minilhes de
1~
jufl ice .
Préfenrement
"nfque tous les
.fer_f"II
fe fonr attri–
bué le riere d'
bttifficr:/.trgttzt
ou d'
buiffie,.
fimplement,
qnoique le titre
d'buiffier
ne convienne vérimblemenr
qu'a ceux d'entre les
.fergmr
qui font prépoíés :\ la
garde de l'hujs
ou
norte de l'auditoire.
Le titre de
.fervie>u
u
u
.fergent
leur étoit commun
anc•ennement avec tous les nobles qui íervoienr i\ la
guerre (ous les chevnlicrs.
Armi¡e1• ,flrttarills
ou
ft,.–
vims
étoienr termes fynonym
; les ecuycrs éto1eor
appellés
.fervimtes,
p~rce
qu'ils fervoient le s cheva–
liers, portoient leur écu:
&
comme anc:ienn mcnr il
fallo1r erre cheva lier pour rendre la jufiicc, ilne faut
pa
s s'étonner
li
ceux qni exécntoienr les mandemens
de
jun.ce, furent appellés
flr'llientu
de
meme
que
les
tkuycrs; d'autant mieux qu'1l
y
avoit des
.fepgenr
de l'épée ou du plaid de l'épée qui étoienr établis
lingulieremenr pour exécuter par les armes les man.
demcns de jufiic:e . Ce; forres de
.fergCIJs
faifoient
alors ce que fonr aujourd'hui les archers. lis étoienc
'luelquefois prépofés
a
la garde des chheaux qui
o'é-
















