
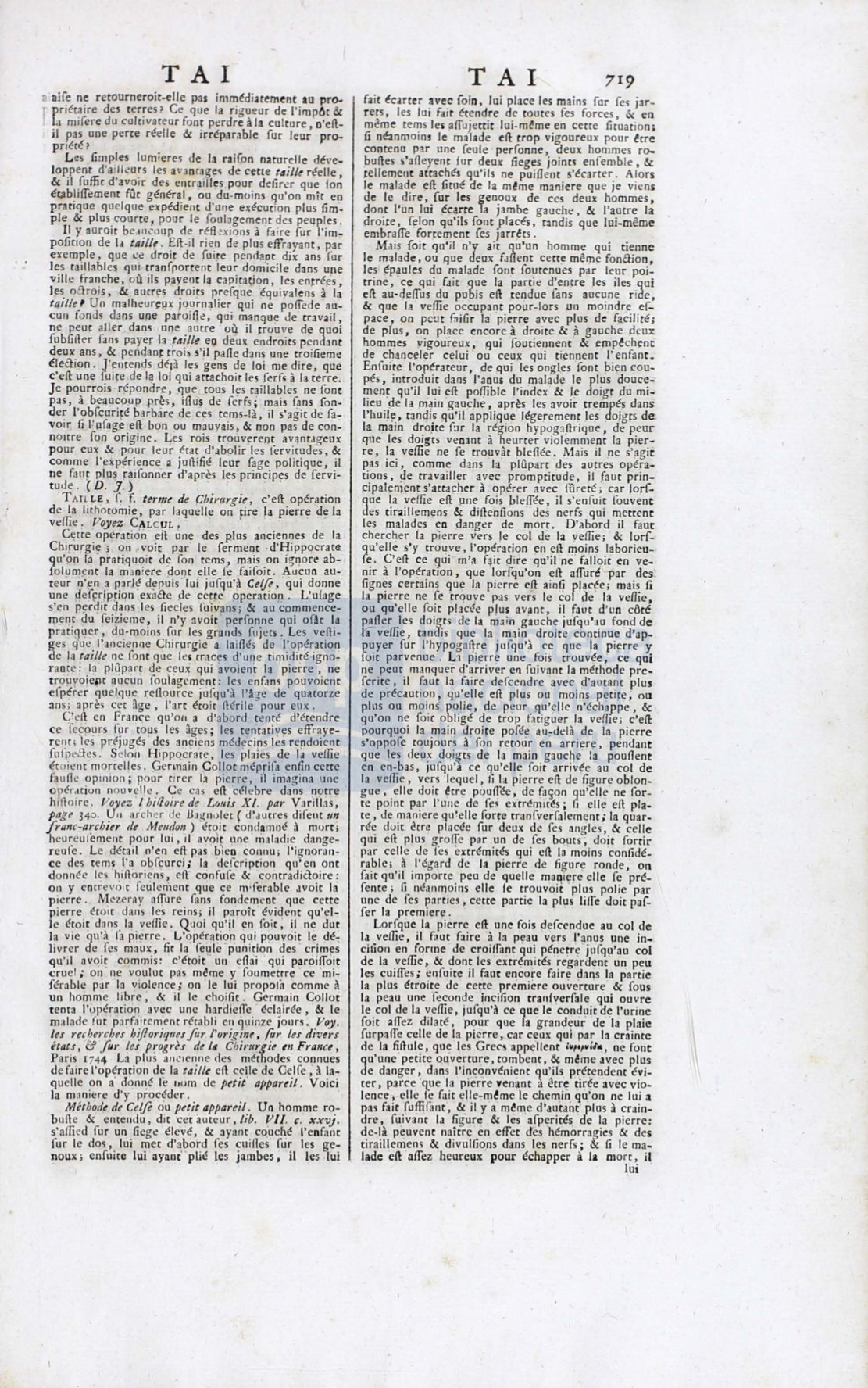
T
A
I
a aife ne retourneroit-elle pas immédiatement au pro–
priétaire des rerres
1
Ce que la rigueur de l' impOr
&
la
mifere du culrivareor foor perdre
a
la culture n•en–
il pas une perre réell e
&
irréparable fur
le~
pro–
priété ?
L es fimples lamieres de la ra iúm natorelle déve–
loppenr d'ailkurs les
a vanrage~
de cene
ttSÍI/e
réelle
&
il (uffir d'avoir des entrailles pour
detir~r
que
lo~
érabli!fement fat général, ou du-moins qu'on mit en
prarique quelque expédient J 'ur¡e exécurion plus lim–
pie
&
plus courre
1
pour le (uu lagemenr des peyples .
ll
y
aurait beJIICOUp de
r~fl~xions
a
fa ire fu t l'im–
pafition de l•
taille .
Ell-il
ríen de plus etfrayanr ,
pa~
exemple, que
~e
droit de
fui.rependapt dix
a
os fu r
les taillables qui trao(porr
ent leur domicile daos une
vill e franche,
oii
ils
p~yent
la capiration , les enrrées,
les oélrois'
&
aurres droits pre(que équiyalens a la
tailla
Un
malheur~~x
jqurnalier qui ne po!fecle au–
cun fonds dans u¡¡e paroiije, qui manque de travail,
ne
peur aller dans une aorre ou il rrouve de quoi
fubtill er fans payer
la
faille
eQ deux endroits pendant
deux ans ,
&
peñdanr rroi> s'il pat1e dans une rroitieme
éleéliun . J'¡:nrends dé1a les gens de loi me dire, que
c'ell une luite de
1~
loi qui artachoit les ferfs
a
la rerre.
Je
pourrois répondre , que rous les taillables ne font
pas ,
a
bequ~pup
pres , it1us de férfs i mais (a ns fon–
der
l'ubfcorr~é
barbare de ces rems-la, il
s'~gir
de fa–
voir ti
J!uf~ge
en bon ou maoyais,
&
non pas de con–
no~rre
fon origi ne. Les rois rrouv¡!rent
av~nr•geox
pour eux
&
pour leur écar d'Jbalir les (ervirudes,
&
comme l'¡!xpérience
a
jullifié leur (age polirique, il
ne fanr plus raifonner d'apres les
princip~s
de fervi–
tude .
(D.
J . )
T
Afl LE '
r,
f.
urme de Chirorgie.
e'
en
opér~rion
de la lithowmie, par laqoelle on Fire la pierre
~e
la
veffie.
Voyez
C.ucoL,
C~tte
operatión eil une des p.Ius
¡~nciennes
de la
Chirurgie ; on voir par le
fermenr -d'Hippocrata
qu'on la 'prariquoit de ron teros . mais on
íg~ore
ab–
folum~nt
la maniere :doqr l!lle
(e
faifoir. Aucun au–
reur
r·~n
.a
~arJ~ d~¡JUis
lui
juf~u·a
Cdfo,
qui donne
une f!ef¡:r¡ppon exaéte
~e
ceHe pperarron . L'ufage
s'en P>r'!ir
d~ns
les tiecles
l~ivans
¡
&
au
commence~
ljler¡r do feizrcme,
il
n'y avoit per(o¡me qui ofat la
pratÍf]~er,
du-moins fur les grands (uj ets. Les velli–
ges
q·u~
l'ancie¡1ne Chirur¡¡ie a lai!lés de l'opérarior¡
C:le la
taille
ne
(onr
que les traces d'uue rimidité igno–
rante: la pl üparr de ceux qui avo'íent la 'pi erre , ne
trouyoje,pt aucun (oulagement : les enfa ns pouvoienr
efp~rer
quelque ret1ource jufqu'i\ I'A;e de quatorze
ans; apres cet age • l'art éroit llérile pour eux.
Cen en France qu'o11 a d'abord renté d'érendre
ce
fc~pur-s
fpr tops les ages ; les
rentati y~s
effraye–
renr; les
p~~¡ ugés
des anoiens médecirs les rendoient
fu i'peétes.
~elon
H ipRQCrace ; les plaies de la
veffie
éroient morcelles. Germain Collar méprifa
en~n
cette
fa
u!le opinion ; pour rirer la pierre,
ii
imagina une
o péraciun nouvelle. Ce cas en 'cél ebre daos narre
hi(loire.
Voyez
1
hifloire de
L&~~is
XI.
par
Varll'r:is,
page
J40.
~11
archer de llagnvlec' d'•urres di(ent
1111
fratlc-archur de Meudon
)
étoit condamné
¡\
murr;
heureulement pour lui .
11
avolt \)ne ' maladie dange–
r eure . Le dérail n'en etl: pas b'leo i:onnu; '!'ig noran–
ce des rems ('a obfcurci; la 'dercription qu'en onr
donnée les hinoriens, efl' ccinfu(e
&
conrradicloire :
On
y
CntreVOÍC feÚJ en'¡ent que ce m'ferable dVOit la
p ierre . Mezeray alfure fa ns
fondemeoc qoe cene
pierre étort dans les reins;
il
paroir' évident qu'el–
Je étoir dans la veffie. Q uoi
qu~il
en fo ir ;
il
ne dut
la vie
qu~a
la Pi\!rre .
L'qpér~~i~~ q~i p¡mvcii~ 1~. dé~
livrer de res maux. lit la fe ule punrrion des
crtm~s
qu'il
avqi~
commis: c'éroic" un
~Oai
qui
p~rcii!J'oi~
cruel ; on ne voulur pas
m~me
y
foumettre ce mi–
férable pár 'la violence; on ' le lui propala comme
a
un homme libre,
&
il
le choifir . Germain Collot
tenra l'opéraricin avec une hardie!fe éclairée , ·
&
le
malade fur 'parfairen1ent rérabli en quinze íours .
Voy.
les recberches hijloriques for l'orig inf, (ur
/u
diwrs
états,
&
Jur
le~
Progrcs de
11
Chirt!!.fÚ
11!
France,
París
1744
La plus
an~renne
des mérhodes connues
de fai re l'o)>érarion de la
tailü
en ccile de Gel fe ;
a
la–
quelle on a' dónné le
uom
de
pftii appartil .
Voici
la maniere d'y procéder .
Métbode de Celfe
o
u
petit appareil .
Un homme ro–
burle
&
enrendu , dir ·cer auceur,
ti
!J.
VII. c. xxvj.
s'affied
(ur
un liege élevé,
&
3yanc co:uché l'enfant
fur le dos, lui mer d'.abord fes cuit1es fúr les ge–
noux; enfuite lui ayanc'-plié Les
jambes,
il
les .(ui
TAI
fait éearttr avec foio , lui place les mains for fes jar–
rers, les lui fa ir étendre de coures fes forces,
&
en
meme rems les a!fujettit
loi- m~me
en cecee
tiruarioo;
li néanmoins le malade el!: trap vigoureux pour
~rre
conteno par une (eule perfonne , C:leox hommes ro–
bulles s'at1eyenc lur deux
lieges
joinn enfemble ,
&
¡ellemenr atraché's qu'ils ne puiUen t s'écarcer. Alors
le malade ell lirué de la
m~me
maniere que je viens
de le dire, fur les geooux de ces deux hommes ,
dont l'on loi écarre la jambe gauche,
&
l'aurre la
droice, (elon qu'ils fonr placés, randis que Jui-meme
embra!fe for.rement fes
jarr~ts.
Mais foit qu'il n'y aic qu'un homme qui
rienne
le
m~lade,
ou .que deux f• fient cette mame fonélion,
les épaules du malade font fourenues par leur poi–
trine, ce qoi fair que la .partie d'entre )es iles qui
ell ao-de!fus du pubis ell rendue fa ns aucune ride,
&
que la veffie occupaqr pour-lors .un moindre ef–
pace
1
on pcm f., ifir la pierre avec plus de facil ité;
de plus. on place encare
a
droice
&
a
gauche deux
hommes "igoureux ,
.qui foutiennent
&
emp~ch~nc
de chanc¡:ler celui ou ceux qui riennenr
1'
enfant–
Enfuite l'opérareur, de qui les ongles (out bien cou–
pés , inrroduir dans )'aous du malade le plus doucc–
menr qu'il lui
en poffible l'index
&
le doigr du mi–
lieu
9e
la
m~in
gauc.he,apr~s
les avoir .rrempés dans
l'huil~,
randis q
u'il applique
légeremenr les ¡lojgrs de
la main drojre fur la région
hypoga.llrique , de peur
que les doigts veoant
a
heur
rer violemmenr la pier–
re , la veffie ne fe rrouvat plet1ée. Mais il ne
s'~gic
pas ici , comme dans
la pl Oparr des au¡res
op~ra
rions, de rravailler avec promprirude , il faur prin–
Fi palenient s'attacher
a
opérer avec
m
reté; car Jorf–
que la veffie e!1 pne fqis plelrée , il s'enfuic louvent
des riraillemens
&
dineotions .. des nerfs qui mettenc
les
malad~s
en danger de
mor~.
D'ab?rd il
fauc
cherc~er
la pierre
Vers
Je col de la yet11e;
&
lorf–
qu'elle s'y trouve, l'opéracion en 11n moips laborieu–
(e .
e•
en ce qui m'a
f~i c
dire ¡:¡u'il
mi'
falloir en ve–
nir
~
l'opérarion. que lorfqu'pn en a!fur6' par des
lign~s
cerrains que la pierre e!l ainf¡
r'·c~e; mai~
li
la p1erre ne
(e
'rrquye pas vers le co
de
la vet11e,
o u qo'elle foit placo!e p!us
av~ nr ,
il
faut d'up cllré
pa!ler les doigrs de la main gauche jufqu'au ford de
ra
veffie ' randis que la main droire conrinue
~·ap
puyer fur l'hypogaqre
jofqu!~
ce que !a
pi~rre
y
foi c parvenue.
L1
pi~ rr~
une fois
rrouvée; ce qoi
ne peur manquer cf'arriver en fuivant la méthode pre–
(crire, il
fau r la faire defcendre avec d'a uranr plus
de précaucion' qu'elle en plus ou moins
p~ti¡e;
ou
plns ou moins' pq!ie, de
p~ur
¡¡u•epe n'échappe,
&
qu'on ne foi c obligé de trap
f~tiguer
la veffie; c'ell:
pourquoi la !Jlair¡ droire
pofé~
au=dela de
la
pi~rre
s'oppofe ton¡ours
~
fon ferour en
arri~r~,
pendant
que les deu!'
dqi~ts
de la main gaucre la pou!lent
en en-bas, ¡ufqu'a ce gu'el!e foir
arrrv~e
au col de
la veffie, vers ·requel, li la pierre en de figure oblon–
g ue, elle doic
~tre
puu!fée, de
fa~on
qu'elle ne for–
re poinc par l' uqe de
(~s
eicrémirés
¡
fi
elle en pia–
re . de
m~niere
qn!elle for¡e
rranfverfalem~nt;
la quar–
rée
~u
ir erre placée fur deux de fes angles,
&
celle
qui en plus g.rolfe par un de
(es
bq~ts.
doit fortir
par celle de les exrrémités gui en la moins confidé–
ra.ble;
.a
. l'ég~rd
de
la pier(e de
ligur~
ronde; on
far r qu'rl Importe peu de quelle maniere elle fe pré–
(enre;
ti néan1J10ins elle {e
trOUVOÍt plus palie par
une de fes parries, cetre parrie la plus lilfe doit paf–
fer la premiere .
Lorfqué la pierre ell une fois defcendoe au col de
la veffie. il faur faire
a
la
p~au
vers l'anus pne in–
cilian en fqrme de croi!fan¡ qui
pépe¡r~' jufq~'au
col
de la veffie,
&
done fes
exrr~micés reg~rdenr
Uf! peu
les cui!fes; en(uice il fauc ef!core
fair~ 9a~s
la parrie
la plos
étroi~e
de ce¡re premiere ouverrure
&
fous
la peau une feconde (ncition rrarllyerfale gui ouvre
le col de la veffie , jofqu'a ce que le
cond~it (!~
l' urine
(oit a!fez
dil~té ,
pour que la gran9eur de la plaie
(orpa!fe celle de la picrre, car ceux qui par la crainte
de la fillule, que les Grecs ·appe'llent
:.,,,.:t. ,
ne font
qu'une'perite Q'1'verrure , rombent ,
~ m~me
av,ec plos
de
danger, daf!S l'incqnvénienr <tu'ils.
p~~rendent
évi–
rer,
par.ce'que la pierre Yenanc a
etr~ rir~e
avec vio–
lenc
e .-ellefe faic
e1le-m~me
le chefl\in, qu'on ne fui
a
pas faic fuffi fa nr'
&_
il
y
a m!m,e
d'autan~·
plus
a
crain–
dre, fuivant la figure
&
les a(perités. de la pierre:
de-la peuvent nairre en etfec d'és hémorragies
&
des
tiraillemens
&
divullions dans les nerfs ;
&
fi
le ma–
lade
eft ·a
!fez
'heureux · pour échapper
a
la mo
re,il
l.ui·
















