
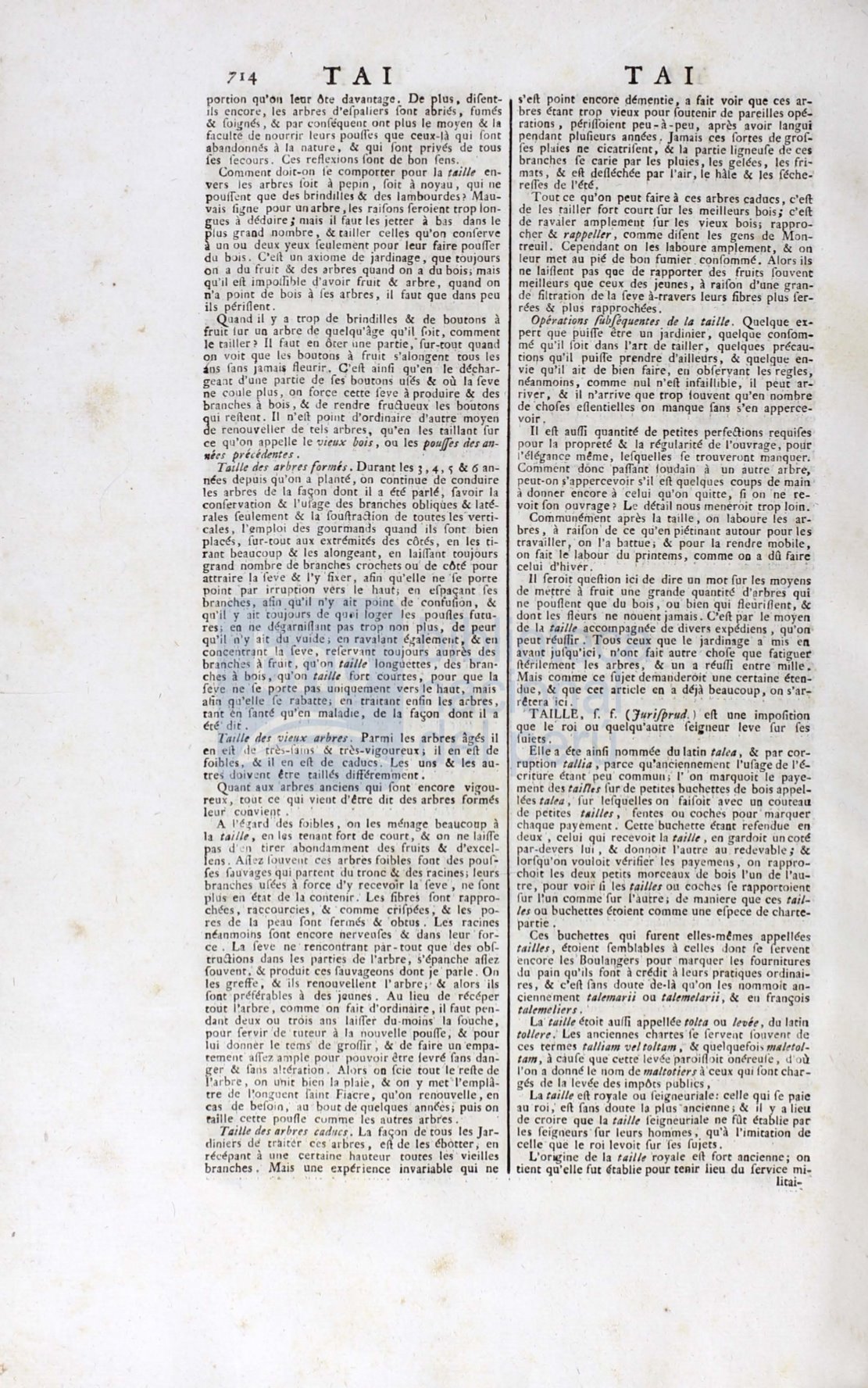
T A I
portion qu'o11 leur óte
dava~ragc.
De plus, diíent–
ils encore, les arbres d'eípahers font abrtés , fumés
&
foi_gnés, & par coníéquenr ont plus le moyen & la
f.1culre de nourrir leurs pouffcs que
ceux-!~
qui fo nt
abandonnés
a
la nature ,
&
qui fon¡ privés de rous
les i'ecours. Ces rdlexions f'ont de bon feos.
·
Commenr doir-on te componer pour la
t4ill~
en–
vers
les arbrcs foit
il
pepin, foir
a
noy~u,
qui nepouff~nr
que dts brindtlles
&
des lambourdes?
M.au–vais tigne pour un arbre ,les raifons feroienr rro
p lon–Gucs
a
dédoire ; mais il faur tes jerrer
a
liJs daos te
p lus g raad nombre,
&
railler celles qu'on conferve
il.
un ou deux yeux feulem ent pour leur faire pouffer
du bois. C'etl un axiome de jardinage, que roujours
on a du fruit
&
des arbres quanCI on a du bois; mais
qu'JI efl im po!Tibte d'avo ir fruir
&
arbre, quand on
n'a point de bois
a
fes arbres' il faut que daos peu
ils périflent .
Q uand il
y
a trop de brindilles
&
de boutons
a
fruir lur un arbre rle quelqu'age qu'il f.>it, comment
te railler?
11
fam en 6rer hne partie, · fur-tOl)t quaad
0)1
voi t que les boutons
a
fruir s'alongent rous les
áns
fa ns ¡amais Reurir . C 'efl ainti qu'en
le dé¡:har–
creant d' une pa rrie de fes· bourons ufés
&
oil la feve
~e
conle plus , on force cette fe ye
il
produire
&
des
branches
a
bois ,
&
de rendrc fruélueux' les 'bourons
qui rellene .
11
o'etl point d'ordinaire ·d'aurre moyen
de renouveller de tels arbres, qu'en les taillant íur
ce qu'on nppe!le le
vieux bois,
ou les
pouffis des
IJII·
,.;u
prttirkntu
.
·
TtJtllc du tJrbru (ormh.
Durant les
3, 4,
s
&
6
an–
nées depuis qu'on a planté, on continue de conduire
les arbres de la
fa~on
done il a été parlé, fa voir la
conÍt!rvation
&
l' utage des branches obliques
&
laté–
rales íeulement
&
la íouflraélion de toutes les·verri–
cales , l'¡!mploi des gourmands quand · ils íont bien
placés , íur. rouc aux extrémités des c6rés , en les ti–
r aot beaucoup
&
les alongeant, en laiffant roujours
grand nombre de branches crochers ou' de cóté pour
attraire la 'ft! ve
&
l'y 'fix er, afin qu'elle ne ·re porte
voint 'pár irru prion vers le haut; en efP,a<;ant fes
branches , a
fin
q'u'il n'y air p in
e
de ·contu(ión,
&
qu'il y ·ait 'roujours de qu., i loger fes poufles furo–
res ; en
o
e
d~garniflant
pas trop non plus, de peur
qu'il n' y ait du vu i'de; en ravalant
é~alemellt,
&
en
concencranr la íeve , refervanr roujours 'aupres des
brancties ·
¡\
frti1t , qu'on
tai/1~
long lierres, des bran·
ches
a
boís, qu'on
taillt
forr courres, pour que la
feye oc fe porte pas
uoiq~en:¡enr
vers le haut, mais
atin gu'elle fe rabarre; en rra1ranr enfin
les
arbres,
can't 'én 'fa nté qu•'en matadte, de la
fa~on
dont il
été' dii .
'
Trllllt des vitiiX arbru .
Parmi les arbres agés il
en etl de
ire>-Ía 111~
&
rr\)s-vigoureux; il en efl de
foib les ,
&
il en efl de caducs . Les uns
&
les au–
tres doi venr irre caillés diff'érem'mént. ·
Q uant aux arbres anciens qui font encore vigou–
reux , tou r ce qui vient
d' ~rre
die des arbres formés
leur' convie¡H .
'
'
'
.
A
l'é
rard 'des foi bles, on les ménage beaucoop
ii
la
ttJilll ,
en las cenant fort de court ,
&
on ne laiffe
pas d'en
tirer abonda mment des fruirs
&
d'excel–
lcns . Aflez lo uvent ces arbres foibles font des pour–
fes fJu vages qui parcenr du· tronc
&
des Í'acines ; leurs
branches ufées
lt
force d'y recevoir la' feve , ne Íont
¡:illis en érat de la conteoir . Les libre; font ' rappro–
cbées, raccourcies,
&
comme crifpées ;
&
les po–
res de la ·peau fonr fermés
&
'obrus . Les racines
néanmoihs font encore hervetJÍes
&
l:l~ns
leur · for–
ce . La íevc oc · rencontranr par-tour que ''des obf–
rruélions daos les
partie~
de l'arbre, s'épanche aflez
fou vent,
&
produir ces íauvageons done je · parle . On
les g relfe ,
&
'i!s renou vellenr
1'
arbre ;·
&
alors ils
font préférables
a
des 'jaunes . Au lieu de récéper
tour
l~arbre ,
co mme on fair d'ordinilire, il faur
p~n
da nr deux ou cróis ans lai ffer du -moins'
"la
fouche ,
pour fer vir 'de rureur
il
13 nouvelle pouffe,
&
'pour
lui donner le rcms' de groflir ; &· de faire un empa–
temenr· affcz am ple pour pouvoir erre
fevr~
fans dan–
g er
&
fa ns alr<!rarion . Alors oo fcie tour le 'refle de
l'arbre , on un ir bien la pi ale ,
&
on y met"·l'empl3-
rre de
l ~ongucnr
raint
Fi~cre ,
qu'on reno uvelle, en
cas qe befoin ; au bour de quelques anné'esf puis on
taille cette pnu fl e cumme les nutres arbres . ·
·
Taille des nrbres caducs .
La
fa~on
de rous les Jar–
cliniers
M
rrilic"ér ces 'arllres,
eri
de les ébotter
1
en
récépant
a
une cercaine haureur roures les· vieilles
branches .'
~ai~ ~~~ ~xpérience
invariable qui ne
TAI
s'efl: point encore
¡Mm~ntie,
a fait voir que ces ar–
·bres étant
~rop
vieux pour foutenir
~e par~illes
opé–
racions, périfloient peu" a-peu, apres .avoir langui
pe~dan~
plufieurs aonées : J amais ces
íor~es
de grof–
fes plaies ne cicatrifenr,
&
la parrie ligneuíe cle ces
branc~es
re carie par les pluies, les gelées' les fri–
mars,
&
efl defléchée par l'air, le hale
&
les féche-
reffes de l'été.
·
T our ce qu'on peut faire
a
ces arbres caducs, c'efl:
de les ,railler fort courr .fur les meill eurs bois; c'efl:
de ravaler ampl!!menr !ur les vieux bois; rappro–
ch~r
&
r_,appelltr,
comme diíent les gens de M on–
treuil. Cependant on les ,laboure
~mp)ement,
&
on
leur mee au pié de bon fumier . confommé. Alors ils
ne lniflent pas qae de rapporter des fruits fouvent
meilleurs que ceux des jeunes, il raifon d'une gran–
dé
fil tr~tiory .
de 'la feye a-rravers
leur~
libres plus fer–
rées
&
plus rapprocliées.
Opér.tJtiont fub/équentu de la taillt .
Q uelque ex–
perr que pui(fe erre un jardinier, quelque coníom–
mé qu'i l f'pir dans !'are de
taill~r,
_quelques précau–
tio0s quril puiffe
pr~ndre
d'aillellrs,
&
~uelgu"
en–
vie quril ait de l>ien faire, en
obf~ryant
les regles,
néanmoins, comme nul n'efl infaillible,
'ii
peur ar–
river ,
&
il n'arrive que
~rop
louvent qu'en nombre
de ·chofes eflentielles on manque fans s'eo apperée-
voir.
·
'
1
'
. 11
efl au(fi quantité de petites
perfe~ions
requifes
pour la proprecé
&
la régulamé de l'ouvrage, po!Jr
t'élégnnce
m~me,
lefquelles fe rrouveront ma nqu!!r.
Commcnt dónc 'paffant loudain
ii
un aurre arbre,
peur·on
~·appercevoir
s'il 'efl quelques coups de main
a
donner encore
il
'celui qu'on quitte,
ti
pn
ne re–
voit f<?n puvrage? L e détai l nous meneroit .rrop Join . .•
Communém'enr apres la taille, on laboure les ar–
bres,
a
difon' de ce qli'en piétinant autour pour les
trava'iller
1
on l'a battue;
&
pour la rendre mobile,
on fait le )abour du pr¡nrems, comme oo a dG faire
celuí
d'hiv~r .
• '
'
·
ll
feroit qu'eflion ici de dire on mor (ur les moyens
de me¡rré
a
fruit une grande quantité d'arbres qui
oc pouflenc que du bois, ou bien qui Reuriflent,
&
don r les Reurs oe noueinJ·amais. C'efl par le moyen
de la
tai/1~
accompagnée' e
'diver~
expédiens. qu'on
peor réu(lir
:
Tou·s ceux que le jardinage a mis en
avant
jufq~'ici,
n'ont faic aucre cho'fe que faciguer
flérilet'nent
les arbres,
&
un a réufli entre mili
e.
Mais comine ce íujer'demanderoii une cercaine étea–
aue,
&
que cer arride en a déjil beaucoup, on s'ar-
r~[era
ici .
1
•
t.>· •
•
' T Al!--LE,
r.
f.
(
Jt¡ri.fimu(.
J
efl une impofition
que le roi ou quelqu'autre
fel~neur
leve
fur [es
luiers .
·
1
•
•
•
•
•
Elle a éce ainfi nommée du latin
tal.•a,
&
par cor–
rupcion
ttJIIitJ,
paree qu'anciennement l'ufage de l'é–
critur'e éranr ' peu' commuu ;
1'
'oo marquoir le paye–
meh t des
taiflts
fur de perites "buchettes de bois appel–
lées
ttJita,
fu r lefquelles on ' faiíolc' avec ua coureall
de perites
t1lillu,
·
feotes ou coche's pour · marquer
chaque payement. Cette buchetre éranc refenilue en
deux ·, celui
!JUÍ
recevoit la
ttJillt ,
en gardoit un coté
par-devers lu'i ,
&
donnoir l'aurre au redevable;
&
loríqu'on vouloit vérifie'r' les payemens, on rap¡iro–
choic les deux petits morceaux de bois !'un de l'au–
rre, ·pour voir ti les
ttJillu
Oll
coch-s fe rapporroient
fur l:un cornme fur l'au[re; de maniere que ces
tail–
lu
ou buchettes éroient comme une efpece de charre–
'parrie.
Ces buchettes qui furent elles-mEmes appellées
tlfillu,
étoient femblables
il
celles don e ie Ít!rvent
encore
l es' Ooula~gers '
pour marquer les fournitures
da pain qu'ils font
a
crédit
a
leurs prati<jues ordinai–
res,
&
·c•en fans doure" de·lil qu'on les nommolr an–
cienne rnent
tal~ma,.ii
o u
ttJitmelarii,
&
eu fran!jois
taltmcli~rs .
'
.
La'
tai/1~
étoit auffi appellée
to/ta
ou
levé~ ,
du latin
tollel'~
.'
Les anciennes chartes fe fervenr f'ouvenr de
ces termes
talliam
ve/
toltam,
&
quelquefois
mHietol–
tam,
a
c:iufe' que cerre levée 'pardifl ir
on~reule ,
d'
u
l'on a donné le norn
demaltotitrr i 'ceux
qui f'ontchar–
gés ele la levée des impOrs publics,
La
taille
efl royale ou feigneuriale: celle qui íe paie
au roi ; efl fans doure la plus"ancienne;
&
1!
y
a lieu
de croire que la
taille
leigneurialt! ne fOt établie par
les fefgn·eurs · fur leurs hom'mes
:.
qu'a l'imirarion de
celle que le roi levoit fur Tes fu Jets.
L'orígine de la
taillt
'royal
e
efl fort ancienne; on
tient qu'elle fut lftablie pour cenir lieu du fervic.e
~i:
htat-:
















