
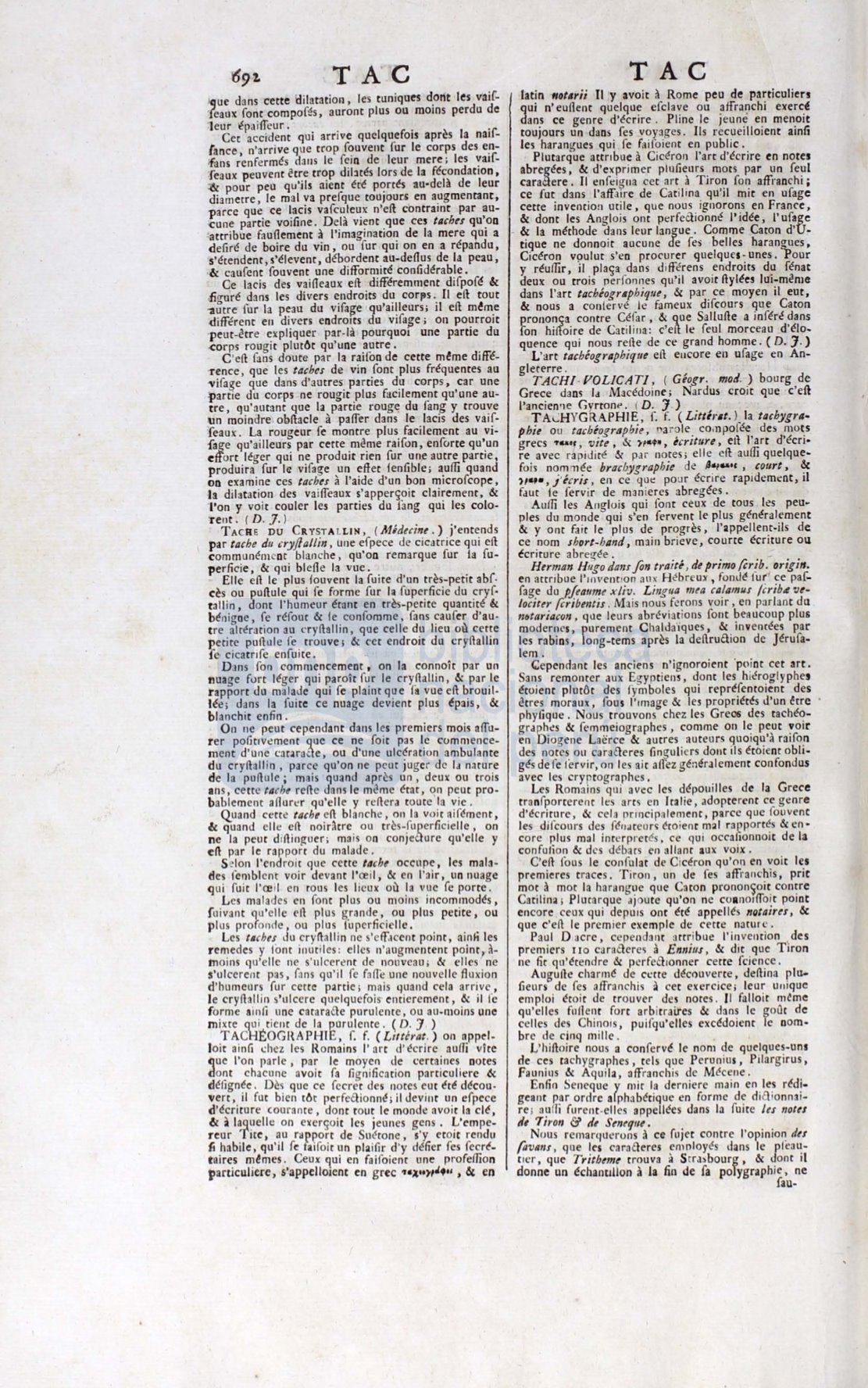
TAC
Jque dans cette l:lilararion, les tuniquts dont les vaif–
'feaux fonr
compof~s,
auront plus ou moins perdu de
1eur épaifTeur .
.
.
.
Cec accident qui amve quelquefoas apres la naaf–
fance , n'arrive que crop fouvent fur le corps des e!l–
fans renfermés elaus le fem de leur mere ; les vaaf–
.feaux peuvenr erre rrop dibcés lors de la fécondarion,
:&
pour peu qu'ils aienr été
P<?rtés
au-del~
de leur
di3merre, le mal va prefque rou¡outS en
augmenranr~
p aree que ce lacis vafculeux n'eít conrraint par au–
~une
partie voifine . Dela viene que ces
t11chu
qu'on
:amibue fa ullemenr
~
l'imaginarion de la mere
~ui
a
deliré de boire elu vin , ou fur qui on en a répandu,
s'écendent , s'élevenr, débordenr au-dellus de la peau,
&
caufenr fouvenr une difformiré confidérable .
Ce lacis eles vailleaux eft ditféremment difpofé
&
Jiguré daos les divers endroits du
cor~s .
11
eft tour
-aucre fur la
p~au
du vifa¡:-e qu'ai!leurs; il eft
m~m.e
ditférent
e
u davers endrom du vafa$e; on pourroar
peur-ecre expliquer par-la pourquoa une partie du
~orps
rougic plucOr qu'une aurre.
C'eft fans doure par la rai!on de certe m!me ditfé–
-rence , que les
taches
de vin fonr plus fréquentes au
-vifa~e
que dans d'aucres parries du carps, car une
;parcae du corps ne rougic plus facilemenr qu'une au–
rre, qu'autant que la panie
roug~;
du fang y rrouve
un moindre obftacle
ii
pafTer dans le lacis des vaif–
feaux .
La
rougeur fe moncre plus facilemenr au vi–
{age qu'ailleurs par cerce m@me raifon, enfurte qu'un
etforc léger qui ne produir rien fur un,e auere partie,
produira fur
la
vifage un elter fenfible; auffi <¡uand
on examine ces
tacbn
a
l'aide d'un bon microfcope,
la
dilaration des vaifTeaux
s'apper~oir
clairement,
&
l'on
y
voic couler les panies du ¡¡¡ng qui les colo–
u ne.
( D . ]. )
TACHE
DU
CR
YSTA LLIN ,
(
Míduint . )
j'entends
par
tache du ··ryjlallin,
une efpece de cicdtrice qui eft
commun~mcoc
blanche , qu'oo remarque fur
la
fu–
perlicie,
&
qui bl ell e la vue.
Elle efi le plus louvenr la fuice d'un rres-perir abf.
d:s ou puftule qui fe forme fur la fuperlicie du cryf–
tallin, done l'humeur écanr en rres-pecire quancicé
&
b~nigae,
fe réfouc
&
fe confomme , fans caufer d'au–
tre alréracion au cryftallin, que celle du lieu oti cecee
Jletice pufiule fe erouve;
&
ret endroir du cryfiallin
fe-
cicarrafe enfu ice .
Dans fon commencement , on la connoic par un
nuage fort
léger qui paro?c fur le cryfiallin,
&
par le
tapporr du
rnala.lequi fe pfaint que
fa
vue eft brouil–
lée; dans la fui ce ce nuage deviene plus
~país,
&
blanchir enfin .
On ne peor cependant dans
les
premiers mois affu–
rer poficavc:menc que ce ne foic pas le commence–
ment d'une cacaraéle, ou d'u ne ulcération ambulante
du cryftall in , paree qu'on ne peuc juger de la nacure
de la pufiule; mais c¡uand apres un, deux ou crois
ans, cecee
tache
rene dans le meme érnc, on peuc pro–
bablement allurer qu'elle y refiera couce'la vie .
Quand
c~cee
tache
e(l blanche , on la voic aifément,
&
quand elle en noiracre ou rres-fuperlicielle , on
ne la peur di(linguer; mais oo conjeélure qu'elle y
e fi par le rapporr du malade .
SeIon l'endroir que cecee
tache
occnpe, les mala–
des femblcnc voir devane l'rei l,
&
en l'ai r, un nuage
qui fui e l'reil en cous les lieux ou la vue fe porte .
Les malades en fonc plus ou moins incommodés,
fuivanr qu'elle ell plus grande, ou plus perite , ou
pl us profonoe, ou plus fuperlicielle.
Les
t6ches
Ju cryfiallin ne s'etfdcenc point , ainli les
remedes y fonc inuriles : elles n'augmencent point
~moins qu'elle ne s'ulcerent de nouveau;
&
elles ne
s'ulcerenc pas, f.1ns qu' il fe
farie
une nouvelle lluxion
d'humeurs fur cecee partie ; mais quand cela arrive ,
le cryfiallin s'ulcere quelquefois emieremenc ,
&
il fe
forme aínfi une cararaéle purulence, ou au-moins une
mixce qui tiene de la purulente.
(D.
1
)
TACHÉOG!tAPHIE, f. f.
(Ltttérat. )
on nppei–
Joir ainfi .:hez les Romains
1'
are d' écrire auffi vice
que l'on parle, par
le moyen de cercaines notes
donr chacune avoic
fa
rignilicacion parriculiere
&
défignée . Des que ce fecre c des notes euc
éc~
décou –
ven, il fur bien cc'lc perfeélionné; ildevim un efpece
d'écriture courance, donr cour le monde avoir la cié,
&
a
laquell~
on
excr~oit
les jeunes gens . L'empe–
reur Tite, au rapporc de Suécone, s'y eroir rendu
1i
habile, qu'il fe taifoic un plaifir d'y délier fes fecré–
taires
m~mes .
Ceux quien faifoient une profeffion
particuliere, s'appclloacnt en grec
~•)!;"~'"'"
,
&
en
TAC
latín
IIOt6rii
11
y
avoic
~
Rome peu de parriculiers
qui n' eullent quelque efclave ou alfranchi
exerc~
dans ce genre d'écrire . Pline le
jeune en menoit
roujours un daos fes voyages. Ils recueilloient ainli
les harangues qui fe fai loient en publ ic .
Plurarque acrrabue
a
Cicéron l'arc
d'écrire
en notes
abregées,
&
d'exprimer plufieurs mors par un feul
caraálere. Il enfdgna cec are
a
Tiron fon atfranchi ;
ce fue dans !'affaire de Carilina qu'il mir en ufage
cecee invcncion ucile, que nous ignorons en France,
&
donr les Anglois onr perfeélionné
1'
idée,
1'
ufage
&
la méchode dans leur langue. Comrne Cacon d'U–
rique ne donnoit aucune áe fes belles
haran~1es,
Cicéron vpuluc s'en procurer quelqucs -unes . .l"our
y réuffir, il
pla~a
daos dtfférens endroits du fénat
deux ou rrois perfon nes qu-'il avoir fiylées lui-menut
dans l'art
tachtogr6pbique,
&
par ce moyen il eur,
&
nous a conlervé
le
fame ux difcours que Caron
prononc;a conere Céfa r,
&
que Sallufie a inféré daos
fon birfoire de Catilina: c'efile feul morcea u d'élo–
quence qu i nous refie de ce grand homme.
(D.] . )
L'arr
tllcbéogrllphiqt~t
efi eucore en ufage en An–
glererre .
TACH/ -1/0L/CAT/,
(
Grogr. mod. )
bourg de
Grece daos
1•
Macédoi ne ; Nardos croir que c'eft
l'ancienne GyrronP .
( D.
J.)
TA-.:HYGRAPHIE, f. f. (
Litttr•t.)
la
tacbygrll–
phie
ou
tacbiographie ,
na role co npofée des mors
grecs
T..... ,
viu
,
& ,.,••• ,
i crittlre,
etl l'arr d'écri–
re avec
d
adicé
&
par noces; elle eft auffi quelque–
fois nommée
bracbygrapbie
de
ll•¡oa•r ,
&ourt,
&
,,.,.,
j'f&ris,
en ce
qu~
pour écrire rapadement,
il
fa ut le ferv ir de manieres abregées.
Au{fi les Anglois qui fon t céux de rous les peu–
ples du monde qui s'en fervent le plus généralemenr
&
y onc fa ir le pl us de progres, l'appellenc-ils ele
ce nom
sbort-b11nd,
main brieve, cource écrirure ou
écrirure abregée.
,
Htrman Hugo
d01rs
.fon trait; , de primo {crib. origi11.
en accribue
l'~nvenr•on
au x H.!breux , fonUé fui" ce paf–
fage du
pjeaume xliv. L i11g11a mea calamus f&rib.t vt–
lociw· {cribmtis .
Mais nous ferons voir, en parlanr du
ll&tariacoll ,
que leurs
abréviarions fonc beaucoup plus
modernes, puremenr
Chal.la·iques,
&
invencées par
les rabins, long-rems apres la denruélion de Jérufa–
lem .
Cependanr les anciens n'ignoroienr 'p\>inr
ce
e art.
Sans remoncer aux Egypciens, done les hiérogly phe!
éroienr plurll r des fym boles qui repréfencoienr des
erres moraux, fous l'unage
&
les propriétés J'un écre
phy!ique . Nous rrouvons chez les Gre06 des cachéo–
gra2hes
&
femmeiographes, comme on le peuc voir
en Diogene Laerce
&
aucres aureurs quoiqu'i\ raifon
des nores ou caratleres finguliers done ils écoienc obli–
gés de fe i'ervir, on les
a
ir afrez généra lemenr confondus
avec les crypcographes.
Les Romaios qui avec les dépouilles de la Grece
rranfporcerenc lt ares en Ica lie, adoprerenr ce genre
d'écrirure,
&
cela pcancipalement, paree que fouvent
les difcou rs des féooceurs éroienr mol rapportés
&
en –
core
plus ma l incerprecés , ce qui occafionnoir de la
confuJion
&
des débars en allane aux voix.
C'eft fous le con fu lar de Cicéron qu'on en voit les
premieres traces. T iron, un de fes atfranchis, prit
moc
~
mor la harangue que Cacon prononsoir concre
Cncilina ; Plucarque djouce qu'on ne coanoafToic poinr
encore ceux qui depuas onr écé appellé
notaires,
&
que c'efi le premier exemple de cecee nacurc.
Paul D acre, cependanc atcribue l'invencion .des
premiers
CIO
caraélere~
a
Ennius .
&
die que T iron
ne lic qu'étendre
&
perfetlaonner cetre fcience .
Augufie charmé de cccre décnuverce, deftina plu.–
tieurs de fes atfranchis
a
cer exercice; leur uuique
emploi étoit de crouver des nores. JI falloir mCme
qu'elles fu(Jenr forc arbicraires
&
dans le goOc de
celles des Chino• , puifqu'elles excédoienc
le nom–
bre de cinq mili
e .
L'hiftoire nous a confervé le nom de quelques-uns
ele ces rachygraphes, rels que Perunius , Pilargirus,
faunius
&
Aquila, atfranchis ele Mécene.
Enfin .Seneque y mir la derniere main en les rédi–
geant par orelre alphabécique en forme de diaionnai–
re; aof!i furenr-ell es appellées dans la fuire
les nottJ
tlt
Tiro11
&
de Senet¡ue.
Nous remarquerons
a
ce
fujer contre l'opinion
du
{aVIms ,
que les caraéleres emoloyés dans le pleau–
ner, que
Tritbeme
trnuva
~
StrJsbourg,
&
done il
donne un échanrallon
a
la fin de
fa
polygraphie, ne
fau-
















