
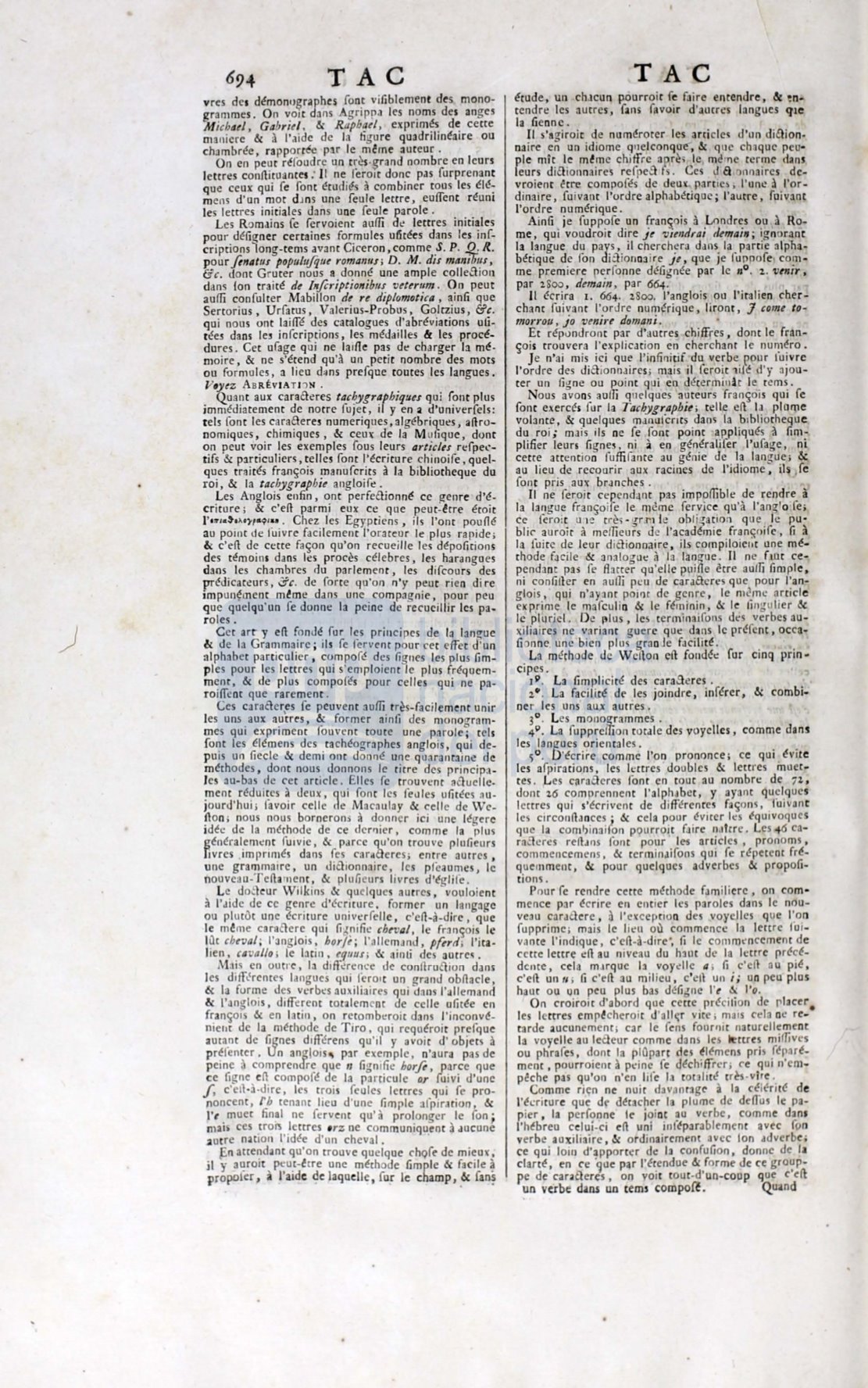
)
TAC
vres des démonographes font vifiblement des mono–
grammes. On voat dans Agrippa les noms des anges
M ici)(Jtl, Gabriel ,
&
Rapb~tl, exprim~ d~
cette
maniere
&
l
l'aidc de la hgure quadnhnéaare ou
chambrée, rapporrée par le
m~me
auteur .
On en peut réloudrc un tres-g-rand nombre en lcurs
lettres conllituantes :
11
ne leroat done pas furprenant
que ceux qui fe font éturlilfs
il
combiner tous les élé–
mcns d'un mot dJns une feule lettre, eufrcnt réuni
les lettres iniciales dans une feule parole .
Les Romains fe fcrvoient aulli
d~
Jemes iniciales
pour
défi~ner
cerraines formules u6tées daos les inf–
criptions 'long-tems avanc Ciceron, comme
S. P.
!).
R..
pour
filltltllr popult¡fi¡llt roman11r; D. M. dir m11ntli11r,
&c.
dont Gruter nous
a
donné une ample colletlion
daos Ion traité
dt !lfflriptiollibru veurum .
On peor
aulli con fulter Mabillon
dt re diplomotica,
ainli que
Sertorius, Urf.1tus, Valerius-Probus, Golrzius ,
&c.
qui nous ont laifré des catalogues cl'abréviations uli–
rées daos les infcriptions , les médailles
lt
les procé–
dures. Cet ufage qui ne laalle pas
d~
charger la mé .
moire,
&
ne s'éteod qu'il un pcrir nombre des mors
ou fo rmules, a lieu
d>~ns
prefque toures les langues.
V•¿ez
Au.tvJATJ'lN .
Q_uanr aux caraéleres
tachygrafbiquu
qui font plus
immédiatcmenr de na rre fuj et , i y en a d'univerfels :
tels fo nt les caraéleres numeriques, algébriques, a(\ro–
nomiques, chimiques ,
&
ceux de la M ulique, dont
on pcut voir les exemples fous leurs
tJrticlu
rcfpe•·–
tifs
&
particuliers, telles font l'écrítu re chínoife, quel–
ques traítés
fran~ois
manufcrits
a
la bibliotheque du
roí,
&
la
tacbygrapbit
a11gloífe.
~es Angloi~
enfin,
~nt
perfeélíonné ce f!Cnre d'é–
c rature;
&
e e(\ parma eux ce que peut-ltre étoit
1'•••·)·"')'1•9•~•
..
Chez. les Egyptíens ,
ils
l'ont poullé
au poant de fuavre faca lement l'orareur le plus rapide;
&
c'e(\ de cette fac_;o n qu'on recueílle
les
dépofitions
des témoíns daos les preces célebres, les harangoes
dans les chambres du parlemenr
1
les difcours des
prédicateurs,
&c.
de for re qu'on n'y peut ríen dire
impun~ment m~me
daos une compagnie, pour peu
que qoelqu' un fe donne la peine de recueillir les pa–
ro/es .
Cet art'
y
e(\ fnndé fur les príncipes de fa lanuue
&
de la Grammaire
¡
ils fe ferven t pour cet effet d'un
alphabet particulíer , compofé des ligues les plus lim–
pies pour les lettrel qui
s'~mploient
le plus fréqoem–
menr
1
&
de plus compolt!s pour celles qui ne pa–
roafreot que rarement .
Ces caraéleres fe peuvenc aulli tres-facílement unir
les uns aux au 'tres,
&
former ainfo des monourom·
mes qui exprimem fouvent touce une paro!e
'j'
tels
font les élémens des tachéographes anglois
q_uí de–
p uís un liecle
&
demi ont donné une quaraa',raane de
mérhodes , done nous donnons le títre des principa–
les au-bas de cet article . Elles fe
trouvent aéluelle–
ment réduites
a
deux
1
qui font les
fe<~
les ulitécs au–
jnurd'huí; lavoír celle de Maca ula
y
&
celle de We–
floo ; nous nous borneron>
a
donner icí une légere
idée de la méthode de ce dernier , comme la plus
généralem<nt fuavíe,
&
pdrce qu'on rrouve plolieurs
fi vres ,impramés daos fes caraaeres; entre autres
une grammaire, un díélionnaire
1
les pfeaomes,
1~
nouveau-Tellarnent,
&
plulieurs livres d'églile .
Le doa eur
Wilkins
&
quelques autres
1
vouloíent
a
1
1
aide de ce
gen.red
1
écr!ture , former un langage
ou plut8t une
écmur~
unav.erfelle, c'ell-a-dírc , que
le méme caraélere qua
ligmlic
chtvtJI,
le
fran~oís
le
IOt
cbeval ;
l'anglois!
borjt
¡
l'allemdnd,
p{trd;
l'í ta–
laen,
.ctJvallo;
le lann
1
equus ¡
&
aínli des
aotre~ .
Maas en outre, la
daff~rence
de confiru
ion dans
les
diff~rcntes
langucs qui J'ero•c un urand obllacle
&
la forme des verbes auxílíaíres quí 'dan l'allemand
&
1
1
angloís
1
different totalement de celle ufitée en
franc.;oas
&
en latín, on retomberoit daos l'inconvé–
niea•t de la méthode de Tiro , qui requéroít prefque
auta.ntde lignes dafférens qu'ol
y avoít d' objets
a
p rélentcr . Un
angjoas ~
par exemple, o'aura pas de
peine
~
comprendre que
n
fignífie
borfi,
paree que
ce figne e(\ compofé de la pa rtícule
or
fuiví d'une
.f,
c'ell·a-dire, les trois feules Jemes quí fe pro–
noncenc ,
f b
tenant lieu d'une limpie afpiration,
&
l't .
muet
fin~l
ne fe rvent qu' a prolonger
le fon .
mali ces rrors lettres
trz
ne communiquent
a
aucune
.autre nation l'idée d'un cheval .
·
_En
atte~dant
qu'on crouve quelque chQft' de míeux
1
jJ
y
auroat peut-ftre une méthode limpie
&
fa cile
a
propoí r '
a
l'aide de laquelle. fur le champ ,
_&
fao~
TAC
étude, un chJcun pourroic fe faire encendre,
&
~O·
cendre les 3Utres, fans favoir d'aucres langues CJle
la fiennc .
11
s'agiroít de numéroter les arricle< d'un díélíon–
naire en un idiome qnelconqúé",
&
que ch1quc pcu·
pie mit le
m~me
chíffre a re> le me·ne tcrme daos
leurs díélionnai res refpe
ls. Ces d•a onnaires dc–
vroient ecre compofés de
deu~
parne; , l'unc
~
l'or–
dinai re, fu ivant l'ordre alphabétiqoc ; l'autre, fuivanc
l'ordre numérique .
Ainfi
je fuppofe un fran'iois
a
Londres ou
~
Ro–
me
1
qui voudroit díre
je vtmdrtJÍ tlmttJÍII
¡
ignoran
e
la langue du pays , il cherchera dans la partie alpna–
bétíque de fo n díélionoaire
je
1
que je funp ofe conl·
me premiere re.rfonne défignée par le
n°.
1..
wnir.
par
1800 ,
dtmam ,
par
664.
11
écriro
l.
664- 2800.
l'anglois ou l'italien coer–
chant fuivant l'ordre
nom~ríque,
liront ,
J
come to-
tlloo·rou
1
jo venil't tiomtJIIi .
•
Et répllndront par d't1utres chilfrcs , done le fran–
~oís
trouvera l'explíca tion en cherchant le numéro .
J e
n'ai
mis
ici
que l'ínfinítif du verbe ppur l'uívrc
l'ordre de díélaonnaírcs; maís il feroit 1ifé
d'y
ajou–
ter un
ligne ou poinc qui en détermí ni c le tcms.
Nous avons aulli qnelques auteurs
fran~ois
quí fe
font exercés fur la
TachygrtJphit ;
celle e(\ la piO'lle
vo13nte
1
&
quelques manut'crats dans la bahliotheque
du roi; mais íls ne fe font point appliqués
~
lim–
plífier leurs lignes . ni
a
en généralifer
1
1
Ufage' ni
cette attentioo fuffi fante au génie de
la
lan~ue;
&
au líeu de recourir aux racines de l'idiome:
¡¡,
.fe
fon t pris aux branches .
11
ne feroít ce¡>rndant pas ímpollible de rendre
a
la langue
fran~oife
le n¡eme fervice qu'a l'anglo•fe;
ce
feroit u
le
ere> - <rr
nl
le
ohl i~a tion
qu e
le pu·
bl ic
auroit
a
mellieu~s
de l'académie
fra n~oi fe
1
li
il
la li1irc de Icor diélionnaíre
1
ils co¡npíloiea;t une mé·
thode facile
&
analogu.:
i\
la langue. ll ne f lllt ce–
pendant pas fe flatter qu'elle p¡aíl1e etre auiTi fim ple,
ni confiller en auai pcu de caraelere que pour l'an–
gloís
1
quí n'ayant poinr de genre, le
m~me ~ rtícle
eKpríme le mafculin
&
le fémínin,
&
le lingulíer
&
le plqriel . De plus , les cerminaifons
d~s
verbes au–
xilíaires ne variant guere que daos le préfent
1
ocq–
íi nnc. une bien plus graoJe fJcil ité .
La méchode de W eflon cll fondét:
fur cínq prin •
cipes.
¡ P,
La limplicité des caratleres .
:¡,•.
La facil ité de les joindre , inférer
1
&
combi–
oer les uns au..x autres.
3° . Les monoo-rammes .
4P.
La fuppreffion tutdle des voyclles, comme daos
les langues orientales.
s
0 .
D'écrire comme l'on prononce; ce qui évíte
les afpira tíons, les lcrtres doobles
&
lem·es
inuet·
tes . Les
c~raéleres
fo nt en tout au nombre de 72 ,
done
1.6
comprennent
l 'alph~bet ,
y ayant
qu~lques
lettres quí s'écrivent de différenres
fac_;ons, fuivan t
les circonllances;
&
cela pour o!vírer les
~quavoques
que la com?inaílon pqurroit faire na!trc. Les
-46
ca–
ra.:!eres rellJns fon t pour ' les artícles
1
pronoms ,
commencemens ,
&
terminaífons qui fe répetent fré–
quern ment,
&
pour quelques adverbes
&
propoíi–
tions .
Pnur fe rendre cette méchode famílíere
1
on com·
menee par écrire en entaer les paroles daos le nou–
veau caraélere ,
il
l'exceproon des voyclles que l'on
fupprime; mais le
la~n
oil commence la
lettre J'ua–
vaote !'indique, c'ell-3-díre·, íi le
comro~ncement
de
cctte Jeme di au níveau du haut de la lettre
préc~dcnte, cela mJrque la voydle
tJ ;
fi
c'ell au pié,
c'eft un
11 ;
li c'e(\ au milieu
1
c'ell un
i;
un peu plos
haut ou Qn peu plus bas défiJne
l't
&
l'o.
O n croíroit d'abord que cene précilion de placer
les lettres
emp~cheroit d'all~r
vate ; maas cela oc re- •
carde aucunemenc; car le feos foornar narurellemenc
la voyelle au leaeur comme daos les
~ttres
millives
ou phrafes, done la piOpare des
~lémens
pris féJ>aré–
menc. pourroient
a
pdne fe déchi ffrcr; ce qui n'em–
peche pas qu'on n'en lífe la tOt1lité
cr~- vlre
.
Comme ríen ne nuít davanrage
a
la céléríté de
l'écriture que de déracher la plome de defiüs le pa–
pier
1
la perfonne
le joint au verbe
1
comme danr
l'ht!'breu celuí-ci e(\ uní
inléparablernent avec
fpn
verbe auxíliaire,
&
ordínaírement avec Ion ddverbe;
ce
qui
loín d'apporter de
la
confufion, donne de
J¡
clareé
1
en ce '9ue
p~r
l'étendoe
&
forme de ce group–
pe de caraéleres, on voit tout-d'on-coup que c'e{l
un verbe daos un tems compoí!.
Quaod
















