
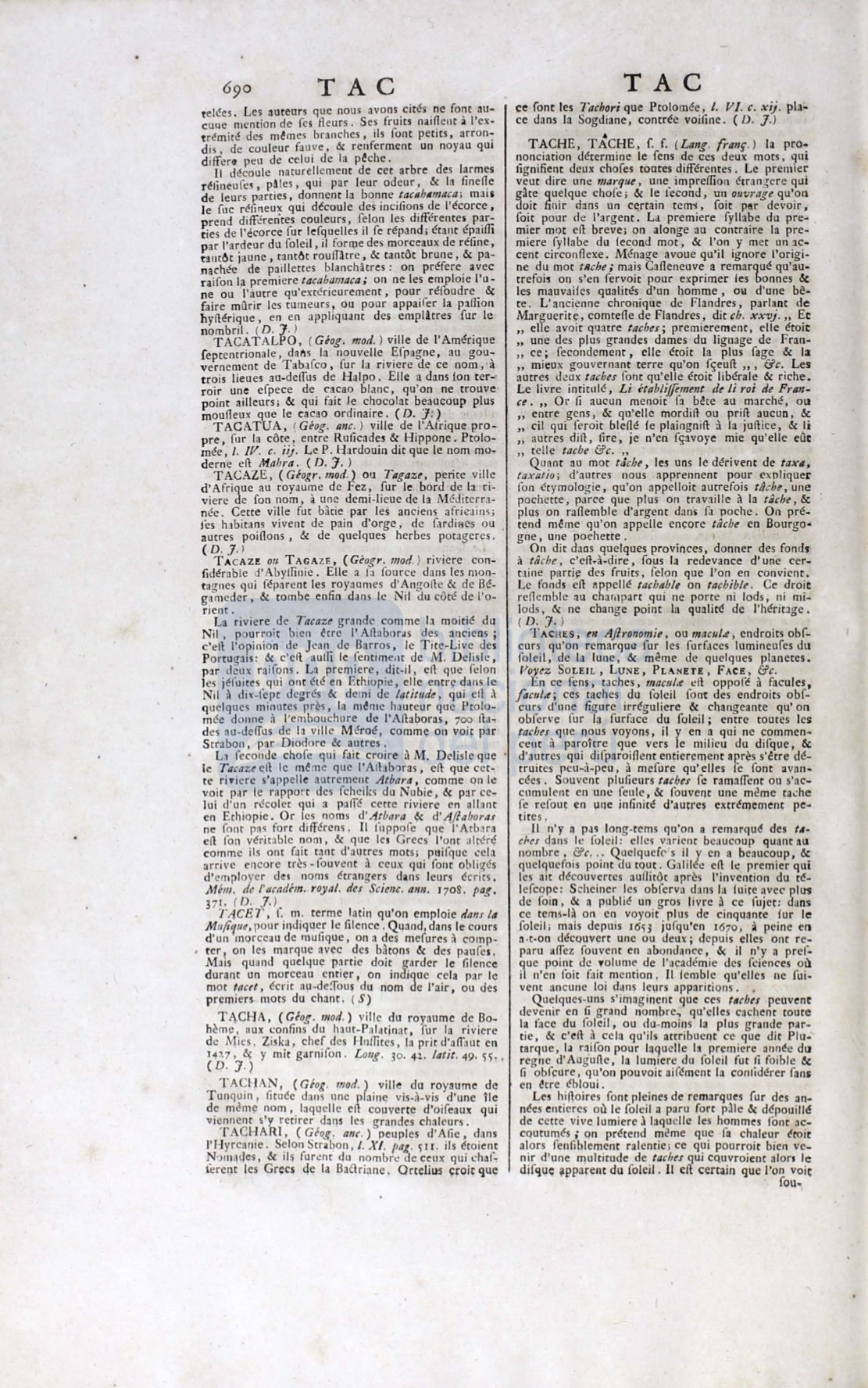
TAC
telées . Les autenrs que noos avons.cités .ne
fo~t
,au–
cuQe mentían de fes f!eurs. Ses frUits na1flent a l ex–
t rémité des
m~mes
branches , lls font petits, arron:
dis de couleur fa uve ,
&
renferment un noyau qu1
differ4 peu de celui de la
p~che.
11 découle naturellemenc de cec arbre des !armes
rélineufes , p! les, qui par leur odeur,
&
la finefle
de leurs parties, donnenc la bonne
ttullhllmaca;
maiS
Je fue
réfineu~
qui découle des incifion.s de l'écorce,
prend différences couleurs, felon les d¡fférences par–
ties de l'écorce fur lefquelles il fe répand; étallt épaiffi
par t•ardeur du foleil, il for<Ve des morceaux de réfine,
unt6t jaune, rant6t rouffhre ,
&
tantllt brune ,
&
pa–
nachée de paillettes bJanchft tres: on préfere avec
raifon 1¡1 premiere
tacahomaca;
on ne les emploie !'u–
ne ou l'aucre qu'exrérieurement,
pou~
réfbudre .
&
faire mOrir les cumeurs , ou pour appa1rer la paflton
hyllérique , en en appliquanc des
emplitr~s
fur le
nombril .
( D .
J .
l
TACATALPO,
(
G6og. mor/.)
vil~e
de 1'Amérique
feptencrionale, da lis la nouvelle E!pagne, au gou–
vernement de Tabafco, fur la riviere de ce nom,
a
erais licu es au-deffus de Halpo . Elle a dans [on ter-•
roir une efpece de cacao blanc, qu'on ne crouve·
point aillcurs ;
&
qui fait le chocolar beaucoup plus
moufleux que le cacao ordinaire.
(D.
] : )
TACATUA, (
Géog. anc.)
ville de l'Afrique pro–
pre, fur la cllte, entre Rulicades
&
Hippone. Pcolo–
mée, 1.
/17.
c. iij.
Le P. Hardouin die que le nom mo-
derne ell
M
abra.
(D.
J.
)
·
TACAZE, (
Giogr. mor/. )
ou
Tagau,
p'etite vil le
d'Afrique au royaume de Fez, fur le bord de
la
ri–
viere de fon nom,
a
une demi-lieue qe la Méditerra–
née. Cecee ville fue barie par les anciens afrieai ns;
fes hJbicans vivent de pain d'orge, de
fardi~<es
ou
aueres poiflons ,
&
de quelques herbes pocaseres .
(D .
J. l
TAc AZ!
011
TAGAZE, (
GfoJr· mod. )
riviere con–
lidérable d'Abyllinie. Elle a la fource dans les mon–
taanes qui féparent les royau mes d'Angofle
&
de
13~ga"meder,
&
tombe enfin daos le Nil du cllté de l'o–
rient.
La riviere de
Tacau
g rande comme la moitié du
Nil , p urroit bien
~ere
l'
Allabor~s
des ancicns
¡
c'elt l'opinio'n de J ean de llarros , le Tite-Live des
Porcugais:
&
c'efl autli le fen cimem de M. D elislc,
por dcux raifons. La premiere, dit-i l,
ell:
que felan
les jét'uires qui ont été en Erhiopie, elle
enrr~
cjans le
Nil a dix-fept degrés
&
demi de
l(¡tiwde,
qui en :\
q uelques minutes pres, la
m~me
hauceur que Peolo–
mée donne
a
l'embouchure de l'Ailaboras,
700
fia,
des au-deffus de la vi ll e Méroé , commc; on voi> par
Srrabon , par Diodore
&
autres ,
La feconde chofe qni fait croire
a
M. D elisle que
le
Tacau
<;ll le meme que 1'Altaboras, ell que cee–
te
ri•iere s'appel le aurremenc
Atbarlf,
comme on
l~
voie par le rapport des fcheiks du Nubie,
&
par ce–
luí d'un récoler qui a paffé cerce riviere en allane
en Erhiopie. Or les noms d'
.Atbqt·a
&
d'
A/laúorar
ne font pas for r différens. ll fnppofe que -,,1\tbara
ell fon véricablc nom,
&
que les Grecs l'onc
altér~
cornme ils ont fait tanr d'al)tres moes; puifq ue .:ela
arrive encare
cr~s-
fouven t
a
ceux qui fonc obligés
d'ernployer
d~s
noms étrangers dans leurs écrirs .
M ém, de /'acadhn. royal. des Scie>tc. arm.
1708.
paff.
371.
( D.
J. )
T/ICET,
t'.
m. terme latiq qu'on emploie
r{ans la
Mufirue,
pour ir¡djql¡er
1~
filen ce. Quand, dans le cours
d'un mqrceau de rnulique, on a de$ mefures :\ comp–
tcr
1
oq les marque
~v~c
des batqns
&
des paufes ,
M a1s quand quelque ¡¡arríe doit garder le filcnce
dur~nt
un morceau entier, on indique cela par le
mor
Mett,
écrit
a~-de~ous
du nom de l'air, ou des
premiers. mots du chane .
( S)
Tll,CHA,
(G6og. moti. )
ville du royaume de Bo–
hem¡:, aux confins du haur-Palatjnat , fu r la n v1ere
de Mies , Ziska , chef des H.uffires , la prit d'a ffilll t en
1
4'-7,
<'!\
y
mir garqifon .
Lo11g.
30.
42.
latit. 49·
H , .
(D .
J.)
T A
e;~~
AN , (
Gtog. mod. )
vil le du royaume de
Tunqum,
li tu~e
dans une plaine vis-a-vis d'une !le
de
mem~
nom, laquell e efi couverte d'oifeaux qui
viennenc s•y retirer
d~qs
les grapdes chaleurs.
TA,CHARI , (
Gér¡g, anr. )
peupl~s
d'Aiie, dans
l' Hyrcan1e. Selon traban, /.
X I. pag.
\'1!.
ils étoient
J;Jom~cjes,
&
ils
fur~nc
qu
nombre.!
a
e
ceux qui chaf-
1erent les
Gr~cs
eje la l3a6triane . Qrcelius HOit que;
TAC
~:e
font les
Tachori
que Ptolomée,
l. V/.
c. xij.
pla–
ce dans la Sogdiane, contrée voiline.
(D.
J. )
TACHE, TACHE,
f.
f.
(La11g. franf. )
la prQ•
nonciation dérermine le fens de aes deu>C mots , qui
lignifient deux chofes toares différences . Le premier
veut dire une
marque,
une. impreffion érran5ere qui
gace quelque chofe;
&
le lecond, un
otwrage
qu'on
iloit fin ir dans un certain tems,
[oit
par devoir,
foit pour ele l'argenr. La premiere fyllabe du pre–
mier mor ell breve; on alonge au contraire la pre–
miere fyllabe du fecond mor ,
&
l'on y mer un ac–
cent circonflexe. Ménage avoue qu'il ignore !'origi–
ne du mor
tllche ;
mais Cafleneuve a remarqué qu'au–
trefois on s'en J'ervoic pour exprimer les bonnes
&
les JTlauvaifes qualités d'un homme,
011
d'une be–
te .
L'
ancienne chronique de Flandres, parlant de
Niarguerire, comrefle de Flaodres , die
&h.
x xvj.
,
Ec
, elle avoit quaere
tacbn ;
premierement, elle éroic
, une des plus grandes dames du lignage de Fran–
" ce; fecondemene , elle éroic la plus fage
&
la
, mieux gouvernant terre qu'on fgeufi ., ,
&c.
LeJ
autres deux
tadJer
tone qu'elle éroit libérate
&
riche.
Le livre intitulé ,
Li
ét(lb/
i.Jfo.me~~t
rle
li roi de Fran–
ce
. ,
Or
(¡
aucun menoic fa
b~te
au marché , ou
,. entre gens,
&
qu'ellc mordifl ou prill aucun,
&
,. cil qui feroit bleílé le plaingnill
ii
la jullice,
&
li
" autres dill , 6re. je n'en
f~avoye
mie qu'elle euc
, cellc
tacbe &c.
,.
Quant au mor
táche,
les uns le dérivent de
tax11,
ta:ratio;
d'autres nous npprennent pour expliquer
Ion érymologie, qu'on appelloir autrefois
tltche,
une
pochette, paree que plus on travaille
a
la
tiicbe,
&
pl\ls on raflemble d'argent dam fa poche . On pré–
tend mEme qu'on appelle encare
t!tche
en Bourgo•
g ne , une porhette .
On dit daos quelques provinces, donner des fonds
a
tlic/Je,
c'e(l.i\.dire, fous la redevance d' une cer–
t:tine
pnrei~
des fru its, felon que l'on en conviene.
Le fonds efi
~ppellé
{achttbl,
on
tafhible.
Ce droit
refl emble au
chan¡p~rt
qui ne porte ni lods, ni mi–
lods,
&
ne change point la qualité de l'héritJge.
( D.
'J ,
l
TACHES,
m
Aflronomie,
ou
macul.e,
endroits obf–
curs qu'on remarqu<i fur les furfaces lumineufes du
loleil, de la )une '
&
m
eme
de quelques planeces.
Vo)lez
SoLEIL , LUNE, PLANI!TI!, FAC:I!,
&c.
En ce fens, caches,
mactJI.e
~ll
oppofé
a
facules,
focul.e;
ces taches qu foleíl font des endroits obf–
>urs d'l¡ne fig ure irréguliere
&
changeante qu' on
obferve fur
1~
furface du foleil ; entre couces les
tacbu
q\le nous
vqyons,
il y en a qui ne commen–
cenr
a
parolrre que vers le milieu du difque,
&
q'aucres qui difparoiflenr en¡ierement apres s'etre dé–
cruires peu-a-peu,
ii
mefure qu' elles fe fonc avan–
cées. Souvenc plufieurs
ta<hes
fe rama!Tent ou s'ac–
cnmul ent en une feule'
&
[ouvent
une meme ta.:he
fe refou¡ eo pqe infinité d'au¡res extrémement pe•
~jres ,
ll n'y q pas long-cems qu'on a remarqué des
fll–
cbu
clans le foleíl : elles varienr beaucoup quanc au
nombre,
&e, ..
Quelquefc 's il y en a beaucoup,
&
quelquefois poinc
a
u rouc . Galilée ell 1.:_ premier qui
les ait découverres auOirl)c apres l'invention du cé–
lefcope : Schciner les obferva dans la fui te avec plllS
de foin,
&
q
p~blié
un gros !ivre
it
ce fujec: daos
ce
terns-1~
on en voyoit pi us de cinquance {ur le
foleil ; mals depuis
161'3
jofqu'en
1679·
a
peine en
a-t-on découvert une ou deuy; depuis elles onc re–
paru affez fouvenc en abontlance,
~
í1
n'y a prel–
que point de ,olume de l'académie des [cíences ou
i1
n'en foit fai t mention , l1 femble qu'elles ne fui–
venc ancune loi
d~ns
le\lrS apparitions. .
Q uelques-uns s'imagincnr que ces
{11cbN
peovent
devenir en
ü
grand nombre, qu'eJies Cijchent toute
la face du loleil, o u du-moins la plus g rande par–
tie ,
&
c'ell
a
cela qu'ils amibuene ce que dit PIu-'
carque, la raifon pour
l~qoelle
la prcmiere année du
regne d'Augulle, la lumiere du foleil fue li foible
&
li
obf¡:ure, qu'on pouvoir aifément la conlidérer fans
en
~ere
ébloui .
I.,es hifioires fon t pleines de remarques fur des an–
nées enrieres ou le fol eil a paru forr paJe
&
dépouillé
de cecee vive lumiere
a
laquelle les hommes lonc ac–
cqucumés • qn préeend meme que fa chaleur éroit
alors fendbtemenc ralencie; ce qui pourroit bien ve–
nir d'une n¡ulricude de
tachu
qui cQuvroient alors le
difqu~ ~pparenc
du foleil. 11 cfi certain que l'on voit
fou..,
















