
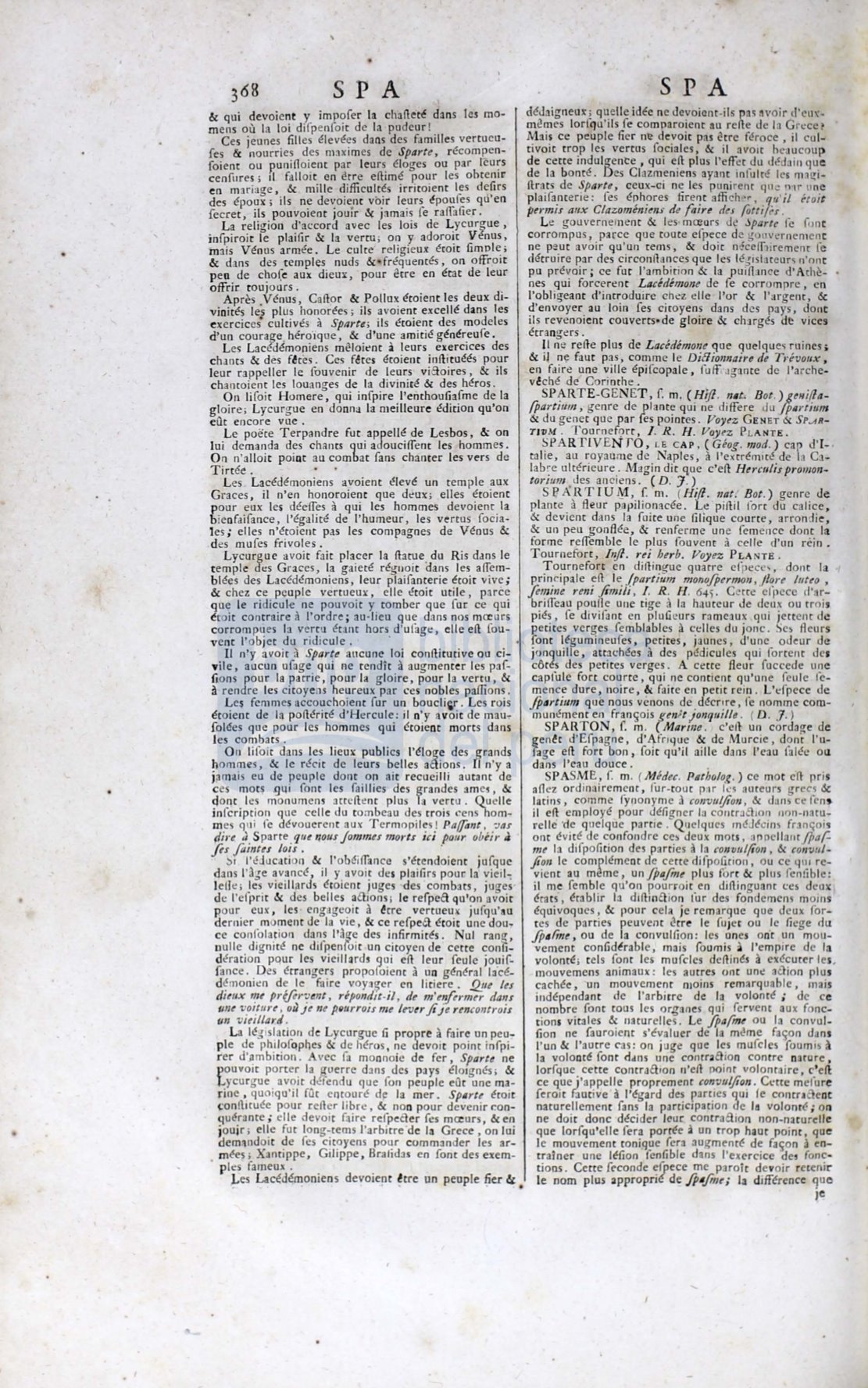
S P A
&
qui devoient
y
impofer la
cha!let~
dans les mo–
mens ou la loi difpen(oir de la podeur!
Ces jeunes filies élevées dans des familles verrueu–
fes
&
nourries des m3ximes de
.S
parte,
récompen–
foienr ou P.unifloienr par leurs éloges ou par
léu~s
cenfnres; 11
falloir en erre enimé pour les ohremr
en mariaae ,
&
mil le difficultés irriroient les defirs
des
épou~;
ils ne devoient voir leurs époufes qd'en
fecrer, ils pouvoient jourr
&
jlmais re raffafier.
La religion d'accord avec les lois de Lycorsue ,
infpiroir le plaifir
&
la vercu ;
o~
y
adoro~t
Venus,
tnaís Vénus armée. Le culee rellg•eox étOJt fimule;
&
dans des temples nuds &•fréquentés , on offroi r
pe11 de cho(e aux dieux, pour erre
en
érat de leur
olfrir roujours.
Apres ,Vénus, Canor
&
Pollo~
éroient les deux di–
vioirés les plus honorées; ils avo1enr excellé dans les
exercices cultivés
3
Spnrte;
ils étoienr des
mo~eles
d'un courage, héro'ique, & d'une amirié généreufe.
Les Lacédémoniens meloit>nt
a
leurs exercices des
chanrs & des
f~res.
Ces fdtes éroient in!liruéés pour
leur rappeller le fouvenir de leurs vi oires, & ils
chanroient les louanges de la divinicé & des héros .
On lifoir Homere, qui infpire l'enrhouliafme de la
gloire; Lycurgue en donna la meilleure édition qu'on
eOt encore vue .
Le poete Terpandre fue appellé de Lesbos,
&
on
fu i demanda des chants qui adouciffenr les hommes.
O n n'alloit poior au combar fans chanrer les
vers
de
Tirrée.
Les Lacédémoniens avoienr élevé un temple aux
Graces, il n'en honoroient que dt>ux; elles éroient
pour eux les déeffes
a
qui les hommes devoienr la
b ieafaifance, l'égalité de l'humeur , les verrus (ocia–
les; elles n'éroient pas les compagnes de Vénus &
des mofes frivoles.
Lycurgu e avoit fait placer la narue do Ris dans le
t emple des Graces, la gaieré régnoit 'dans les affem–
blées des Lacédémoniens, leur plaifanrerie
~ro
ir vive;
& chez ce pcuple \'ertueux, elle étoit mil e, paree
que le ridicule ne pouvoit y tomber que fur ce qui
étoir conrraire
a
l'ordre; au· lieu que dans nos mccurs
corrom pues 13 verru érant hors d'ufage, elle en fou-
venr l' objet du ridicule .
·
Il n!y avoit
a
Sparu
auaune loi confiirutive ou
ci–
vile , aucun ofage qui Ae rendir
a
augmenrer les paf–
fions pour la parrie, pour la gloire, pour la verru,
&
a
rendre les citoye s heureux par ces nobles paffions.
Les femmes accouchoienr fur un
boocli~r.
Les rois
éroient de la ponériré d'Hercule : il n' y avoic de mau–
ililáes que pour les hommes qui éroienc mores dans
les combats .
O n lifoir dans les lieux poblics l'éloge des gtands
}¡ommes' & le r.!cit de leurs belles aétions.
n
n'y a
j~mais
eu de peuple done
on
air recueilli auram de
ces
mor~
.glli (onr les faillies des g:randes ames, &
qom les monumens ane!leot plus la verru . Ouelle
infcriprion que celle du ro:nbeau des trois "ens hom–
mes qui
(e
dévouerenr aux Termopiles!
Paffont, "Jar
((ire
a.
Sparre.que
qotu Jommu mortr ici pour ob¿ir
4
fis fomtu lotr
.
·
~·
l'éJucatioo &. l'obéiffance s'érendoiem jufque
dans ¡•age
~v~ncé,
JI
yavo1~
des pla1firs pouc la
vieil~
!elle; les
vJeJII~rds
éco1ent ¡uges des combats , juaes–
de l'eíprit & des belles allions ; le refpea qu'on av"oit
P.OUr eux, leS · engageoit
a
~rre
vertueux ju(qu'au
dernier moment de la vie,
&
ce refpeét étoit une dou–
ce confolatioo daos l'aae des infirmités.
ul rang ,
oulle dignité ne dif'penf'oir un citoyen de cene con!i–
dérarion pqur les vieillards qui en leur feule joui("
fance . _Des
érnange~s
propofoiem
a
un général la'cé–
d~momen d~
le fiure
_voya~e~
en litiere .
Q!te les
dttiiX
"!'
P•·ift;"!ent, repo11rftt-tl , de m'e'!fermer da11s
IJ/Jt
v.o•.tm·e , ou ¡ene pourrou me /roer
ji
¡ e rmcontrois
u11
wetllartl .
La législation de Lycurgue fi propre
a
faire un pea–
pie de pbrlofqpl¡es & de héras, ne devoir poinr infpi–
rer d';rmbirion. vec fa moanoie de fer,
Sparte
ne
pouvoir
pone~
la guerre daos des pays élo•gnés;
&
L ycurgue avoJt déTendu que fon people eQr une ma–
rine '· quoiqu'il fUt ent?Uré
d~
la mer.
Sp11rte
éroit
conll•ruée pour rener libre, & non pour devenir r:on–
quéranre; elle devoit faire ref'peaer fes ma:urs,
&
en
joujr ; elle fur long-rems l'arbirre 'de la Grece on loi
dem~ndoit
de fes ciroyens poor commander Íes ar–
mées; Xanrippe, Gilippe, Bralidas en font des exem–
ples fameux .
).;es
Lac~démoniens
devoienr
~ere
un peuple fier
& •
S P A
dédaigneux ; quelle idée ne devoiant-ils pas
~voir
d'cux.
mi!mes lorfqu'ils fe comparoient au refle de la Gr<!ce
1
Mais ce peuple fier nlt devoic pas
~rre
féroce , il cu l–
tivoir
rr~p
les vertus
(ocia
les,
&
il aVOJt heuucnu¡>
de cene
mdul~ente
, qu• e.n plus
l'elf~t
_du dédain que
de la bonté.
u es
Clazmemens ayanr rnlulré les ma<>i–
nrats de
Sparte ,
ceux-ai ne les puoirenr qn n·tr ,;;,e
plaJfantene:
(es
éphores firent affieh'•,
'f.ll'il
ho#
pennir 111/X Clazomé11Ú1u de (aire dn
{ortif~r .
Le goovernement & les· mwurs de
:,parte
fe fon r
corrompas, paree que toute efpece de gouvernemcnr
ne paut avoir qu'un tems. & doic n<Ícefl'uremeor
re
dérruire par des circon!lances que les
lé~isiJceur.
n'nnc
pu prévoir; ce fue l'ambition
&
la puifl.mce d'l\the–
nes qui forcereor
Lacédémone
de fe corrompre, en
l'obligeant d'inrroduire
eh~"'
elle l'or
&
l'argent,
&
d'envoyer au loin fes ciroyens dans des pays, done
ils revenoienr couverts•de gloire
&
chlrgés de vices
écrangers .
11
n~
relle plus de
L'acMémone
que quelque< ruines¡
& il n¡: faut pas, comme le
Diflionnair~
de Trévo11x,
en faire une ville épi(copale, fuff Jaanre de l'arche-
véché de Corinrhe.
"
SP~RTE-GENET,
f'.
m.
(Hijl .
1111t.
Bot. )¡mi(la–
fpartmm,
genre de plante qui ne dilfere du
jp11rrimn
&
du
g~net
que par fes pointes .
Voyez
GENST
&
SP..-<R–
T!VM .
Tournef()rt , / .
R .
H. Voyez
PLANTE.
SPARTIVEN
ro'
LE CAP .
(Géog.
mod. )
cap d' l–
ralie, au royaume de
"a
pies,
a
l'extrém•té de la Ca–
lab;e ultérieure: Magín dit que c•en
Herc11lis promon–
torwm
des ancrens.
(D.
J.)
SI?A'R'I' fU i~1,
Cm. (Hip.
nat. Bot. )
genrc de
plante
a
tleur
papilion~cée.
Le pinil lort du cal ice,
&
deviene dans la fui te une filique courre, arronclie,
& un peu gon tlée,
&
renferme une femence done la
forme reffemble le plus fouvent
a
celfe d'un rcin .
Tournefort,
bif/.
ni herb. f/oyez
PLA TI!.
Tournefort en dillingue quan·e efjJece' , don e la
prin.cipale
~!l
le.
jpnrtium mono.fpernw11 ,
.fl~re
l11teo
,
flmme rent ./irmfl, l . R .
fl.
64\'.
C rte el pece rl'ar–
briffeau poufle une rige
a
la haureur de deux ou rrois
piés, fe divifant en pluGeurs
r~meaux
qui jerrent de
perites verges femblables
a
ce! les du jonc . Se; flcurs
(ont légumineufes, perites, jaunes, d'une odeur de
jonquille' attachées
a
des pl!dicules qoi forren e des
clltés des perites verges . A cene fleur (accede une
capfule fort courte, qui
ne
contiene qu'une feule fe–
menee dure, noire ,
&
faite en perit rein . L'"fpece de
Jiu•rtium
que nous vcnons de décrtre,
(e
nomme com–
munément en fran!iois
genl r
jo11quifle .
( D .
J.)
SPARTON,
C.
m.
(Marme .
c'efl un
cord~ge
de
gen~t
J•Efpagne, d'Afnque & de Murcie, donr l' u–
fage en forr bon' foit qu'il aille dans l'eau falée 0\1
daos l'eau douce.
.
SPASME,
f.
m.
( Médec. PatiJolog.)
ce mor e!l pris
aflez ordinairemenr, fur-rou r p·tr ks aureurs grec<
&
latins, comme fynonyme
~
convuljio",
&
dans ce (en,.
il
e!l employé pour déligner la corJtra 10n nnn-naru–
rellé ·de quelque parrie . Quelqucs
méJ~cins frao~ois
onr éviré de confondre ce; deux mors , appellanr
.fpa(–
me
la difpofition des parties
a
la
C011VtJ/fion,
&
COIJVIII–
jioiJ
le complémeat de cene difpofition, ou ce qu1 re–
viene au mi!me, un
.fpaj'me
plus ff>rr & plus fenfib le:
il me femble qu'on pourroir en dillinguanr ces dcox
é'rats, érablir la d1ninllion IÜr des fondemens moms
équivoques,
&
pour cela je remarque que deox for–
res de parties peuvem
~tre
le fu jet au le liege du
.fp•fine,
ou de la convollion : les
ones
oa'r un mou–
vement conuMrable, mais foumis
a
l'empire de la
volonté; rels font les mufcles de!linés
a
exécurer les.
mouvemens animaux : les autres oor une aélion plus
cachée, 'Un mouvement moins remarquable, mais
indépendanr de ('arbitre de la volonré
;
de ce
nombre fonr rous les organes qui fervenr au x fonc–
tions virales
&
narurelles . Le
JPafme
ou la convul–
fion ne fauroient
s'~valuer
de la
m~me fa~on
dans
(' un
&
('au rre
C'3S:
on juge que les mufcles (oumJ>
a
la volooté font ddns une controélioo conrre narure,
lorfque cerre
canrraél:~on
n'ell POinr volonraire, c'efl
ce que j'appelle propremenr
convuljion ,
Cl'tte me(ure
feroir
f.lotive
a
l'égard des parues qui fe conrr¡ ene
narurellement fans la participarion de la volonré ; on
ne doir done décider leur conrraaion non-narur.elle
que lorfqu'elle (era portée 2 un rrop haur poinr, que
le mouvemenr ronique
(era
augmenré de fa!ion
a
en–
rralner une lélion fenfible dans l'exercice <les fone–
tioos . Cene ff'conde elece me paroir devoir rerenir
le nom plus appropri de
./P".fou;
la dilférence que
je
















