
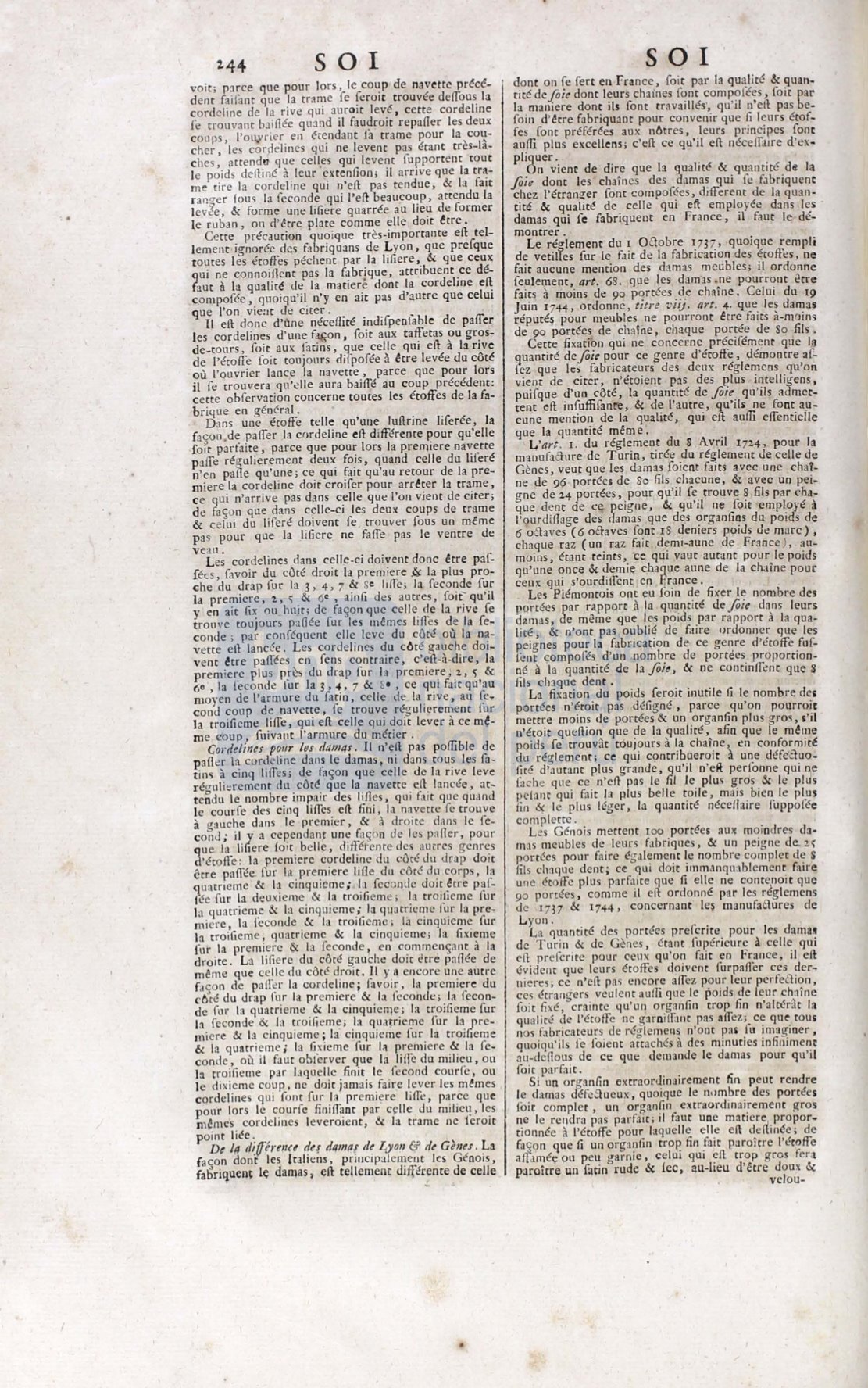
S O I
voir;
pa~ce
que pour lors, le coup de navette précé–
den r fai!ant que la trame fe ferOit trouvée de{fous la
cordcline de la rive qui auroir levé , cette cordeline
le rrouvant baillée q uand il faudroit repaller les deux
cou ps ,
l'ou,vrier en étendant la trame pour la cou–
cher , les cordelin
es qui ne levene pas érant tres-la–
ches, pttendu que
cell.es qui levenr fupporrenr tour
le poids del1iné
a
leur extenlion ¡ il arrive que la
tr~me tire la cordeline qui n'efi pas tendue ,
&
la fa1t
rann-er lous la feconde qui l'efi beaucoup, atrendu la
Jevée,
&
form e une liliere quarrée au lieu de former
le ruban , ou d'
~ere
place comme elle doir
~ere .
Cette précaution quoique tres-importante efi tel–
Jement ignorée
d~s
f:1briquans de Lyon, que prefque
roures les étotfes péchenr par la liliere ,
&
que ceux
qui ne connoitlenr pas la fabrique, amibuent _ce dé–
faut
a
la qualiré de la
marier~
done la cordelme
e~
c.ompofée , quoiqu'il n'y en ait pas d'autre que celu1
que l'on vie:.r
de
cirer .
Il
efi done d'l'lne néccllité indifpenlable de paiTer
les cordelines
d' un~ f>~Gon,
foir aux tatferas o u
gr~s
de-tours' f<)i t aux fanns' que celle qu¡ efi
a
la nve
de l'éroffe foi t roujours difpo(ée
a
~ere
levée du coté
ou l'quvrier lance la naverre, paree que pour lors
il fe rrouvera qu't>lle aura baiffé au coup précédent:
cette obfervarion concerne roures les éroffes de la fa–
b rique en général.
Dans une érotfe telle qu'une lul1rine liferée ,
la
facon.depaiTer la cordeline efi ditférenre pour qu'elle
folt parfaite, paree que pour lors la prerniere naverre
palTe rég ulieremeot deux fois, quand celle du liferé
n'en paíle qu' une ; ce qui (lit qu'au rerour de la pre–
m iere la cordeline doif croifer pour
arr~rer
b
trame ,
ce qui n'arrive pas dans celle que l'on vienr de citer¡
d e
fa~
n que clans celle-ci les deux coups de trame
&
celui du liferé cloivent fe . trouver fous un méme
pas pour que la lifiere ne fa(J'e pas
le venrre de
vea
u.
Les cordelines daos celle-ci doivenr done erre paf.
[écs'
C.woir du coté droit la prem;ere
~
la plus pro–
che el u drap fur la
3' 4. 7
&
se
Ir
{fe¡
la
feconde fur
la premiere,
2,
o¡
&
6°
, ainli des au t1·es , fo iC qu'il
y
en ait lix o u huir; de fa con que celle de
la
rive fe
uou ve toujours paOée fur ' tes memes lilles de la fe–
conde ¡ par conféquent elle leve du dlré ou la
na–
v erte etl lancée. Les cordelines du córé gauche doi–
venr
~ere
pallees en feos contraire , c•e'l1-a-dü·e, la
premiere plus r:es du drap fur la premiereJ
2'
5
&
6•
,
la feconde lut la
3, 4 , 7
(x
S• ,
ce qui fa it qu•au
moyen de l'armure du fatin, celle de la rive , au fe,
c ond coup de naverte, fe erouve régul ieremenr fu r
la troilieme [i{fe' qui el1 celle qui doi t lever
a
ce
m~me e'oup, fuivanr l'armure du mérier.
Cordelin~s
po11r
In damqs .
Il
n'efi pas poffible de
paller la cordeline dans le damas , ni dans rous les fa–
tins
a
cinq liffes¡ de
fa~on
que cel le de la rive leve
réuuli~remcnr
du coté que la naverte
~11
lancée' at–
te~du
le nombre i¡npair des lilles , qui fai t que quand
le courfe des cinq liffes e11 fi11i, la naverre fe trouve
a
gauche dans
le premier'
&
a
droite dans le fe–
cond;
il
y a cependant une
fa~on
de les pa(Jer , pour
que la lifiere {oír belle, d;ffét·enre des aurres genres
d'érotfe: la premiere aordeline du coté du drap doit
erre paffée. fur la premiere lille du coté du corps' la
q uatrieme
&
la cinquieme; la feconde doit erre paf–
fee fur la deuxierne
&
la rroifierne;
la rroilieme fur
la quarriem_e
&
la
cinquieme_; la quarrie11_1e
f~r
la pre–
miere , la fcconde
&
la rro1fiemo; la cmqu•eme fur
la rroilieme, quatrieme
&
la cinquieme ; la
lixieme
fur la premiere
~
la feconde, en oommeoc¡anr
a
la
droite. La liliere du coré gauche doir e rre pallée de
meme que celle elu coté droi r.
Il
)' ~encere
une aurrc
fJ~on
de palier la corde line; favoir, la premiere du
córé du drap fu r la premiere ·
&
la fecond<'¡ la fecon–
de fur la quarrieme
&
la cinquien]e; la rroilieme fur
la feco nde
&
la
rroil¡eme¡
13
qua~rieme
(ur la pre–
m iere
&
la cinquieme; la c[nquieme fur la rroilieme
&
la quarrieme; la lixieme fur la premiere
&
la le–
co nde, o
u
il faur obtcrver que la li/fe du milieu, o
u
b
rroilieme par bquellc finit le fecond courle , ou
le cli xieme coup , ne doir jamais faire levcr les
m~mcs
cordelines qui fon t fur la
premi~re
liffe, paree que
pou·r lors le courfe finiffant par cclle du milieu, les
m tmes cordelines leveroient,
&
la trame ne feroir
poínr liée .
.
Dr 1{1
d~f'érenu d~
<
d11mry dc
l,yor1
cyJ
dt
Ge11u .
La
fa~on
donr les !taliens, principalement les Génois,
fal:iriquen~
lt: dalljas
1
efi rellemenr diiférenre de celle
SOl
dont on fe fert en France , foit par la qualité
&
quan–
titédc.foic done leurs chaines fonr compolees, foit pac
la maniere done ils fonr rravaillés', qu'il n'e{l pas be–
foin
d'~tre
fabriquaot pour convenir que
li
leurs érof–
fes font préférées aux nótres, leurs prínci pes fonr
auffi plus excellens ; c'el1 ce qu'il el1
néceiT~ire
d'ex–
pliquer.
On vient de dire que la qualité
&
quantiré de la
foic
done
les chaines des
d~mas
qui fe fabriquent
chez l'étrang-er fonr compofées , differenr de la qua n–
tiré
&
qualité de celle qui ell employée dans les
damas qui fe fabriquenr en France ,
il
faur le dé–
monrrer.
Le réalement du
1
Oélobre
1737,
quoique remp[.j
de verilies fur le fait de la fabricarion des érotfes, ne
fair aucune rnention des damas meubles;
il
ordonne
feulement,
art. 68 .
que les damas .ne pourront erre
faits
it
moins de
90
porrées de chainc. Celui du
19
Juin
174-'f,
ordonne,
titre
viij.
art.
.of.
que les damas
réputés pour meubles ne pounont erre faits ii-rnoins
de
90
portées de chaloe
1
chaque portée de
So
fils .
Certe íixation qui ne concerne précifémenr que
lq
quantité
defoie
pour ce geore d'étoffe , démonrre al–
fez que
les fabricareurs des deux réglemens qu'on
viene de cirer, n'éroienr pas des plus intellig ens,
puifque d'un dlté, la quanrité de
foie
qu'ils adrner–
rent ell in[uffifanre,
&
de l'autre, qu'i[¡ ne fonr au–
cune menrion de la qualité, qui efi auffi elfenrieíle
que la quantité mém e.
l/4rt.
1.
du réglement du
8
Avril
172-4,
pour la
manufaélure de Turin, cirée du réglemenr de celle de
Genes, veur que les damas (oienr faits avec une chaf–
ne de
96
porcées de
So
fils chacune,
&
avee un pei–
g ne de
24
porrées , pour qu'il fe trouve
8
fils par e-ha–
que elene de
ce
peig ne ,
&
qu'il ne foit employé
a
l'ourdillage des clamas que des organlins du poids ele
6
oélaves (
6
oélaves fonr
18
deniers poids
de
mare ) ,
c:haque raz (un raz fa ir ucmi-aunc de Fraocc ) , au–
moins , éranr reines,
c
e qui vaut aurant pour le poids
qu'une once
&
derni~
cha9.ueaune de la cha!ne pour
ce
u~
qui s'ourdilfenr en
~rance.
Les Piémonrois
o~c
eu foin de fixer le nombt•e des
portées par rapport
ll
la quanrité de
foie
dans leurs
damas, de meme que
les
poids par rapport
a
la qua–
lité ,
&
n'onr pas oublié de faire urdonner que les
peignes pour la fabrication de ce genre d'érotfe fuf–
lent c;:ompoli!s d'un 4JOmbre de portées proporrion–
né
a
la quamité de
la
fol~,
&
oe concinffent que
8
fils chaque denr .
La ·fixacion du poids feroit inutile fi le nomb re des
porrée~
n'éroir pas délig né , paree qu'on pourroit
merrre moins de portées
&
un organfin plus gros, s'il
o'étoit quel1io1! que
~e
la _qualité , aíin c¡ue le
m~me
po1ds fe rrouvat róu¡ours a la chaine,
cm
conformiré
du
réglemenr; ce qui contribueroit
a
une défe'éluo–
lité d'autant plus grande, qu'il n'elt perfonne qui
~e
Cache que ce n'cfl pas le fil
le plus gros
&
le plus
pe!anc qui fait
la
plus belle roile, rnais bien le plus
fin
~
le plus léger, la <¡Uantiré nécellaire fuppofée
complerre .
Les Génois rnerrent
Ioo
porrées aux moindres da–
mas meubles ele leurs fabriques,
&
un peigne de.
21'
porrées pour faire égalemenr le nornbre complet de S
fils chaque dent;
ce
qui doir immanqu:tblement faire
une étotfe plus parf;me que
fi
elle ne conrenoit que
90
porcées , comme il ell ordooné par les réglemens
de
1737
&
1744,
concernant
le~
manufaélures de
L yon.
La quantité des portées prefcrire pour les
clama~
de Turin
&
de Genes , étanr fupérieure
a
celle qui
<:'11 prefcriee pour ceux qu'on fa ir en France, il ell
~vident
que leurs éroffes d!Jivent furpaller ces der–
nieres ; ce n'el1
pn~
encere affez pour leur perfellion,
«es érrangers veulenr auíli que le poids de leur chaine
foir fixé, crain te qu'un organfin trop fin n'a lrérat la
qualité
de
l'érotfe nc garniflitnt pas affez; ce
qu~
rous
nos fa bricareurs de rég leme<lS n'oor pas fu imaginer,
quoiqu'ils le foienr arrachés
a
des minuries
infinimen~
au-dellous de ce que demande le damas pour qu'il
foit parfait .
Si un oru-anlin extraordinairement fin peur rendre
le damas
dére.:tueu~,
quoique le no1mbre
des
porrée¡
!oit complet , un or¡pnfin exrraordinairemenc gros
ne le rendra pas parfa1r; il faut une marierc;, propor–
rionnée
a
l'éroffe pour laquelle elle e!l: dettinée; de
Fa~(;m
que
ti
un organfin trop
fifl
fa ir paroirre l'érotfe
affamée o u peu garnie, celui qui e{l tro p' g ros fera
p~roirr~
qn
f~rin
rude
&
!ce, au-lieu d'érre doux
&
velou-
















