
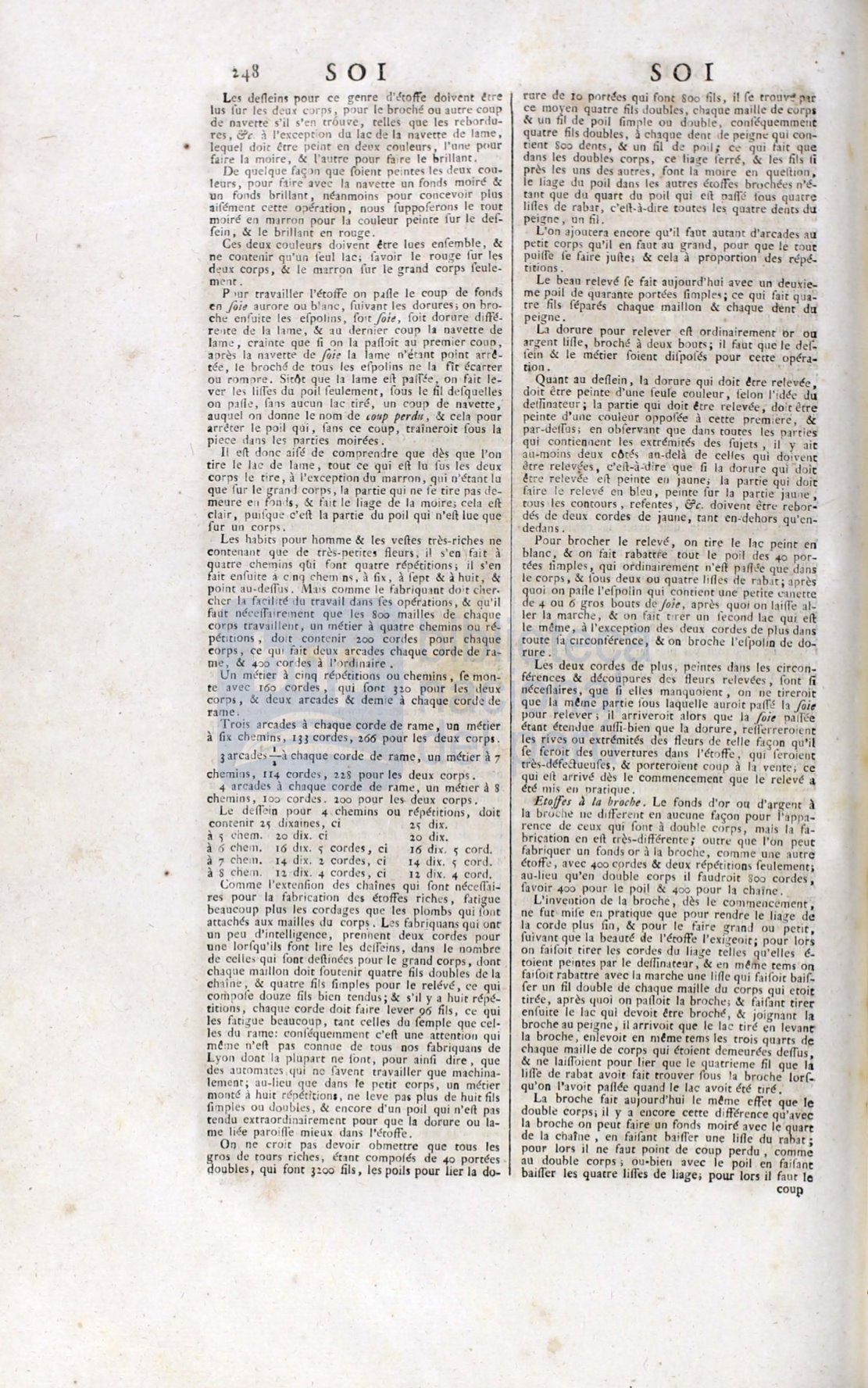
S O I
Le5 delleins pour ce genre d'.!tolfe doívent
~tre
tus (ur le< deo• c;¡rps, pour le broché ou aurre cou
d~
naverte s'il
'e!1 tróuve, telles que les rcborrlu–
res,
&e
~
l'exception du lac de
la
naverre
ele
lame,
lequel doit erre peint en
de~x
conleurs,
~·un~
pour
faore la moire, 61
l'autrc pour fa re le bnllant .
De quelque
fd~->n
que íoient pemtes le deux. cou–
leurs, pour f1ire avec la naverte un fonds
mom~
61
u n fonds brillant, néanmoins pour concevotr plus
aiíémcnr cene o;>¿ration, nous
íupp~feron
le rour
m iré en marron pour la couleur pemte fur le def–
fein ,
&
le bril lant en rougc.
Ces Jeux coulcurs doivent
~tre
loes eníemb_le, 61
ne concenir qu'un Ceul lac; (avoir le rouge lur les
cl~ux
corps, 61 le marron fnr le grand
corp~
íeule–
menr .
P •ur travailler l'étolfe un pllle le coup de fonrls
en
.foie
aurore ou
b'a~c,
ínivanr ,les
d~rures ;
un J:¡ro.
che cnfui re les efpolms, fo•t
.fou,
foo r dorure dtlfé–
re!lte de la lame
&
au dernier coup la navene de
lame
crainte
qu~
fi un la ¡>all ir au premier couo,
a re; la navette de
.foi.
la
ame n"étant point
arr~tée. le brochá de rous les erpolins nc la
fit
é~arter
ou rom re. Sit<')r que la lame ell
paff~e ,
un fatr le–
ver le; liffes du poil íeulement, fous le fil dcfquelles
on pafk, fans aucun
la
e
tiré , un cou
de naverte,
auquel on donne le nom de
coup perdtl ,
&
cela pon r
arr~ter
le poil qui, fans ce conp, trúneroit fous la
pi ece rlans les parti es moirées.
ll en dnnc 3ifé de comprendre que des que l'on
tire le lac de lame, tOut ce qui en lu fus les deux
corps le ttre,
a
l'exceprion do marran, qui n'étant lu
que fur le grand corps, la partie qu i ne fe tire pas de–
meure e11
f0n ,l¡,
&
f,llt le liage de la moireJ cela en
el
air. put fque e·en la partie
a
u poil qui n'efl lue que
fur un corps.
Les habits pour homme
&
les venes tres-riches ne
comenant que ele eres.perites Reurs , il s'en fa it
a
q uatre chemins qlli
f0nt quarre répétitions;
il s'en
fair enfuite
~
e
nq chem
n~.
¡¡
íix.
a
fept
&
2 huit.
&
point
au-deffu~.
M:us comme le fabriquaot do;t cher.
cl1er
1~ f~ci l aé
du travai l dans fes opération ,
&
qu'il
f~ut
né<'cffa tremenr que les Soo mailles de chaque
corps travatlleltr. un métier
a
quatre chemins ou ré–
pétt tions , dott contenir
200
corcles
pour chaque
corps,
ce
qnt fai t dcux arcades chaque corcle de ra–
me,
&
400
cor<ie~
ii
l'•>rdtnaire .
Un métier
a
cinq répétirions ou chemins , íe mon–
te avec
160
cardes , qui fonr po pour les <leux
cor s,
&
deux arcades
&
demte
a
chaque corde de
rame .
Trois arcades
a
chaque corde de rame, un métier
a
fi x chemins ,
13J
cardes,
266
pour les deux corps .
3arcades
-;-a
chaque carde de rame, un métier
a
7
chemins,
114
cordes , 2.28 ponr les deux corps.
4 arcades
ii
chaque carde de
ram~,
un métier
~
8
chemins, Ioo cordes.
100
po~r
les, deux corps.
Le deff< in pour
4
chemins ou répécitions, doit
conrenir
15
dixaines,
ci
2)
dix.
¡¡
'i
chem.
20
dix.
ci
10
dix.
a
6
chem.
t6
dtx.
'i
cardes ,
ci
16 dix.
~
cord.
a
7 chem .
14
dix.
2
cardes, ci
14
dix.
s
cord.
a
S chem.
12
dix .
+
cardes,
ci
12
dix. 4 corrl.
Comme l'extenfion des chaines qui íont néceffai–
res pour la
fabrication des étolfes riches,
fati~ue
beaucoup plus les cordages que les plombs qui {ont
attaché aux mailles du
corp~.
Les fabrjquaru qui onr
un peu d'intelligence, prennent deux cordes pour
u ne lorfqu'ils font lirc
l e~
deffeins, dans
le nombre
de celles qui fonr deninées pour le grand corps , dont
chaque mat llon doit foutenir quatre fils douhles de la
chaine,
&
quatre fi ls limpies pour le relévé,
ce
qui
con'l ofe douze fils bien tendus;
&
s'tl y a huir répé–
ttttons, ch
aque cordedoit faire lever
96
tils, ce <lUÍ
les futi5ue
bcauco.up,tanr celles do fem ple que cel–
les du ra
me : l!Onléquemmenr c'efi une artenriou qui
m~me
n'efi pas connue de rous nos fabriquans de
Lyon dont la plupart ne {ont, pour ainfi dire , que
des automatcs qui nc íavent travailler que machina–
lemeor; au-licu que dans le petit corps, un métier
monté
¡\
huir répéticions , ne leve pas plus de huir fils
íimples ou <loubles,
&
encure d'un poil qui n'en pas
tendu cxrraordinairemcnr pour que la dorure ou la–
me liée paroille mieux dans l'érolfe.
On ne croir pas devoir obmettre que rous
les
gros de rou rs richcs , étant compofés de
40
portées
¡loables, qui fom
poo
fils, les poils pour lier la do-
S
O I
rore de Io pnrr.!es qui fonc soo 1! ,
i!
fe
rrou~
1r
ce moyen quatrc fils Joublc , chaque m ille de corps
~
un fil de poil fim
le ou d"uble, confequemmeut
quatre fils doubles,
~
chaque denr le
pett!n~
qui con–
tient
Sao
dent ,
&
un 61
d~
pnol ; ce qui f:lit que
dans les double corps, ce lia!(e (erré,
&
le; fils
ti
prc
les Utts des autre , font
hi
motre en qu lltnn ,
le liage du potl dan
les autres érolfe• brochée n'é–
taut que dn quart du poi! qui en !'31lc tou quatre
lilles de rabar, c·en.a-dtre roures les quarre dents du
peigne, un fil.
L'on aj utera encare qu'il fam aUtaf)t d'arcade au
petit corps qu'il en faut au grand, pour que le tnut
r.uiíl'e fe faire june
1
&
cela
:'i
proportion des rép¿–
tlrrons .
Le beau relevé fe fait aujourd'hui avec un deuxie–
me poil de quarante portées fim ple ; ce qui fait qua–
ere fils
féparés chaque maillon
&
chaque dent du
peigne.
l..1
dorure pour rclever en ordinairement br oa
argent lille' broché
a
dcux b ut< ; il faut que le del:
Cein
&
le métier íoienr di(po(és pour cette opéra–
tion.
Quant au dellein, la dorure qui rloit
~tre
relevée ,
doit erre peinte d'une feúle couleur ' felon l'idée du
deiTinateur ; la panie qui doir
~tre
relev<'e' doit erre
pein te d' une couleur oppofee
il
cette prem:ere,
&
par-deffus; en obfervam que dans roures
les parties
qui
contienn~nr
les extrémttés des fujets ,
il
y ait
au-moins deux c6tél
on-
del~de celles qui
doi v~nt
3tre relev1es , c'ell-a:dire
q.uefi
la dorure qui doit
érre rclevée efl peinte en
¡aune;
la partie qui doit
f~irc
le relevé en blcu, petme fur la panie jau•u: ,
toUS
les COOtollrS, retentes,
&c.
doivent
etn:
r~bor•
dés de dcux cordes de jaupe , ranc en-clehors qu'cn–
ded,tns.
Pour brocher le relevé , on rire le lac peinr era
blanc,
&
on fai t raba ttre
rour le poi! de
'fO
por–
rées limpies , qui ordinairement n'ell pJ!l..Cc que dans
le corps ,
&
ious deux ou quarre ltfle< de
r~b,tt;
apres
quoi
011
p31le l'efpolin qui contiene une perire cancne
de 4 on
6
gros bouts de
joie,
apres quot
011
l:1i!fe al–
ler la marc1te,
&
un íat r t·rer un
lecond lac qui efl:
le meme,
ii
l'exception de> cleux
cord~s
de plus dans
toute fa ctrconlérence,
&
on broche l'cfpolm de do.
rure.
Les deux cordes de plus, peimes •lnns les circon–
férences
&
découpures des fleurs rdevée , íom
fi
nécellaires, que
ii
ell es manquoient, un ne tireroit
que la
m~me
pnrtie foos laquell e auroit paff'é
la
h ie
pour relever; il arriveroit alors que la
.foie
pa lfée
étant étemlue aulli-bien que la dorure, refl"errerooent
les rives ou extrémités des Reurs de telle fa<,¡on qu 'il
íe feroir des ouvenures <!ans
l'érolfe , qut feroient
rres-défeélueufes ,
&
porteroient coup
a
la vente; ce
qui ell at-rivé des le commencement que le relevé a
éré mi< eu orarique.
Etoffes
a
la
brocbe.
Le fo nds d'or
OQ
d'argent
~
la broche ue dtfferent en aucune fa<,¡on pour rappn–
rence de ceux qtti fonr
a
double corps
1
mals la fa–
bricatioo en en rres-dilférente ;
Outrt•
que l'on peut
fabriquer un fonds or 3 la broche, comme u e autre
étolfc, avec
400
cprdes
&
deux répétitoons feulemcnt¡
au-li~u
qu'en double corps il faudroi t 8oo cardes,
favoir
400
pour le poil
&
400
pour la chalnc.
L'invention de la broche, des le commencement,
ne fut mife en pratique que pour rendre 'le
li~ge
de
la corue plus fin.
&
pour le taire grand ou petir'
fuivant
~u
e la beauté ele l'érolfe l'exi rentt; pour lors
un faifot t tirer les cordes du liage telles qu'elles é–
toienr peintes par le dellinate•Jr,
&
en
m~mc
tems on
faifo tt rabame avec la marche une lille qui faifoit baif–
íer un fil double de chaque mai lle du corps qui etoit
tirée, apres quoi on pa lloir la broche;
&
faifant tirer
enfuire le lae qul devoit
~tre
broché,
&
joignant la
broche au petune ,
il
arrivoit que le lac tiré en levane
la broche,
et~evoit
en
m~me
tems les trois qtllrts de
chaque mai lle de corps qui étoient demeurées deffus,
&
ne l3iffoient pour lier que le quatricme fil que la
liffe de raba r avoit fair rrouver fous la broche lorf–
qu'on l'avoir paflée quand le lac avoit été tiré.
La broche fait au¡ourd'hui le
m~me
elfet que le
doubl.: corps; il y a encore cene dilfércncc qu'avec
la broche on peut faire un fonds moiré avec le quarc
de la chatne , en faifam baiffer une lille clu rabat;
pour lors
il
ne faut point de coup perdu , comme
au double corps ; ou·bieu avec le poil en fa ira nt
bai!rer les quatre lilfes de liage; pour lors il faut le
coup
















