
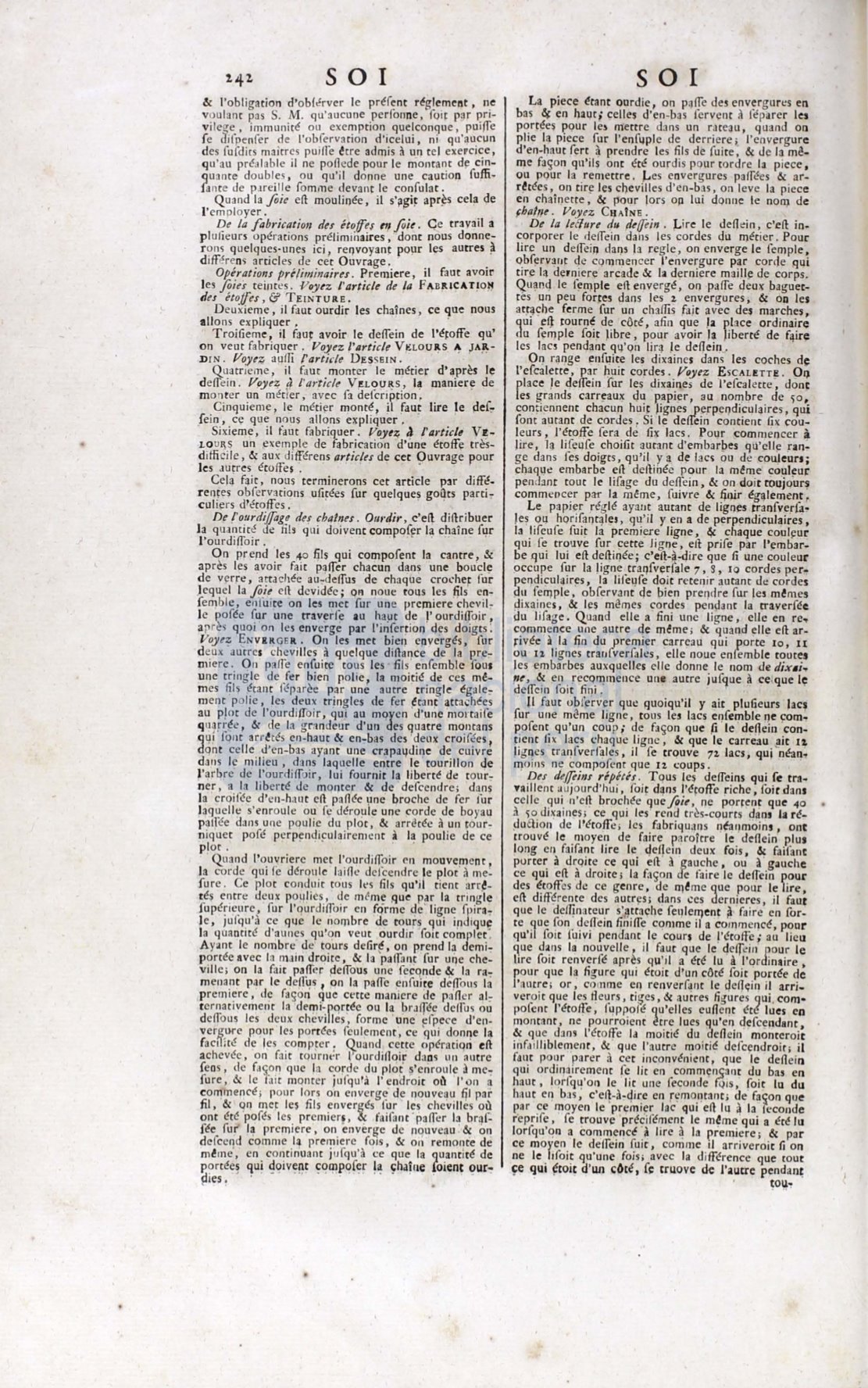
S O I
&
l'obligation d'obh!rver le préfent
r~glement,
ne
voulant pas S. M . qu'aucune perfonne ,
foi~
pª r l?ri–
vileue , immunité ou exemption quelconque, pUl(fe
fe cli[penfe r de l'obfervarion d'icelui, ni
qu'~u.cun
des fufdirs maitrcs puille
~rre
admis
a
u_n re!
exevct~e,
q u'au préalable il ne pollede pour le monrant
d~
cm–
quanre doubles , ou qu'il donne une cauriop fuffi–
fa nte de pJTeille fo mme devant le confutar .
Q uand la
flic
e!l: moulinée,
il
s'~¡¡'i~ apr~s
cela
~e
l'employer.
.
De la jabricatio11 des hoffe¡ 111 f?ie.
Ge trayatl
a
pl ufieurs opérarions préliminaires, done nous donne–
r ons quelques-unes ici
1
rer¡voyant po¡:tr
l~s
aurres
~
d ifférens articl es de cet Ouvrage. ·
.
Of>érations prNimiiiaires .
Premiere , il faut avotr
les
Joiú
reinfes.
1/oy ez l'article de la
f ABiliC.\T!Ol!
des
éto{fes , &TEINTURE.
D euideme, il faut ourdir les cha1nes , ce que nous
allons expliquer ,
·
Troi!ieme, i!
fau~
avoir le delfein de l'é¡offe qu'
on veut fabriquer .
Voyez l'11rtic/e
V~:LOUJ!.S ~ ~A~D!N .
f/oyez
aqtli
fartide
D t:sssrN.
Q ua m eme ,
il
faur monrer le mérier d'apres le
de(fein.
f/pyá,
¿¡
l'a.·ticle
YI!LOU~S,
!4
manier~
de
monrer un métler, avec fa deti:rtption,
Cinquieme, le métier monté
1
¡t
fauf tire 'e
,:lef~
fein , ce que nous allons expliquer ,
Sixieme, il iaut fabriq uer .
Voyez;
.l
f¡¡p·ticlt
V~LOUI\5
un )'!xemple de fabricarion d'Úne
étoff~
tres–
ditficile,
&
aux di /rérens
articlu
de cec Ouvrage pour
les Ju¡res étoffes .
·
•·
Cel~
fait , nous terminerons cer arcicle p3r diffé–
ren¡es obfervarions u!i¡ées fur
quelque~
goQts parti–
cul i$!rS d'écoffcs.
D~
f'ourdijfage des ch4lnes . Otll'dir ,
c'ell. di!l:ribuer
la quantité
d~
li!s qui doi vent compof¡:r
1~ c~aine
ft¡r
l'ourdiffoir.
On pr e11d les
¡10
fjls qui compqfenc la cantre
1
&
apres les avoir fait pqffer chacun
d~ns
une boucl(:
de
v~rr~,
acrachée au-detTus de chaque
cro,·he~
fur
Jeque! la
fo!~
e!l: devidée;
<¡A
noue cous les fils en–
fell)bl.:,
ent ui~e
on les met fur une premiere chevil–
le pofée fur une
era
verfe au haut de 1' ourdi(foir ,
apre· quoi'on les enve'rgi par l'irÍfer¡ior¡.
<j~s
doigts:
Voyet;
€NVKI\GE!l.
On les mee biet¡ epvergés, fur
deux autres chevilles
a
quelque di!l:ance de la pre7
miere . Qn patTe
enfui¡~
tous les
fils ' enfemble fous
une tringle de
f~r
bien polie
1
la moirié di! ces mé–
mes
fil~ ~cant
féparee par une aucre · rringle égaleo
rnent 'p lie , les deux crit¡gles de fer
~tan~ ~tta.;h~es
au pJot de l'ourdi!foir, qui au mq:yen d'une mortaife
quarrée ,
&
de la
gr~ndeur
d'un des quaere montans
<J 4i'
fcint
arr~tés
en-haut
6¡.
en-bas des 'deux croi fées
1
dqnt celle d'en-bas ayanr une
cr~pat¡di~Je
de cuivre
dans le milieu , dans laquelle er¡tre le courillon de
r~rbre
de l'ourdiffoir , lui ' fournit' la liberté de tour–
ner, a la liberté de moncer
&
de defcendre ; dans
Ja croilee d'en,haut e!l: 'paflée
\)Oé
broche de fer fur
laguellt! s'enroule ou fe déroule une ,eorde de boyau
patTee élans une pquJie du plot,
&
arr~tée
i\
un tour–
niq'uet pofé
perp~nqis;ul ai rement
a
1~
poutie de ce
piar .
· Quand l'ouvriere met l'ourdiffoir en mouvemenc ,
la carde qui fe dérqu le laifle dclcendre le plor' i\ me:
fu re
o
Ce )>lot conduic tous lt'S fils qu'il cient
art~tés entre deux po¡.¡lies, de méme 11ue par la tringle
fupérieure, · fur l'qurdiffoir en fQ'rm e de''lig ne fpira,
le,
julqu'i\ ce q<Je
le nornbre ae rours qui indique
la quantité
d'~unes
qu'qn veut ourdir ·foic
cornplet~
Ayanr le nombre de' tours de!iré, on prend la demi"
portée avec la main drqite,
&
la 'palfan¡ fur ui¡e che–
ville; on la fai t
pa!fe~
peífous une
fe~qr¡de ~
la ra"
mena_n~
par le
den~s
1
on la pa(fe !!nfui¡e .deffous la
premtere, de
fa~on
que cette maniere de palier al
0
rcrnativemetit la ·demi-porcée ou la bralfée deffus ou
delfous les deux
chevillé~·.
forme 'u'ne efpece d'en–
vergtJore p,our les portées feulemen t', ce
~ui
donne
1~
facíHté de Jes compter. Quand cette o pératiori e!l:
achevée , 'on fait 'rou'rnt=r ('ourdilloir daos un 'autre
feos, de fd<,¡on que !a corde du plór' s'eriroule
il
me"
fu re ,
&
le fa it monter jufqu
a
1' eodroic ou 1' on a
eommencé; pour lors on enverge de qouveau ijl par
fil ,
'&
o~
roe¡: le$ fils envergés fur · les' chevilles ou
ont été 'pofés les. premierf,
&
faifanc ' p,aller
1~ Qr~f
fée fur' la
prem1~re,
on
enver~e
de f10uveau .
&
on
dcfcend éomme 1;¡ premiere fo1s,
&
o,)· remonte de
m~me',
en concinuanr jufqu'a ce que la quanrlté de
~~rtée~
qu¡
~qiv~nc ~qq¡pqf~~ !~ ~ha!ne
foient C_?ur-
l'aes !
·
S O I
La piece étanc ourdíe, on pijlfe des envergurt!s en
bas
4
en l)at¡t ; celles d'en-bas fervent :\ feparer les
port~es
pqur le• mettre dans un rateau, quand on
plie la piece fur l'enfllp)e de derriere
¡
l'envergure
d'en-l)aut fere
~
prendre les fils de fui te;
&
de la m@.
me fason qn'ils onr été ourdis pour rordre la piece,
o u pqur la remettre.
~es
envergures paffées
&
ar–
(ltées, on cir¡: les cl¡evilles d'en-bas, on leve la piece
en ehalnecre,
&
pour lors OJI
lui donn(' le no
a¡
de
fhD/f!e .
V~yez
CIJAfNE .
D~
la leflure du ¡le(frin
.
J-ire le
dell ~in ,
c'e!l: in–
corpqrer le tlelfein daos les cardes du
rr¡~tier .
Pour
tire un detTein
da~s
la
regle, on enverge le femple,
ob(erv~u¡
de cqn¡rr¡encer l'envergure par
cor~e
t:JUi
tire
1~
derniere arcade
&
la derniere maille de corps.
Quan<j
le ferr¡ple e!l: envergé, on palfe <jeux baguet–
cés un peu forres dans les
~
envergures,
&
OQ
les
at.t~~J¡e
ferme fur un chaflis
.fa.itavec des marches,
qui
eft
tourn~
de c6té, afin
quela place ordinaire
du ferr¡ple foic jibre, pour avoir
J~
¡iberté de
f~ir~
les lncs pendanc qli'Qn
lir~
je deijeir¡_.
01)
range
~nfl¡ice
les dixaines daos les coches
d~
l' efcalette, par l)uit cardes .
f/oy~z
E sCALI!TTI!.
91J
place je delfein lur les dixaines de l'efcalette, dont
les grands carreaux <ju papier
1
au noll)bre de so,
contiennenc chacun huit li¡¡;nes
_p~rper¡diculaires,
qui
font autant de cordes. Si le delfein contiene !ix cou–
leurs, l'étolfe fera dé fix lacs. Poqr commencer
~
Jire,
h
lifeufe choi!it auranc
d'embar~es
qu'elle ran–
ge daos fes doigts, qu'il y a de
lac~
ou de couleurs;
cl)aqlJ~
embarbe e!l: deiHnée pour la
m~me ~oul~ur
pen,bnr tou r le lifage du delle in,
&
on doic
roujqur~
commcl!cer par la mc!me, fuivre
&
/jnir
é~~lement ,
Le papier réglé ayaut aurant de ligncs
tranfverl~·
le~
OIJ
horifanr~l~s,
qu'il
y
en a de perpendiculaires,
la lifeufe fuit la premiere ligoe,
~
chaque coul¡:ur
qui fe trouve fur !=ette ligr¡e, e!l: prife par l'embar–
be .c¡ui
lui e!l: de!l:ir¡ée;
c'e!l:-~-<!ire
que fi une couleur
occupe fur la !igne
tiar¡fv~rjale
7, S,
10
cordes
per~
pendicul~ires,
la lifet¡f'e doic retenir aurant de cardes
du ferr¡ple ,' obfervanc eje bien prel)dre fur jes m!mes
dixaines,
&
les m@n¡es cordes pendanr la cra.yerfée
¡!u lifage. Q uand elle a fini une ligne, elle en
re~
comll)ei)CC une
~utre
eje
t¡l~me;
&
quaa¡d
~11!!
e!l: ar–
rivée 11
la fin du premier carreau qui porte Jo ,
II
ou
a
lignes traufverfales, elle noue enfemble toures
les embarbes auxquelles elle donne le nom
d~ dix•i~
.n~ ,
&
en recoll)<J1ence un• aurre
juf~ue
a
eelque
1~
dclfcin foi t
ti~i .
U
fa ut obt'crver qu.: !JUOiqu'il
y
~ir
plu!ieurs lac,
fur une meme !ig ne , [OllS les lacs et¡fet¡lble
I)C fOnl•
pofent qu'un coup ; de fa<,¡on que
fi
le deijein con–
~ient
tix lacs chaque ligne,
&
que le carr'eau aic
u.
!igl)es
trar¡fverf~les ,
il
fe rrouve
7~
lacs, quj
néar¡~
ll)Oins ne compofent que
a
cqups.
Des
deffiim rfpétfs .
Tqus
1~
de(feins qui fe cra–
nillenr aujourd'hui, foir
d~ns
!'é¡offe riche. foít Jlans
celle qui
n'c~
brochée que
fiu,
ne
por¡~nc
que
40
a
)O
di>faineS; Ce qui les rend treS·COUrts
<jáos
Ja té–
puétion de l'éro!fe; les
fabriqua11s
l)~t¡mqins,
ont
trouvé le moyen de faire
p~ro!tre
le deflein plus
long en faifam tire le cjeflem deux fois ,
&
faifant
porcer
a
drqite ce qui e!l:'
~
gauche. ou
a'
gauche
ce qui efi
a
droire ; la
fa~on
efe fai re le deffein pour
des écnffes de ce genre, de
ti)~
me que pour le lire,
e!l:
diff~rente
des autq!s; dans .:es dernieres, íl fauf
que le deflinateur
s'~ttal!he
feqlerqenr
~
faire en for–
re que fón · deffein fin iffe comme il a coinmencé, pour
qu'il foit fui vi pendant le
cour~
de !'éroffe; au lieu
que dans la nouvelle, il faut que le cjefj'ei11 pour le
lire foit renverfé apres qu'il a été tu
a
l'qrdintire,
pour que la figure qui étoit d>un c6té foit portée de
l'autre ; or , comme er¡
renverf~nc
le
cjeij~ir¡
il
arri–
veroit que les
~eurs, ri~es,
&
autres figures qui, com–
pofenc l'étoffe, ft¡ppqfé qu'elles euOef!C été lues en
montanr, ne pourroient erre lues gu'en
cjefc~pdant.
&
que dans l'étolfe la moitié du deijein monreroit
infa illiblell)ent,
&
que l'autre moitié
defc~ndroir;
il
fauc pour
par~r
ii
cer inconvénient, que le dellein
qui ordinairement fe lit en
comm~i1~anc
du bas en
haut, lqrfqq'o11 le ' lit une feconde ÍQ1s, foi¡ lu du
haut er¡ has ,
c'e~-a~cjire
en
r~mor¡tant; ~e fa~on
que
par ce moyen le premier lac qui e!l: ll¡ a la feconde
r'eprife, 'fe trouvc prédfemenc le mlme 'qui a été lu
lorfqu'qn a COil)mer¡cé
-~
tire
~
la premiere;
&
par
ce moyen le delfein fuit, comme ti arriveroir fi on
ne le tifoic qu'une fois; avec la différence que tour
~e
qui
~toi~
d'un cóté
1
f~
truove de l'aucre
pendan~
o
'
~~
















