
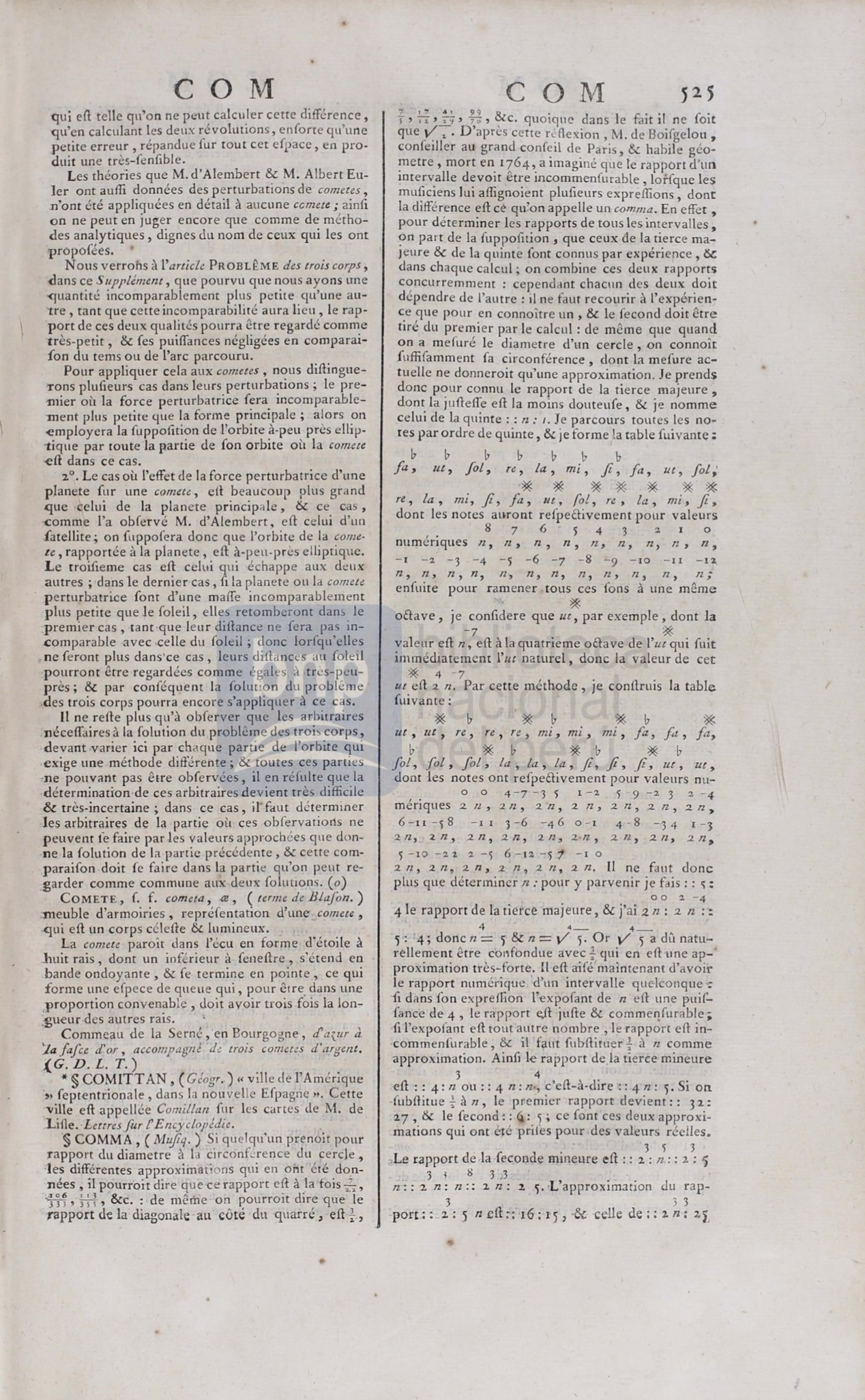
COM
"flUÍ
eít telle qu'on ne peut calculer cette différence,
qu'en calculant les deux révolutíons, en fone qu'une
perite erreur, répandu e fur tour cet efpace , en pro–
duit une tres-feníible.
Les théories que
M.
d'Alemhert
&
M.
Albert Eu–
ler ont auffi données des p erturbations de
cometes ,
n'ont ' té appliquées en détail a aucune
ccmete;
ainfi
on ne peut en juger encore que comme de métho–
des analytiques, dignes du nom de ceux qui les ont
propofées.
N
ous verrohs
a
1'
article
p
R
OBLEME
des trois corps'
-<Jans ce
SuppLément,
que pourvu que nous ayons Lme
<]uantité incomparablement plus perite qu'une au–
'tre, tant que cette incomparabiliré aura lieu, le rap–
port
de ces deux qualités pourra etre regardé comlll:e
tres-petit,
&
fes puiífances négligées en comparal-
fon du tems ou de l'arc parcouru.
. .
Pour appliqller cela aux
cometes,
nc~us
difrmgue–
-rons plufieurs cas dans leurs.
perturb~uons;
le pre–
'fnier oit la force perturbarnce
f~ra.
meomparable–
-ment plus perite que
~a
form;
pr~c1pale
; a!ors
~>n
-employera la
fuppofit1~>n
de
1
orb1te
~-peu,
pres elhp-
-tique par route 'la par
u
e de fon orblte o
u
la
comete
·-efi dans ce cas.
2°.
Le cas o1t l'effet de la force perturbatrice d'une
planete fur une
comae.,
eH beaucoup plus grand
.que celui de la planere principale,
&
ce cas ,
-comme l'a obfervé M. d'Alembert, eíl: celui d'un
.{atellite; on fuppofera done que l'orbite de la
come–
te'
rapportée
a
la planete, eft a-peu-pres elliptique.
Le troiíi.eme
cas
eíl: celui qui échappe aux den"
autres ; dans le dernier cas,
íi
la planete o
u
la
comete
perturbatri.cefont d'une maífe inc0mparablement
plus p.etite que
le
foleil, elle_s retomberont dans. le
.premier cas, tant ·que leur dtíl:ance ne fera pas
m–
comparable avec celle du foleil ; done lorfqu'elles
ne feront plus dans'ce cas, leurs diíl:ances
au
foleil
pourront etre regardées comme égales
a
tres-peu–
pres;
&
par conféquent la folution du probléme
.des trois corps pou-rra encore s'appliquer
a
e~ c~s .
Il
ne refie plus qu'a obferver qae les ar_bnratres
néceífaires a la folutÍon du probleme des
trOI~
C
Orps,devant varier ici par chaque partie de l'o_rbite 9.ui
.exige une méthode différente;
&
toutes ces part1es
:ne pouvant pas
e~re
obfervées' il en réfulte
~
ue.ladéterminatioa·de ces arbitraires.devient tre diflicJie
&
tres-incertaine ; dans ce cas, il faut d ' terminer
les arbitraires de
la
partie oú ces obfervatiorts ne
peuvent fe faire par .les valeurs approchées que don–
ne la folution de la partie précédente,
&
cette com–
paraifon doit fe faire dans la partie qu'on peut re–
garder comme commune aux deux folu tion .
(o)
.
COMETE,
f.
f.
cometa,
.a, (
terme de Blafon. )
:meuble d'arrnoiries , repréfentation d'une .
comete
,
qui efi un corps célefre
&
lumineux. _
La
comete
paroit dans l'écu en fGt'me d"étoile
a
Jmit rais' dont un iof¡'rieur
a
feneftre' s'étend
en
bande ondoyante,
&
fe termine en pointe, ce qui
forme une efpece de queue qui, pour erre. dans une
,proportion
conven~ble ,
doit avoir trois fois la lon–
:~ueur
des autres ra1s.
- ·
.
~
Commeau de la Serné , 'en Bourgo
0
ne,
d'
az.u.r
a
'Jafafc.e · d'or, accompagné de trois cometes d'argene.
íG.D.L. T.)
*
§
COMITT
AN, (
Géogr..)
«
ville de
1'
Amérique
-,, feptentriooale, dans la nouvelle Efpagne
».
Cette
ville eft appellée
Comillan
fur les cartes de
M.
de
.Lifle. ·
Lettres for
L'
E ncyclopt!die.
§
COMMA
(
Mujiq.)
Si quelqu'un
preno.itpour
rapport du dia:nerre a la circonLrence du cercle,
·1es différentes approximat· ons qui en oñt éte don–
nées' il pourroit dire que ce rapport efr
a
~a
fois
:.'l '
~'
; ;
~
'
~c.
: .
de meme on pourroit di re que le
·Tapvort
de
la diagonale
an
coté
du
quarré, eít
±.,
e o
1\1
7
,
7
4 .
9 9
&
.
d
l
r: .
·¡
.r
•
T
'
11:",
27J '
-:¡o
,
c. qno1qne
ans e talt
1
ne
101t
que
v:-.
D'apres cette réflexion,
M.
de Boifgelou,
confeiller au grand -confeil de Parí ,
&
habile géo–
metre, mort en
1764,
a imaginé que te rapport d"'un
intervalle devoit etre incommenfurabte' lorfque les
muficiens Jui affignoient plufieurs expreffions, dont
la différence eft ce qu'on appelle un
comma.
En effet ,
pour déterminer les rapports de tous les intervalles,
on part de la fuppoíition, que ceux éle la tierce ma–
jeure
&
de la quinte font connus par expériepce,
&
dans chaque calcul; on combine ces deux rapports
concurremrnent
:
cependant chacnn des deux doit
dépendre de l'autre : il ne faut recourir a l'expérien–
ce que pour en connoitre un ,
&
le fecond doit etre
tiré du premier par le calcul : de meme que quand
on a mefuré le diametre d'un cercle, on connoit
fuffifamment fa circonférence , dont la mefure ac–
tuelle ne donneroit
qu~une
approximation. Je prends
done pour connu le rapport de la tierce majeure,
dont la jufieífe efi la moins douteufe,
&
je
nomme
celui de la quinte : :
n :
1.
J
e parcours toutes les no–
res par ordre de quinte,
&
je forme \a table fuivante:
17
~
~
~
17
17
b
fa, ut,
foL,
re,
la
,
mi
,
Ji,
fa, ut, fol
,•
'** ***
**
re, la
,
mi,
Ji,
fa,
l:lt,
foL,
re
,
La,
mi,
ji~
dont les nores auront refpeaivement pour valeurs
8
7
.()
~ 54
3
21
o
numériques
n,
n
,
n
,
n
,
n, n, n, n
,
n,
- x
- 2
-3
-4
- 5
- 6
-7
- 8
-9
- 'lo
-u
-u.
n, n, n
,
n, n, n, n, n,
n,
n
,
n
,
n;
enfuite pour ramener tous ces fons
a
une meme
..
*
oétave, je confidere que
ut,
par exemple, dont
la
- 7
*
va1eur efl:
n'
eft a
la
quatrieme oétave de
l'ut
qui fuit
immédiatement
l'ut
narurel, done la valeur de
cet
*
4
- 7
ut
efi
2. n.
Par cette méthode, je conftruis la
table
fuiva.ote
~
*
~
*
~
~
v
*
ut
,
rtt
,
re
,
re
,
re
;
mi
,
mi
,
mt
,
fa,
fa
,
fa,
~
*
~
*~
*
~
fol, fol
,
fol
~
La
,
la
,
la
,
Ji,
Ji
,
Ji,
ut
,
ut
,
dont les notes ont refpeél:ivement pour valeurs nu-
o
O
4-7
-3 5
I -2
5 9
-2
3
2
- 4
mengues
2.
11.
,
2.
n
,
2.
a,
2
n,
2.
n, 2. n
,
2.
n
,
6
- n
- s
8
- 1 1
3 -6
-4
6
o
~ x
4
- 8
-3
4
x
- ~
2n, 2n, 2.n, 2.n, 2.n:7 2.n , 2.n , 2.n, 2. n,
5
- IO -2 2
2 -) 6 - 12 -"'):/
-
I O
2n, 2.n,
2.n,
2.
n, 2. n,
2.
n.
Une faut done
plus que déterminer
n:
pour
y
parvenir
je
fais:: ':
o o
2
-4
4le rapport de la tierce majeure,
&
j'ai
2
n:
2.
n
::
4
4_
4-
5·
·4;doncn=)
&n==v'
5·
Or
v
5
adttnatu–
·rellemelilt etre COI,fbndue avec
f
qui en eft ·une ap–
prOXÍmation tres-forte.
Il
eft aifé'maintenant d'avoir
le rapport numérique d\m intervalle quelconque-.:
-íi
dans fon expreífion l'.expofant de
n
eíl: une puif–
{ance cle
4,
le rapport
eJt
jufte
&
commenfur-able;
1i
l'expofant
eft
rout autre nombre , le rapporc efi
in–
·commenfurable'
&
il faut fu bftituer
f
a
n
comme
-appr0ximation. Ainfi le rapport de la tieree mineure
3
4
•
11
,
d.
s·
eft : :
4:
n
ou : :
4
n:
n ,,
e
en-a- 1re ·::
4
n
: ) .
1
on
-fubílitue
fa
n'
le pr.einier rapport devient::
3
2:
2
7 ,
&
le fecond
'! :
(i :
5 ;
ce font ces deux
approxi~
mations qui ont été prifes pour des valeurs réeilesD
.
3 5
3
,Le
rapport de la fecoode mineure
eft : :
2 :
n.: :
:z. : )
3
i
8
3 3
n::
2
n: n::
2
n:
2
S·
·L'approximation
du
rap-
3
3 3
·port;;
2.:
5
n
efr :: ·x6;
15,
·&
·ce-lle de ::
2.
n:
'· )J
1
















