
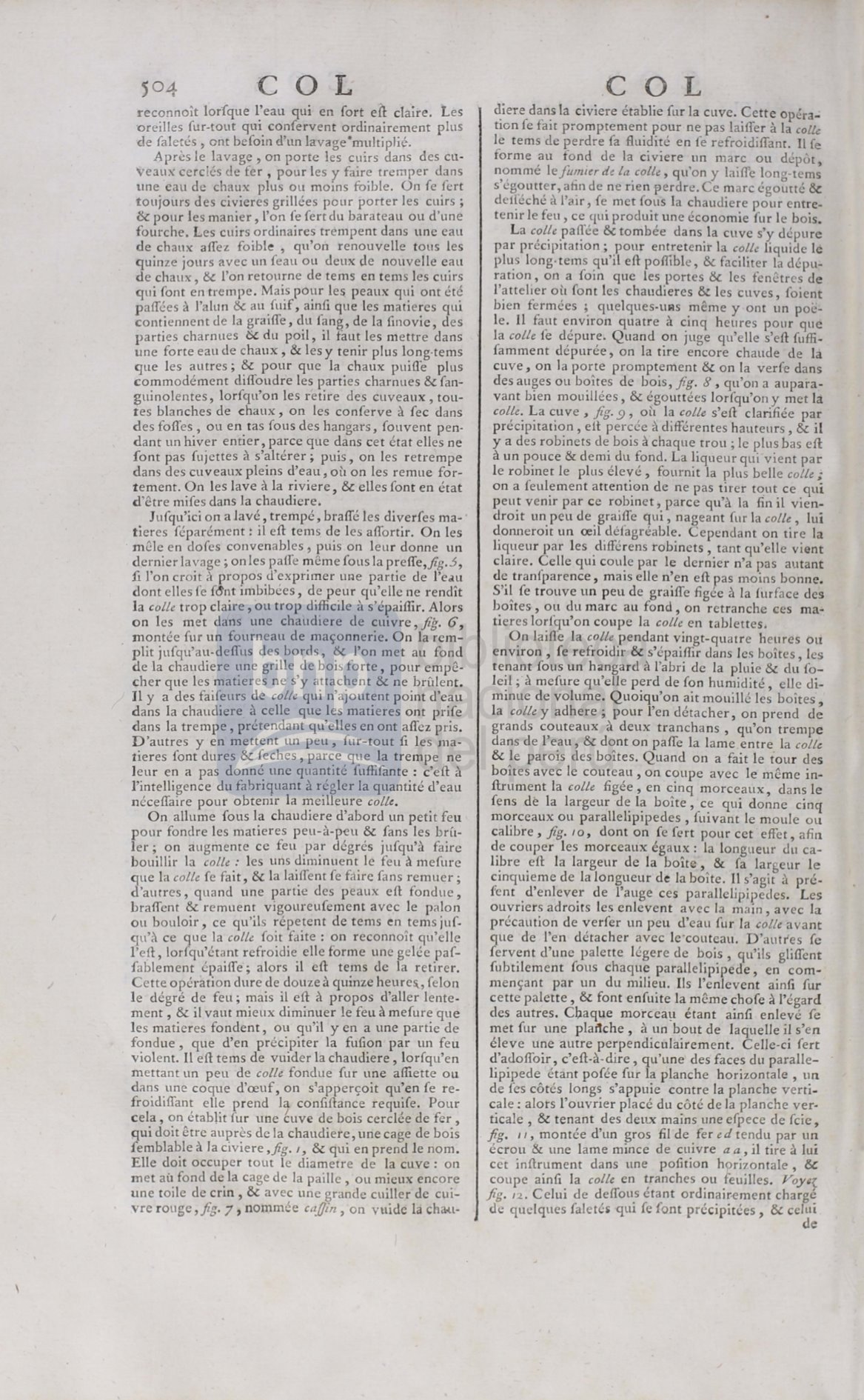
COL
reconnoit lorfque l'eau qui en fort eíl: claire. Les
oreilles fur-tout qui confervent ordinairement plus
de faletés, ont befoin d'un lavage·multiplié.
A
prcs le lavage, on porte les cuirs dans des cu–
\leaux cerc és de fer , pour les
y
fa1re tremper dans
une eau d
chaux plus ou moins foible. On fe
[ert
toujours des civieres grillées pour porter les cmrs ;
&
pour les manier' ron fe fertdu baratean ou d'une
fourche. Les cuirs ordinaires trempent dans une eau
de chaux affez foible , qu'on renouvelle tous les
quinze jours avec un feau ou deux de nouvelle eau
de chaux,
&
l'on retourne de tems en tems les cuirs
qui font en trempe. Mais pour
le~
peaux qui ont été
paffées
a
l'alun
&
au _fuif' ainíi que les
matie~es
qui
contiennent de la gratffe, du fang, de la íinov1e, des
parties charnues
&
du poil, il faut
les
mettre dans
une forte eau de chaux,
&
les
y
tenir plus long-tems
que
les
autres;
&
pour que la chaux puiífe plus
commodément diffoudre les partíes charnues
&
fan–
gninolentes, lorfqu'on les retire des cuveaux, ton–
tes blanches de chaux' on les conferve
a
fec dans
des foífes, o u en tas fous des hangars, fouvent pen–
dant un hiver entier, paree que dans cet état elles ne
font pas fujettes
a
s'altérer; puis' on les retrempe
dan des cuveaux pleins d'eau, oü on les remue for–
tement. On les lave
a
la riviere,
&
elles font en érat
d 'etre mifes dans la chaudi re.
Jufqu'ici on a
lavé,
trempé, braífé les diverfes ma–
tieres féparément: il eft tems de les affortir. On les
rnele en dofes convenables
~
puis on leur donne un
dernier lavage; onles paífe meme fons la preífe,fig.
.5,
.fi.
l'on croit
a
propos d'exprimer une partie de l'eau
dont elles fe fó'nt imbib 'es, de peur qu'elle ne rend'it
la
colle
trop claire, ou trop difficile
a
s'épaiffir. Alors
on les met dans une chaudiere de cuivre,
fig.
6,
mont 'e fur un fourneau de ma'ronnerie. On la rem–
plit jufqu'au-deífus des bords,
&
l'on met au fond
de la chaudiere une grille de bois forte, pour empe–
cher que les matieres ne s'y attachent
&
ne brulent.
I1
y
a des faifeurs de
col/e
gui n'ajoutent point d'eau
dans la chaudiere a celle que les matieres ont prife
dans la trempe, pr
1
tendant qu'elles en ont aífez pris.
D'autres
y
en mettem un peu, fur-tout
fi.
les ma–
tieres font dures
&
feches, paree que la trempe ne
leur en a pas donné une quantité fuffifante : c'eíl:
a
l'intelligence du fabriquanr
a
r~gler
la quantité d'eau
néceífaire pour obtemr la me1lleure
colle.
On allume fous la chaudiere d'abord un petit feu
pour fondre les matieres peu-a-peu
&
fans les brft–
ler; on augmeme ce feu .Pa_r dégrés jufqu'a faire
bouillir la
colle :
les uns dtmtnuent le feu
a
mefure
que la
colle
fe fait,
&
la laiífent fe faire fans remuer;
d'autres, quand une partie des peaux eft fondue,
braífent
&
remuenr vigoureufement avec le palon
ou bouloir, ce qu'ils répetent de tems en tems
juf.
qu'a
ce que la
colle
foit faite : on reconnolt qu'elle
l'eft, lorfqu'étant refroidie elle forme une gelée paf–
fablement
1
paiffe; alors il eft tems de la retirer.
Cette op
1
ration dure de douze
a
quinze heures.., felon
le d
1
gré de fe u; mais il eíl:
a
propos d'aller lente–
ment '
&
il vaut mieux diminuer le feu
a
mefure que
les mati res fondent, ou qu'il
y
en a une partie de
fondue, que d'en précipiter la fuúon par un feu
violent.
ll
eíl: tems de vuider la chaudiere, lorfqu'en
rnettant un peu de
col/e
fondue fur une affiette ou
dans une coque d reuf, on s apperc:;oit qu en fe re–
fro idiífant elle prend
la
conúftance reguife. Pour
cela, on
1
tablit fur une tuve de bois cerclée de fer ,
qui
doit erre aupres de la chaudiere' une cage de beis
femblable
a
la civiere
,fig.
1'
&
quien prend le nom.
Elle doit occuper tout le diametre de la cuve : on
met aú fond de la cage de la paille , o u mieux encore
une toile de crin ,
&
avec une grande cuiller de cuí-
re roug ,
Ji.u.
7,
nomm
e
caffin,
on
vuide la
cha.(.l-
e o
diere dans la civiere établie fur la cuve. Cette op'
.;
tion fe fair promptement pour ne pa laiífer
a
la
col!..;
le tems de perdre fa fluidité en fe refroidiffanr.
Il
[;
forme au fond
u
e la civi re un mar
e
o
u
d~por,
nommé
lefwnter de La
collr?.,
gu'on
y
laiffe lono-tems
s' goutter, atin de ne ríen perdre. e mare
1
go~tté
&
dei~(khé
a
l'oir'
{~
met
f~us
la
~haudiere
pour entre–
temr le feu, ce
qm
prodmt une economie fur le bois.
La
'?Lfe
.Pa~'ée
&
tombée dans_Ia ct ves
y
d 'pure
par prectpltauon; pour entretentr la
colle
liquide le
plll:
long-tems
~u'il
eíl: pofiible ,
&
facili er la dépu–
ratiOn, on a fom que les portes
&
les feo
'\tres
de
l'atteher oit font les chaudieres
&
les cuves, foient
bien fermées ; quelqueS-URS meme
y
ont un poe–
le.
Il
faut environ quatre a cinq heures pour que
la
colle
fe dépure. Quand on juge qu'elle s'eíl: {uffi·
famment clépurée; on la tire encore chaude de la
e
uve, on la porte promptement
&
on la verfe dans
des auges ou boites de bois,
jig.
8,
qu'on a aupara–
vant bien mouillées,
&
égouttées lor(qu'on
y
met
la
colle.
La cuve ,
fig.
9,
Oti
la
col/e
s'eíl: clarifiée par
précipitation' eít perc
1
e
a
différentes hauteurs'
&
il
y
a des robinets de bois achaque rrou ; le plus bas eft
a
un pouce
&
demi du fond. La liqueur qui vient par
le robinet le plus élevé, fonrnit la plus belle
colle;
on a feulement attenti0n de ne pas tirer tout ce qui
peut venir par ce robinet, paree qu'a la fin il vien..
clroit un peu de graiífe qui, nageant fur la
colle,
luí
donneroit un reil défagréable. Cependant on tire la
liqueur par les différens robinets, tant qu'elle vient
claire. Celle qui coule par le dernier n'a pas autant
de tranfparence, mais elle n'en eíl: pas moins bonne•
S'il fe trouve un peu de graiífe figée
a
la íurface des
boites , o
u
du marc au fond, on retranche ces ma–
tieres lorfqu'on coupe la
colle
en tablettes.
On laiífe la
colle
pendant vingt-quatre heures ou
environ, fe refroidir
&
s'
1
paiffir dans Jes boites, les
tenant fous un hangard
a
l'abri de la pluie
&
du fo-
1eil;
a
mefure qu'elle perd de fon humidité' elle di–
minue de volume. Quoiqu'on
ait
mouillé les boítes
la
colle
y
adhere; pour l'en détacher, on prend
d~
grands couteaux
a
deux tranchans ' qu'on trempe
dans de l'eau,
&
dont on paffe la lame entre la
colle
&
le parois des bo'ites. Quand on a fait le tour des
bo'ites avee le coureau, on coupe avec le m"me in–
fuument la
colle
figée, en cinq morceaux, dans le
fens de la largeur de la boite, ce qui donne cinq
morceaux ou parallelipipedes, fuivanr le moule ou
calibre,
fig.
10,
dont on fe fert pour cet effer, afin
de couper les morceaux égaux: la longueur du ca–
li_bre _eft la largeur de la boit€ , ..
&
fa largeur le
cmqUieme de la longueur de la boite.
11
s'agit
a
pré–
fenc d'enlever de l'auge ces parallelipipedes. Les
ouvriers adroits les enlevent avec la main, avec la
précaution de verfer un peu d'eau fur la
col/e
avant
que de
1
en détacher avec Ie·cout au. D'auit'es fe
fervent d'une palerte légere de bois , qu'ils gliífent
fubtilement fous chaque parallelipipede, en com–
men'rant par un du milieu. Ils l'enlevent ainfi fur
cette palette'
&
font enfuite la meme chofe
a
l'égard
des autres. Cb.aque morcea!J. étant ainú enlev '
{e
met fur une pladche'
a
un bout de laquelle
il
s'en
éleve une autre perpendiculairement. CelJe-ci fert
d'adoífoir, c'eft-a-dire, qu'une des faces du paralle–
lipipede étant pofée fur la planche horizontale, un
de fes
COt
1
S
longs s'appuie contre la planche verti–
cale: alots l'ou rier placé du coté de la planche ver–
ticale ,
&
tenant des deu.x mains une efpece de fcie,
fig.
11,
montée d'un gros
fil
de fer
ed
tendu par un
1
crou
&
une lame mince de cuivre
a a'
il tire
a
lui
cet iníl:rument dans une pofition horizontale ,
&
coupe ainíi
la
colle
en tranches ou feujlles.
J7oye{
fig.
12.
Celui de de.ífous étant ordinair-ement chargé
d
quelqnes falet
' s
qui
fe
font pr
1
cipit 'es ,
&
ce1 ui
de
















