
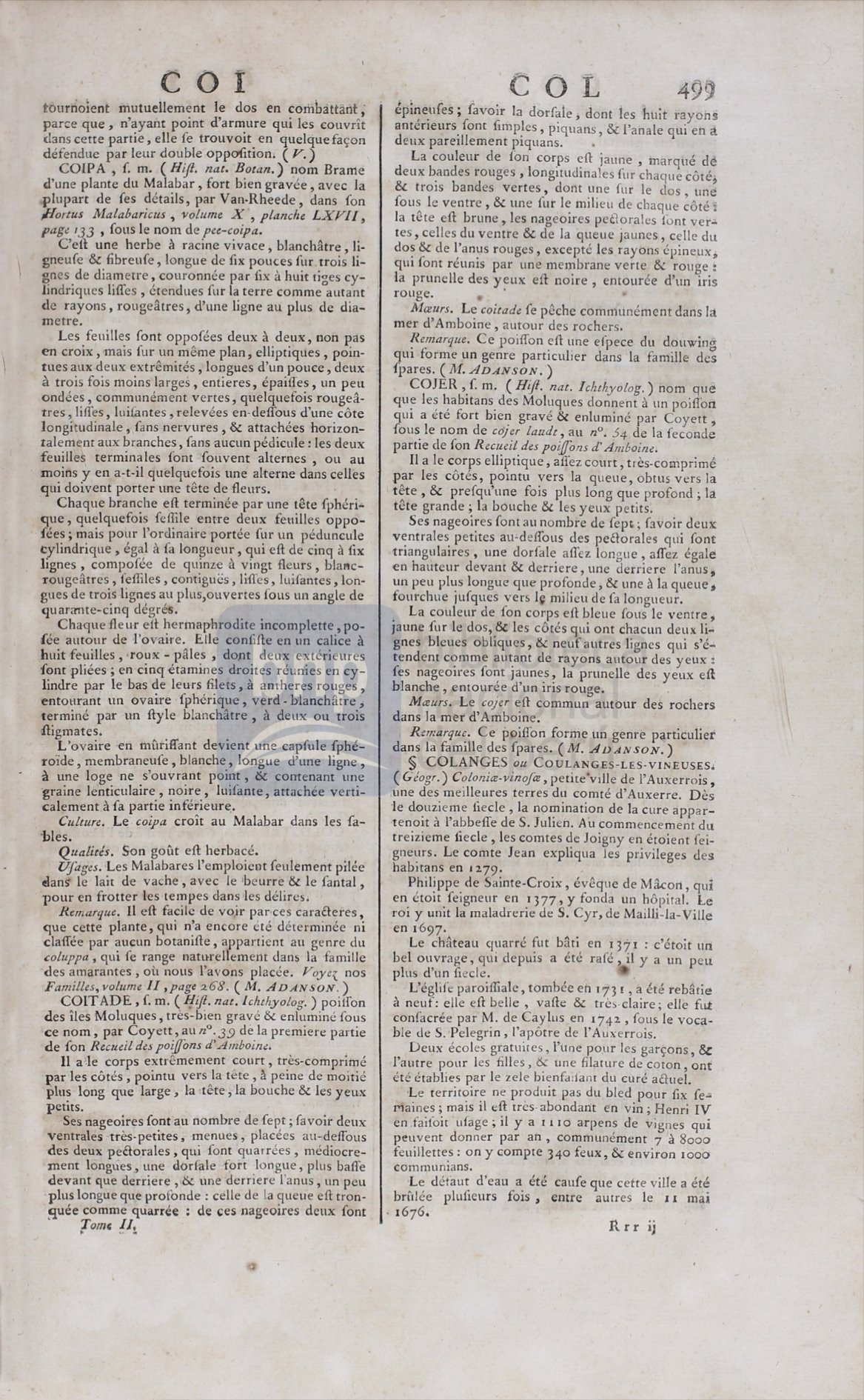
e o
I
tournoient mutuellement
le
dos en co.thbattant;
paree que, n'ayant point d'armure qui les eouvrit
dans cette partie, elle fe trouvoit. en quelquefas=on
défendue par leur double oppafitwn:
e
V.)
COIPA , f. m.
e
Hift.
nat.
Botan.)
nom Brame
d'une plante du Malabar, fort bien gravée, avec la
plupart de fes détails, par Van-Rheede , dans fon
,llortus Malabaricus
,
Yolume
X
,
planche
LXVI1
,
pag~
133
,
fous le nom de
pee-coipa.
C'eft une herbe
a
racine vivace,
blanch~tre,
li–
gneufe
&
fibreufe, longue de fix pouces fur trois
li–
gnes de diametre' eouronnée pa·r fix
a
huit riges cy–
lindriques li:ífes , érendues fur
la
terre comme autant
de rayons, rougeatres, d'une ligne a
u
plus de dia–
rnetre.
Les feuilles font oppofées deux
a
deux, non pas
en
croix' mais fur un meme plan' elliptiques' poin–
tues aux deux extremités , longues d'un pouce, deux
a
trOÍS fois
ffiOÍFlS
larges, entieres, épaiífes, un peu
ondées, communément vertes; quelquef0is rougea–
tres' líffes' luifantes' relevées en-deifous d'une cote
longitudinale, fans nervures ,
&
attachées horizon–
talement aux branches, fans aucun péclicule: les deux
feuilles termina les font fou vent alter·nes , o
u
a
u
moins
y
en a-t-H quelquefois une alterne dans celles
qui doivent p0rter une tete de fleurs.
Chaque branche eíl: termiaée- par une tete fphéri.:.
que, quelquefois feílile entre deux fettilles oppo-
. fées; mais pour l'ordinaire portée fur un pécluncule
cylindrique, égal
a
fa loagueur' qui efl: de cinq
a
fix
}ignes , compofée de quinze
a
VÍngt f.leurs , hlaHC–
rougeatres, feffiles, comigues, ltlfes, luifantes, lon–
gues de trois lignes au plus,ouvertes fous
UI'l
angle de
quanmte-cinq dégrés.
Chaque fleu-r eít hermaphrod:ite incomplette, po·
fée autour de ,l'ovaire. El'le confifte en un calice
a
buit feuilles, roux - pales , cl011t cleux exté-rieures
fent pliées ; en c-inq étamines clroites réunies en cy–
lindre par le bas
cleleurs fi-lets'
a
ant·heres rouges'
entourant un
ovai.refphéri~ue,
verd. blanchatre
j
t-erminé par
un fl:yleblanEhatre ,
a
deux
OU
trois
ftigmate~.
" .
.
,
L'ova1re en muti11ant dev1ent une capfule fphe-
ro!de, membraneufe, blanche., long ue d'une ligne,
i
une loge ne s'ouvrant pomt,
&
contenant une
graine lenticulaire , noire , luifanre, artachée verti–
calement
a
fa partie inférieure.
Culture.
Le .
coipa
croit au Malabar dans les fa-
i>le.s.
Qualités.
Son gout eft,
herba~é.
.
. ,
Ufages.
·Les Malabares
1
empl01et1t feulement pllee
~ans
le lait de vache, avec le •beurre
&
le fantal,
pour en frotter les tempes dans •les délires ;
Remarque.
Il
eft facile de voir par•ces caraél:eres,
que cette plante, qui n?a encore éré déterminée ni
claífée par aucun botanifte, appartient au genre du
coluppa,
qui fe range natu-rellement dans la famille
des amarantés ., ou nous l'avo'ns placée.
Yoyez
nos
Familles·, volume JI ,page
268.
(M.
ADANSON. )
COI'"(ADE, f. m. (
Pfifl.
nat.lchthJ!olog.)
poiífon
des 1les Moluques; tres-bien gravé
&
enluminé fous
ce nom, par Coyett, au
n°.
39
dé la premie re partíe
de fon
Recu.eil des poif!ons d'Amboine.
11 a .le c.orps extremement court, tres·compritné
I,>ar les cotés , pointu vers la téte '
a
peine de moitié
plus long qu.e large, la t&-te, la bouche
&
les yeux
petits.
Ses nageoires font au nombre de fept; favoir deux
ventrales tres-perites, menues, placées au-deffous
<les deux péél:orales, qui font quarrées, médiocre–
ment lóngues ·' une dorfale fort .longue, plus baffe
devant que derriere
,.&
une dernere l'anus, un peu
plus longue que profonde : celle de la queue efi: tron–
suée comme quaxrée : de ,es nageoires deux font
'
Tom' 1/,
..
-
..
COt
épineufes ; favoir la dorfaie , dont les huit rayohs
antérieurs fonc fimples, piquans
&
l'anale qui en
a
deux pareillement piquans.
'
La couleur de íon
co-r.ps~fi:
jaune , marqué
dé
deux bandes rouges , l
ongltllchnales fur chaque coté·
&
trois bandes vertes, dont une fur le <los
un~
fous le ventre,
&
une fur le milieu de cbaque
~oté ~
la tete eft brune ,.les nageoires petlorales font ver.;;
tes, celles du ventre
&
de la queue jaunes, celle du
dos
&
de l'anus rouges, excepté les rayons épineux,
qui fonr réunis par une membrane verte
&
rouge:
la prunelle des yeux eft noire , entourée d'un iris
rouge.
·
Maurs.
Le
coitade
fe p&che comrrhinément dans
la
mer d'Amboin e , autour des rochers.
R emarque.
Ce poiffon efi: une efpece du douwin o:
qui forme un genre particulier dans la famille
de~
fpares.
(M.
ADANSON.)
COJER ,
f.
m. (
Hijl.
nat. l cluhyolog. )
nom qué
que les habitans des Moluques donnent
a
un poiífort
qui a été fott
bie~
gravé
&
enluminé par Coyett
~
fous le nom de
co¡er laadt,
an
n°.
54
de la feconde
partie de fon
R ecueil des poif!ons
d'
Amboine.
Il a le corps elliptique, aífez court, t res-comprimé
par les cotés' pointu vers la queue' obtus vers la
tete,
&
prefqu'une fois
plus
long que profond;
ta
tete grande ; la bouche
&
les yeux petits.
Ses nageoires font
au
nombre de fept; favoir deux
ventrales petites au· deffous des peél:orales qui font
ttriangH laires , une dorfale aifez longu e , affez égale
en hauteur devant
&
derriere, une derriere l'anus
1
un peu plus longue que profonde;
&
une
a
la que ue
i
fourchue jufques vers le milieu de fa longueur.
La couleur de fon corps eft bleue fous le ventre,
jaune {ur le dos,
&
les cotés qui ont chacun deux li..;
gnes bleues obliques,
&
neuf autres lignes qui s'é–
tendent c<?mme
au~ant
de rayons autour des yeux:
fes nageo1res font Jciunes, la prunelle des yeux eft
blanche, enrourée d'un iris rouge.
Maurs.
Le
cojer
efi commun autour des rochers
dans la mer d'Amboine.
Remarque.
Ce poiífon forme
tm
genre
p~rtitulier
dans la famille des fpares.
(M.
An~NSON.)
§
CO~ANGES
ou
CouLANGES·LES-VINEUSEs~·
(
Géogr.) Colonia.yinoj'ée ,
petire·ville de
1'
A
uxerrois,
une des meilleures terres dú comté d' Auxerre. Des
·le douzieme fi ecle, la nomination de la cure appar–
·tenoit
a
l'abbeífe de S. Julien.
A
u commencement dtt
treizieme fiecle, les comtes de Joigny en étoient fei–
gneurs. Le comte Jean expliqua les privileges des
habitans en
J
279·
Philippe de Sainte·Croix,
év~que
de Micort, qui
en étoit feigneur en
1
3
77,
y
fonda un hopital. Le
roí
y
unit la maladrerie de
S.
Cyr, de Mailli-la-Ville
en
1697·
Le
ch~teau
quarré fut bati en
137
I
:
c'étoit un
bel ouvrage, qui depuis a été rafé,
il
y
a un peu
plus d'un úecle.
L'églife paroiffiale, tombée eh
173
I ,
a
été
reb~tie
a
neuf: elle efi belle ' vaíl:e
&
tres·claire; elle
fu.t
confacrée par
M.
de Caylus en
1742,
fous le voca–
ble de S. Pelegrin, l'apotre de
1'
Auxerrois.
Deux écoles gratuites, l'une pour les
gar~ons,
&
l'autre pour les fi lies,
&
une filature de coron, ont
été établies par le zele
bienfad~wr
du curé aétuel.
~Le
rerritoire ne produit pas du bled pour fix fe.;
Mai nes; mais il efi rres. abondant en vin; Henri IV
en faifoic ufage ; il
y
a r
1
Jo
arpens de vignes qui
peuvent donner par atl ' communément
7
a
8ooo
feuillettes: on
y
Gompre
340
feux,
&
environ Iooo
communians.
·Le déümt d'eau a été cau{e que cette vilfe a été
brúlée plufieurs fois , entre
autres le
J
1
mai
, 1676.
R
r r
ij
















