
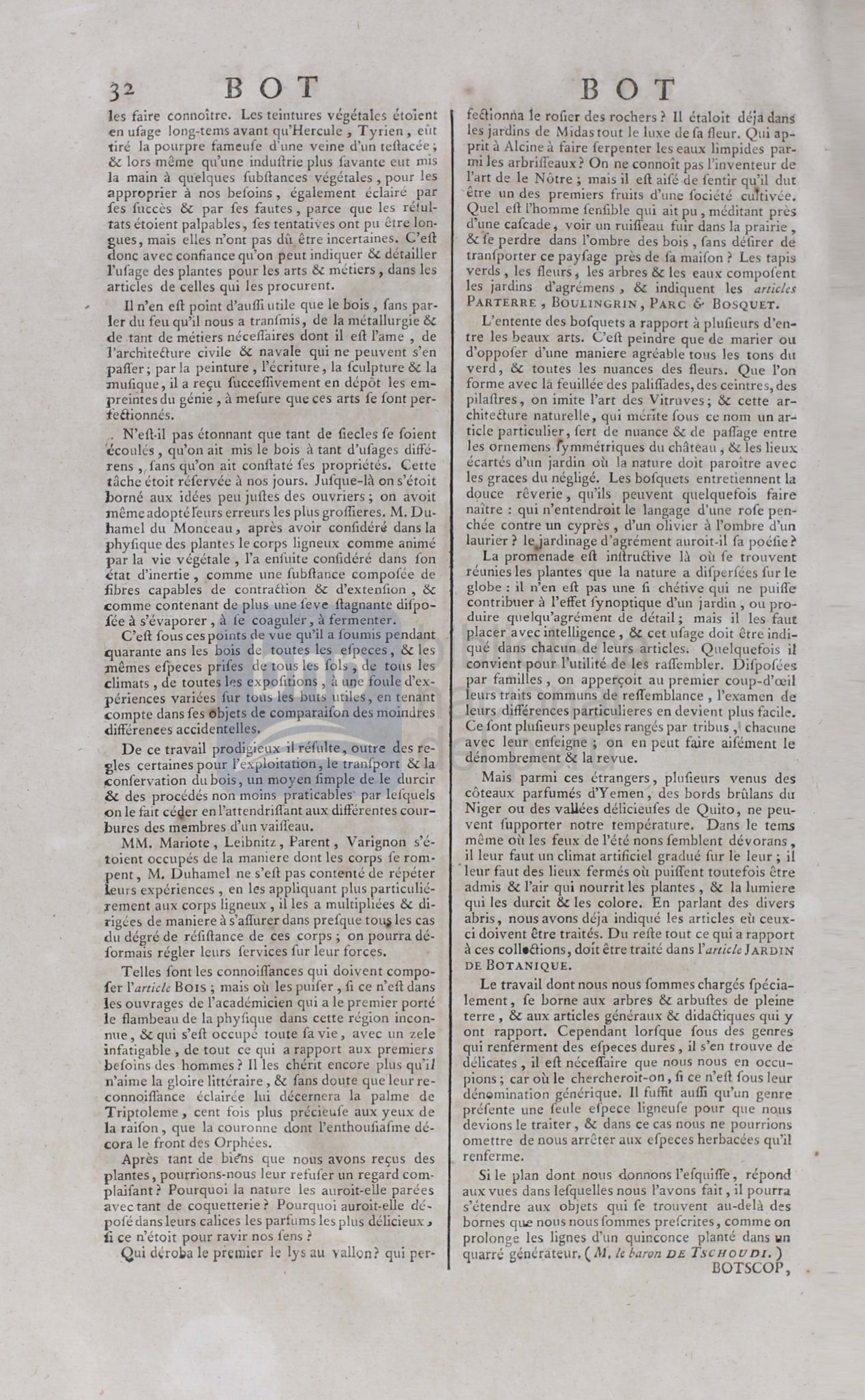
BOT
les faire connoitre. Les teintures végétales eto1ent
en
ufage long-tems avanr qu'Hercule , Tyrien, eftt
tiré la pourpre fameufe d'une veine d'un tefiacée;
&
lors meme qu'une induftrie plus favante eut mis
la rnain
a
quelques fubftances végétales ' pour les
approprier
a
nos befoins' également éclairé par
fes
fucd~s
&
par fes fautes, paree que les réíul–
tats étoient palpables' fes tentati - es ont pu etre lon–
gues, mais elles n'ont pas dí't etre incenaines. C'eft
done avec confiance qn'on peur indiquer
&
détailler
l'ufage des plantes pour les arrs
&
métiers, dans les
articles de celles qui les procurent.
11
n'en efi point d'auffi utile que le bois, fans par–
ter du fe
u
qu'il nous a tranfmis, de la métallurgie
&
de tant de métiers néceffaires dont il efi l'ame , de
l'architeélure civile
&
navale qui ne peuvent s'en
paífer; par la peinture, l'écriture, la fculpture
&
la
mufique, il a
re~u
fucceilivernent en dépot les em–
preintes du génie '
a
mefure que ces arts fe font per–
fettionn
1
S.
. N'eíl:-il pas étonnant que tant de fiecles fe foient
'écoulés' qu'on ait mis le bois
a
tant d'ufages diffé–
rens ,, fans qu'on ait coníl:até fes propriétés. Cette
tache étoit réfervée
a
nos jours. Jufque-1<\ on s'étoit
.horné aux idées peu juftes des ouvríers; on avoit
m
eme adopté l'eurs erreurs les plus groffieres. M. Du–
hamel du Monceau, apres avoir coníidéré dans la
phyfique des plantes le corps ligneux comme animé
par la vie végétale , l'a enfuite confidéré dans fon
étar d'inertie , comme une fubfiance compofée de
fibres capables de contraéhon
&
d'exteofion ,
&
comme cootenant de plus une feve fiagnante difpo–
fée
a
s'évaporer'
a
fe coaguler,
a
fermenter.
C'eft fous ces points de vue qu'íl a foumis pendant
quarante ans les bois de toutes les efpeces,
&
les
;memes efpeces prifes de tous les fols , de tous les
climats , de toutes lt=!S expofitions,
a
uqe foule d'ex–
périences variées fur tous les buts utiles, en tenant
~ompte
daos fes objets de cornparaifon des moindtes
différenees accidentelles.
De ce travail prodigieux il réfulte, outre des re–
gles certaines pour l'exploitation, le tranfport
&
la
.confervation du bois, un moyen fimple de le durcir
&
des procédés non moins praticables' par lefqueis
on le fait céder en l'attendriífant aux différentes cour–
bures des m.embres d'un vaiífeau.
MM.
Mariote, Leibnitz, Parent, Varignon s'é–
toient occupés de la maniere dont les corps fe rom–
pent,
M.
Duhamel ne s'efi pas contenté de répéter
leurs expériences , en les appliquant plus particulié–
.rement aux corps ligneux , illes a multipliées
&
di–
rig
1
es de maniere
a
s'aífurer daos prefque tOl
les cas
du dégré de réfiftance de ces corps ; on pc:mrra dé–
formais régler leurs fervices fur leur forces.
Telles font les connoiífances qui doivent cornpo–
fer
1'
article
B
o
IS ;
mais Otl les puifer , fi ce n'eft dans
les ouvrages de l'académicien qui a le premier porté
le flambeau de la phyfique dans cette région incon–
nue,
&
qui s'eft occupé toute fa vie, avec un zele
infatigable, de -tout ce qui a rapport aux premiers
befoins tles hommes? Illes chérit encore plus qu'il
n'aime la gloire littéraire,
&
fans doute que leur re–
connQifrance
'clair ' e luí décernera la palme de
Triptoleme , cent fois plus précieufe aux yeux de
la raifon, que la couronne dont l'enthoufiafme dé–
cera le front des Orph ' es.
Apres tant de
bi~'ns
que nous avons
re~us
des
plantes, pourrions-nous leur refufer un regard com–
plaifant? Pourquoi la nature les auroit-elle paré es
avec tant de coquetrerie? Pourquoi auroit-elle
dé~
pofé daos leurs calices les parfums les plus d 'licieux
_,
íi
ce n'ét
oit pour ravir nos ftms ?
Qui
d
1
ro.bale preroier
1
lys
a1.1
allon?
qui per-
BOT
feél_ion~a
ie rofier des rochers ? I1
'taloit d 'ja dans
le~ Jardin~
de,
M
~das
tour le luxe de fa fleur. Qui ap–
pr_lt
a
Alcm_e a fa1re ferpenter les eaux !impides par–
miles arbnífeaux? On ne connoit pas l'inventeur de
~art
de le
N
orre ;_ mais
il
eft aifé de fentir qu il dnt
erre un des prem1ers fruits d'une foci ' t ' cu tiv ' e.
quel efi l'homme .fenfible. qui ait
~u
,
m '
ditant pres
d une cafcade
~
votr un nuíTeau fLur dans la prairie
&
fe perdre dans
1
ombre des bois , fans d firer
d~
tranfporter ce payfage pres de fa maifon? Le
tapis
ver~s
,
~es
fleurs
1
les arbres
&
les eaux compofent
les Jardms d'agrémens ,
&
indiquent les
articies
PARTERRE' BOULINGRIN' PARC
&
BOSQUET.
L'entente des bofquets a rapport
a
plufieurs d'en–
tre
les
beaux arts. C'eft peindre que de marier
ou
d'oppofer d'une maniere agréable tous les tons dtt
verd,
&
toutes les nuances des
fleur~.
Que l'on
forme avec la feuillée des paliífades, des ceimres des
pilafires, on imite l'art des Vitruves;
&
cette'
ar–
chitetture naturelle, qui ménte fous ce nom un ar–
ticle particulier, fert de nuance
&
(le paífage entre
les ornemens fymmérriques du chateau,
&
les lieux
écartés d'un jardín Otl
la
nature doit paro!tre ave
e
les graces du négligé. Les bofquets entretiennent
la
d<;)Uce
reverie ' qu'ils peuvent quelquefois faire
naitre
:
qui n'entendroit
le
langage d'une rofe pen–
chée contre un cypres' d'un olivíer
a
l'ombre d'un
laurier? le jardinage d'agrément auroit-il fa poéfie?
La promenade eft inftruttive
la
o1t fe trouvent
réunies les plantes que la nature
a
difperfées fur le
globe_:
il
n'en efi pas une fi chétive qui ne puiffe
contnbuer
a
l'effet fynoptique d'un jardín' ou pro–
duire qnelqu'agrément de dérail; mais
il
les faut
placer a vee intelligence'
&
cet ufage doit etre indi–
qué ?ans
chact~n ?~ ~eurs
articles. Quelquefois
il
convten~
pour lutlhte de
~es raífemb~er.
Difpofées
par fam1lles, on
apper~o1t
au premter coup-d'ceil
leurs traits communs de reífemblance, l'examen de
leurs différences particulieres en devient plus facile ..
Ce font plufieurs peuples rangés par tribus , chacune
a vee leur enfeigne ; on en peut faire ajfément le
dénombrement
&
la revue.
Mais parmi ces étrangers, plufienrs venus des
coteaux parfumés d'Yemen, des bords brttlans du
Niger o
u
des vallées 4élicieufes de Quito, ne peu–
vent fupporter notre température. Dans le tems
meme Ótl les feux de l'été nons femblent dévorans,
_illeur faut un climat artificiel gradué fur le leur;
il
leur faut des lieux fermés Oll puiffent toutefois etre
admis
&
l'air qui nourrit les plantes,
&
la lumiere
qui
les durcit
&
les colore. En parlant des divers
abris, nous avons déja indiqué les articles el.t ceu:x:–
ci doivent etre traités.
Du
refte tout ce qni a rapport
a
ces coll•éfions, doÍt etre traité dans
1'
article
J
ARDIN
DE BOTANIQUE.
Le travail dont nous nous fommes chargés fpécia–
lement, fe Lorne aux arbres
&
arbuftes de pleine
terre ,
&
aux articles généraux
&
didaéliques qui
y
ont rapport. Cependant lorfque fous des genres
qui renferment des efpeces dures,
il
s'en trouve de
délicates , il eíl: néceífaire que nous nous en occu–
pions; car ott le chercheroit-on, fi ce n'efi fous leur
dénQmÍnation générique.
Il
fuffit auffi qu'un genre
préfente une feule efpece ligneu(e pour que nous
devions le traiter,
&
daos ce cas nous ne pourrions
omettre de nous arreter anx efpeces herbacées qu'il
renferme.
Si le plan dont nous .donnons l'efquiífe, répond
aux vues daos lefquelles nous l'avons fait, il pourra
s'
'tendre aux objets qui fe trouvent au-dela des
bornes qu.e nous nous fommes prefcrires, comrne on
prolonge les lignes d'un quinconce planté dans ¡;¡n
quarré gén lrateur,
(M. le baron
DE
Tscnou
DI.)
BOTSCOP,
















