
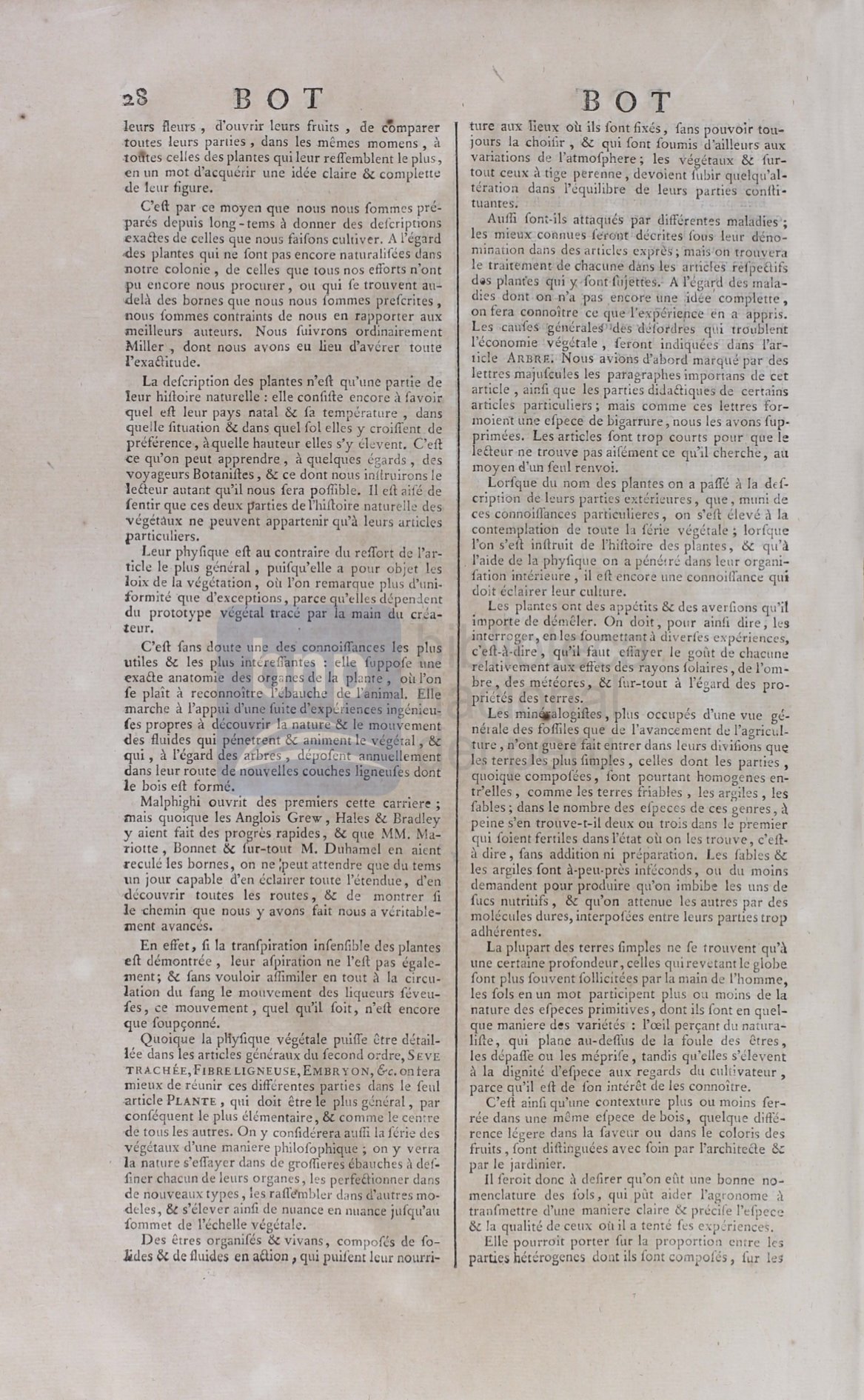
BOT
leurs
fleurs , d'ouvrir leurs fru!ts
,
de cómparer
toutes leurs parties ' dans les memes momens '
a
.toutes celles des plantes qui leur reífemblent le plus,
en
un mot d'acqu.érir une idée clair.e
&
complette
de leur figure..
C'eft par ce moyen que nous nous fommes pré–
-parés depuis long- tems
a
donner des defcriptions
exaél:es de celles que nous faifons cultiver.
A
l'égard
.des plantes qui ne font pas encore naturalifées dans
notre colonie, de celles que tous nos efforts n'ont
pu
encore nous procurer, ou qui fe trouvent au–
..dela
des bornes que nous nous fommes prefcrires,
nous {ommes contraints de nous en rapporter aux
meilleurs auteurs. Nous fuivrons ordinairement
Miller ., dont nous av-ons eu lien d'avérer toute
Pexaél:itude.
La defcription des plantes n'eft qu'une partie de
leur hiíl:oire naturelle : e11e conúíl:e encore
a
favoir
quel
efi
leur pays natal
&
fa température , dans
queile fituation
&
dans quel fol elles y croiífent de
préférence, aquelle hauteur elles
s
1
y
é1 event. C'efi
<:e
qu'on peut apprendre'
a
qnelques égards, des
voyageurs Botaniíl:es,
&
ce dont nous inHruirons le
leél:eur autant -qu'il nous fera poffible.
Il
eíl: aifé de
fentir que ces deux parties de l'hifioire naturelle des
végétaux ne peuvent appartenir qu'a leurs articles
particuliers.
I..eur phyiique eft
au
contraire
du
reffort de
l'ar–
ticle le -pl-us général , puifqu'elle a pour objet les
loix de la végétation, oli l'on remarque plus d'uni–
formité ·que d'exceptions, paree qu'elJes dépendent
<lu
prototype végétal tracé par la main
dn
créa–
teur.
C'eft fans doute une des connoiffances les plus
utiles
&
le-s plus intéreífantes : elle fuppofe une
exaél:e anatornie des organes de la plante, oll-l'on
fe
plait
a
reconnoitre l'ébauche de l'animal. Elle
marche a l'appui d'une fuite d'expériences ingénieu–
{es propres a découvrir la nature
&
le mouvement
d€s fluides qui pénetrent
&
animent le végétal ,
&
-qui '
a l'égard des arbres ' dép-ofent annuellement
dans leur route de nouvelles couches ligneufes dont
le bois efi formé.
Malphíghi ouvrit des premiers cette carriere ;
m-ais
quoique les Anglois Grew, Hales
&
Bradley
y
aient fait des progres rapides,
&
qne
MM. Ma–
Yiotte, Bonnet
&
fur-tout
M.
Duhamel en aient
..reculé les bornes, on ne ;peut attendre que du tems
1.10
jour capable d'en éclairer tonte l'étendue, d'en
découvrir toutes les routes ,
&
de montrer
fi
le
'Chemin que nous
y
avons fait nous a véritable–
ment avancés.
En effet,
íi
la tranfpiration infeniibie des plantes
efi
démontrée, leur afpiration ne l'eíl: pas égale–
·ment;
&
fans vouloir affimiler en tou
t
a
la circu–
lation du fang le mouvement des liqueurs féveu–
íes, ce mouvement, quel qu'il foit, n'eíl: encore
-que fou pc;onné.
Quoique la pnyíique végétale puiífe
~tre
détail–
tée dans les articles généraux du fecond o:-dre, S
E
vE
TRACHÉE;FIBRE LIGNEUSE, EMBRYON,
&c.
on tera
mieux de r éunir -ces différentes parties daos le feul
.article
PLANTE'
qni doit etre le plus général' par
·conféquent le plus élémentaire,
&
comme le centre
·de tous les autres. On y conúdérera auffi la férie des
végétaux d'une maniere philofophique ; on
y
verra
'
la nature s'eífayer daos de groffieres ébauches
a
def–
finer chacun de leurs organes, les perfeétionner dans
de nouveaux types, les raífe·mbler dans d'autres mo–
deles,
&
s'élever ainfi. de nuance en nuance jufqu'ati.
{ommet de l'échelle végétale.
Des erres organifés
&
vivans, compofés de fo–
a.des &
de
fluides en aaion
~
qui puifent
lcur nourri-
BOT
ture ame lieux
ou
ils font fixés, fans pouvoir tou–
jours la .choifir ,
&
qui fonr foumis d'ailleurs aux
variations
de
l'atmofphere; les végétaux
&
{ur–
tout ceux
a
tige perenne' devoient fubir quelqu'al–
tération dans l'équili.bre de leurs parries coníli •
ruantes.
·
Aufii
font-ils attaqués par
différent~s
rna1adies ;
les mieux COFlnues -fero't_:}t décrites fous leur
déno–
mínation dans des anides expres; mais on trouyera
le traitemeRt de cha-cn'?e dáns les artides fefpeél:ifs
d~s
plan(es qui
y.
font
fujett~s.
A l'égard des mala–
dies dont on n'a pas encore un_e .1dée' complette,
on fera conno1tre ce
que
l'e;·q5ériepce en a appris.
Les cau{es
~générales
Jdes déiordres qtli ttoublent
l'économie -vég<itale, feront indiqnées daos far–
ticle
ARBn.E.
Nous avioas d'abord marqué par des
lettres majuf-cules les par-agraphes importans de cet
anide , ainfi que les parties dídaél:iques de certains
articles particuliers; mais comme ces lettres for–
moient une efpece de bigarrure, nous les avons fup·
primées. Les articles font trop courts pour que le
leél:eur 9e trouve pas ai[émenr ce qn'il chere
he,
a
u
moyen cl'un fenl renvoi.
Lorfque du nom des plantes on a paífé
á
la def–
cription de leurs parties extérieures, que, mnni de
ces connoiífances particulieres, on s'efi élevé
a
la
contemplation de tou'te la férie végétale ; lorfque
l'on s'efi: infi:ruit de l'hiíloire des plantes,
&
qu' a
. l'aide de
la
phyíique on
a
péné!ré daos lenr organi–
fation intérieure , il efi encore une connoiífance qui
doit éclairer leur culture.
Les plantes ont des appétits
&
des avedions qu'il
importe de déméler. On doit, pour ainfi di re,
les
interroger' en les foumettant
a
diverfes ex périences,
c'eíl:-a-dire, qu'il faut eífayer le gout de chacune
relativement aux eff€ts des rayons folaires, de l'om·
bre' des météores'
&
fur-tour
a
l'égard des
pro~
priétés des terres.
Les min' a1Ggifi:es, plus o-ccupés d'une vue
gé~
nérale des foffiles que de l'avancement de l'agricul–
ture, n'0nt guere fait entrer daos leurs divifions que
les terres les plus fimples , celles dont les parties ,
quoique compofées, font pourtant homogen-es
en~
tr'elles, comme les terres friables , les argiles , les
fables; dans le nombre des efpeces de ces genres,
~
peine s'en trouve-t-il deux ou trois dans le p'remier
qui foient fertiles dans l'état ou on les tronve, c'efi–
a
dire , fans addition ni préparation. Les fables
&
les argiles font a-peu·pres inféconds' ou du moins
demandent pour produire qu'on imbibe les uns de
fucs nutritifs,
&
qu'on attenue les autres par des
molécules dures, interpofées entre leurs parties trop
adhérentes.
La pluparr des terres fimples ne fe tronvent' qu'a
une certaine profondeur, celles qui rev tant le globe.
font plus fouvent follicirées par la main de l'homme,
les fols en un mot participen! plus ou rnoins de la
nature des efpeces primirives, dont ils font en quel–
que rnanier.e des variétés : l'reil per<;ant du natura–
lifie' qui plane au-deffus de la foule des erres'
les dépaffe ou les méprife, tandis qu'elles
~·
' levent
a
la dignité d'efpece aux regards
du
culu vateur,
paree qu'il efi de ion jntérét de les conno1tre.
C'efi ainú qu'une contexture plus ou moins fer–
rée daos une meme efpece de bois, quelque difFé–
rence légere dans la favenr ou dans le coloris des
fruits, font diftii1guées avec foin par l'architeéte
&
par
le
jardinier.
Il
feroit done
a
deíirer qu'on etit une bonne no–
menclarure des
{ols'
qui püt aider l'agronome
a
tranfmettre d'une maniere claire
&
préci fe l'efpe ce
&
la qnalité de cenx oü il a tenté fes e périen e .
Elle pourroit porter fur la proportion entre les
parti~s
hétérogenes dont ils font compo fés, fur
le5
















