
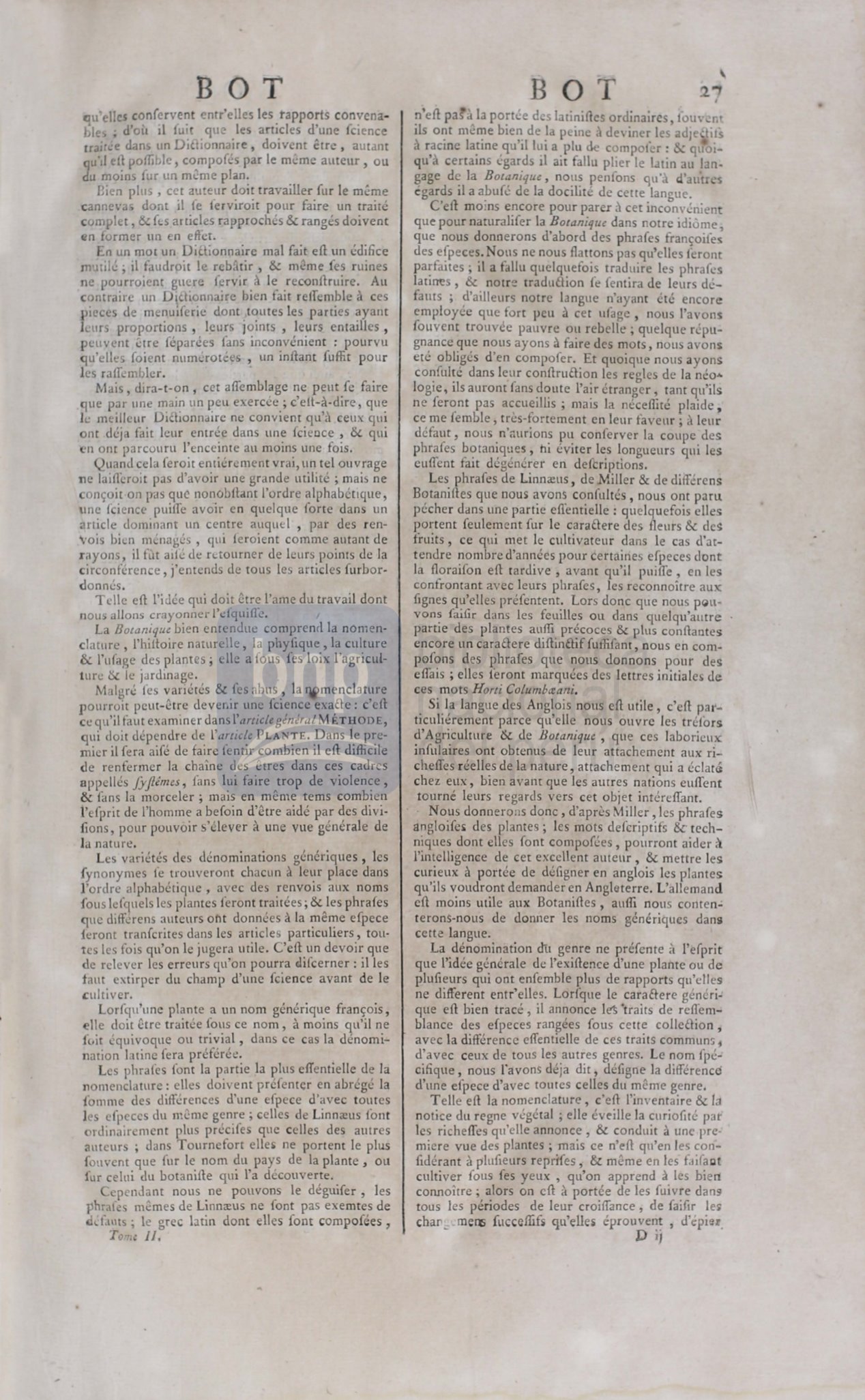
BO
1
es
con(cr 'ent n r'e .es les rappons con ena-
Jl
· d'ou
il
1
i
qu
les arríe es d une
(
ienc
rrai ·
·e
dan un
j
ionnaire , doiven·
tr
,
au ant
qu'1l e· pofli
le
com oú' par le m..:m...
am
ur ou
du
moin
t
r u m
m
lan.
~·en
plus
ce r
·u. ur
doit ra ailler fur le
m~me
canr.evar,
d •
t
il
ie
ierviroir pour faire un
traii~
t
f....
s at
ü
l
s rappro h
~s
&
rang
1
s doi vent
n cAct.
•n
un mor
un
i ·
onnaire mal faic efi un
1
difice
n
ti
.
il
audr ir le r batir '
&
meme es ruines
nc
po rroienr
gt
er
fer
ir
le reconihuire.
Au
e r
rair
un
Di
tionnaire bien fait
reH~
mble a ces
pie
es
de
m
nui erie dont toutes le parties ayant
1
urs proportions
leur
joinrs , leurs entaill s ,
pcu vcnt Gtre épan.:cs fan
inconvéni nt : pour
u
u'e !le!;
(¡
i
nt
um
~rot ~
, un infrant fuffit pour
les
rafll~mbl c r.
·
Mais
dira-t-on, cct aífemblage ne peut
{¡
faire
ue
par une main 11 n
pcu
e.·ere '
e ;
e eit-a-dire, que
le
meillcur
1
honn tr
n
onvient qu'é ceu · qui
nt déj
fait leur entrée dan une
{
ieoce ,
&
qui
n
om parcouru
1'
n einre au moins une fois.
uand ela fe roir
nriér~..menr
vrai, un tel ouvrage
ne
la iflcro it pa d'a\ oír une grande utilít ' ; mai ne
on~
ir
on
pas
que nonobllant l'ordre alphab ' ttque,
me fci ence
puiife
avoir en quelque fort dans un
· rticl e dommant un centre auquel , par des ren–
voi bien
m ·
nag
~
,
c¡ui
fe roí nt comme autant de
rayon ,
il
fut
alil.
de rl.tourner de
1
urs points de la
cir
onfére n e , j'ent nds de tous le anides furbor·
donné •
t.'llc
eíl:
l'i
ée qui doit ctre l'ame du travail dont
nou
allons crayonner
1\.Jquiíl~.
La
Botanique.
bien ent ndne omprenclla nomen–
clat ure ,
l'hiitoire natur ll e , la phyiique,
la
culture
' l'ufage des plant s;
ll
a
ous fes loix: l'agricul–
turc
&
le
jardinage.
1
nlgr~
.le
~ariétés
&
_fes
:1hn~
.'
la
menclat~tre
pourroir pcur-etre devemr une fctence exaél:e:
e
efi
ce
qu'il faut e am1ner dan
1'
article gJnüal
MÉTHODE,
qui doit dép:n,dre
d~
l'
a:tic~e
PLA1.
!E·
J=>ans l_e
p~e
mia
il fera a1fe de fa1r
íent1r comb1en
Il
efi dtffictle
de ren ermer la cha1nc dt.:s etres dans ces cadr
s
appdle
fyJUm
s,
ian
l~i
faire ...trop de
violen~e,
&
fans la morceler ; ma1s en meme tems combten
l'
fprit de
1
homme a befoin d "tre aidé par des di i–
:fion
pour pouvoir
~·
lever
a
une vue générale de
la narure.
Les variét
's
d s dénomina tions g 'nériques ,
les
fynonymes te trouveront chacun
a
leur place dans
1
ordre alphab 'tique, ay ee des renvois aux noms
fou s lcfquels le plantes feront trairées;
&
les phrafes
qu
diff.:rens
3\H
urs ont données
a
la meme efpece
1eront tran(! rites dans
1
s article particuliers, tou–
tc
les fois qn on
1
jugera urile.
'efi un de oir que
e rclever les erreurs qu on pourra difcerner : illes
faut
.
tirp r du champ d'une fcience
a
ant de le
cult iv r.
Loríqu'unc
p
ante
a
un nom g'n rique
fran~ois,
lle doir ctrc
trait~.:e
fous ce nom
a
moins qu'il ne
f
.ir
~qu\ oqu~
ou
t~i_vi~l
, daos ce ca la d 'nomi–
nar
ion htin {era pr
t r
.
Les hral s font la partie la plus
íTentielle de la
n
menclatur : lle doi\·ent pr ' fenter en abr
1
g ' la
f
m
me
des
differences
d
une efpece d'avec toutcs
le
fp e s du m
1
mc
gen_r~
· cell s de Linnreus font
1
Jin tr m
nt
plu pre
1ie
que celles des amres
aurcur
·
Jan Tourn fort elles ne portent le plus
l)n ·
nt qu e fur le nom du pays de
la
plant
, ou
f
1r elui
Ju
botaniite qni
l'a
d~.,;cOtlYerte.
\: p
1
lant nou s ne ponvons le deguifer
les
·'" m-.:mes de
inn::eus n
font pas e. emt
s
de
l tin dont elles font compo es ,
o
. 'efi. pa a la or 'e d..s
unlllcs or jnair
ils
o~t
m
~e bi e~
de _la
eine
~
de \ iner
s
j
·
it
a
r.acm
la~tne
lqu
tll
!1
a
0
~~
c~m p
1:. r :
T
quoi-
gu
e
en ms egards
1l
a
a
ta
1
he le
l
·
n u
an-
gage de
la
B ot niqt e,
no
1s
enlo
s
qu'·
au
égards
il
a abu
~-
de la doc1h
de.:
· e
1
n" te.
'eíl
mo:ns encore pour par
r .\
et
in
;nv~ni
que pour na urali er la
Botaniqru
dans POtr
id ion e
que n_ous donnerons d"abord des phra(¡
fran~oife
des e{ peces.
1
ons ne nous flatton pa
qu
elles { .ron
pa:faites ·
il
a tallu quetquefoí
trad tire le phrafes
lanrres ,
'
notr- tradu
ion
{e
i
ntir de leur dé–
faurs ; d'ailleurs notre langue n'·tyanc
c.:.té
encore
employc que orr
peu
a
cet ufao
' nou
1
a ·on
fou enr trou
·e pauvre ou reb lle ; quelque r
~pu-
gnance que nous ayons
aire drs mot , nou a on
re oblig ·s d'en compofer. Et quoique nous ayons
confultc dans leur confrru
ion le:s regles de la n
~o
logie, ils auront fans
~out
e l'air ' tranger
rant qu
il
ne
fer~nt
pas
accu~1llis
; mais la né ellité plaid
,
ce me íemble' tres-fortement en leur faveur ;
a
leur
dcfaut, nous n'<mrions pu conferver l coup des
phrafe botaniques,
hi
évirer les longu urs qni
1
s
euffi nt fait d
'g
1
n
1
rer en deí riptions.
Les phrafes de Linn<l!us, de Miller
&
de di$ ' reos
Botaniíles que nous avons confult
1
,
nous ont paru
pécher dans une partie eíl'entielle : quelquefois ell
portent feulement fur le caraél:ere des fleurs
&
des
ti-uits, ce qui met le cultivateur dans le ca d'ar–
tendre nombre d'ann
res
pour certaine efpeces dont
la floraifon efi tardive , avant qu'il puiífe, en le
confrontan!
a\' e
leurs phrafes, les reconnoítre
a
u -
úgnes qu'elle préfentent. Lor done que nous
p(~m
vons
faiíir
dan
les fcuilles ou dan
quelqu autre
partie des ¡_:>lantes aufli précoces
&
ptus coníl:antes
encore un caraél:ere diftmél:if futñfanr, nous en com–
p0fons des phrafes que nous donnons pour des
eífais ; elles feront marquées des lertres initiales de
ces mots
Horti
Colu,mhfEani.
Si
la langue des Anglois nous eíl utile, c'efi
par–
ticuliérement paree qlt'elle nous ouvre les tréíors
d'Agriculrme
&
de
Botanique
,
que ces labori
lL
infulaires ont obtenus de leur attachement
aux
ri–
cheffes réelles de la nature, attachement qui a
éclat '
chez eu. , bien a
'ant
que les aurres nations euffent
tourn' leurs regards
ers cet objet intéreífam.
Nous donnero ns done, d'apres
Mili
r, les phrafes
angloif; s des plantes ; les mots d fcriptifs
&-
tech–
niques dom elle
font compof; ' es, pourront aider
l'intelligence de cet
e
cellent autenr ,
&
met re les
curieux
a
port, e de d
1
íigner en anglois les plantes
qu'ils voudront demander en Angleterre. L'allemand
eft moins utile aux Botaniíl:es , auffi nous conten–
terons-nous de donner les noms génériques dans
cctte langue.
La
dénomination
cht
genre ne préfcnte
á
l'efprit
que l'idée gén 'tale d l'exifience d'une plante o
u de
pluíieurs qui ont enfemble plus de rapports qu'ell es
ne dilferent entr'elles. Lorfque le caraél:ere gén
1
ri–
que efr bien trae' , il annonce
1~
'traits de reflem...
blance des efpeces rangées fous cette coll élion ,
avec la différence eífentielle de ces traits
commun~
d'avec ceux de tous les autres genre . Le nom fpé–
ciñque, nous l'avons d 'ja dit, d íigne la ditf, rence
d'ttne efpece da ec toutes celles du méme genre.
Telle eíl la nomenclature, c'efi
1
inventaire
&
la
notice
du regne végétal ; elle
é
~ille
la curioíir ' par
1
s
richeífes qu elle annonce ,
&
concluir a une
pre·
miere vue de
lantes ; mais ce n'efi qu'en les con–
fid
1
rant a plufieurs reprifes '
&
meme en les f:tifa a
cultiver fous fes yeux , qu'on appr nd
a
les bien
connottre. alors on cfi
a
portée de les fuivre dan_
tous
1
s périodes de leur croilfance , de
aifir
l e~
char m
lli
íi
tcc~ffif:
qu'ell
éprou
ve1~~
, d' 'pie:.
IJ
















