
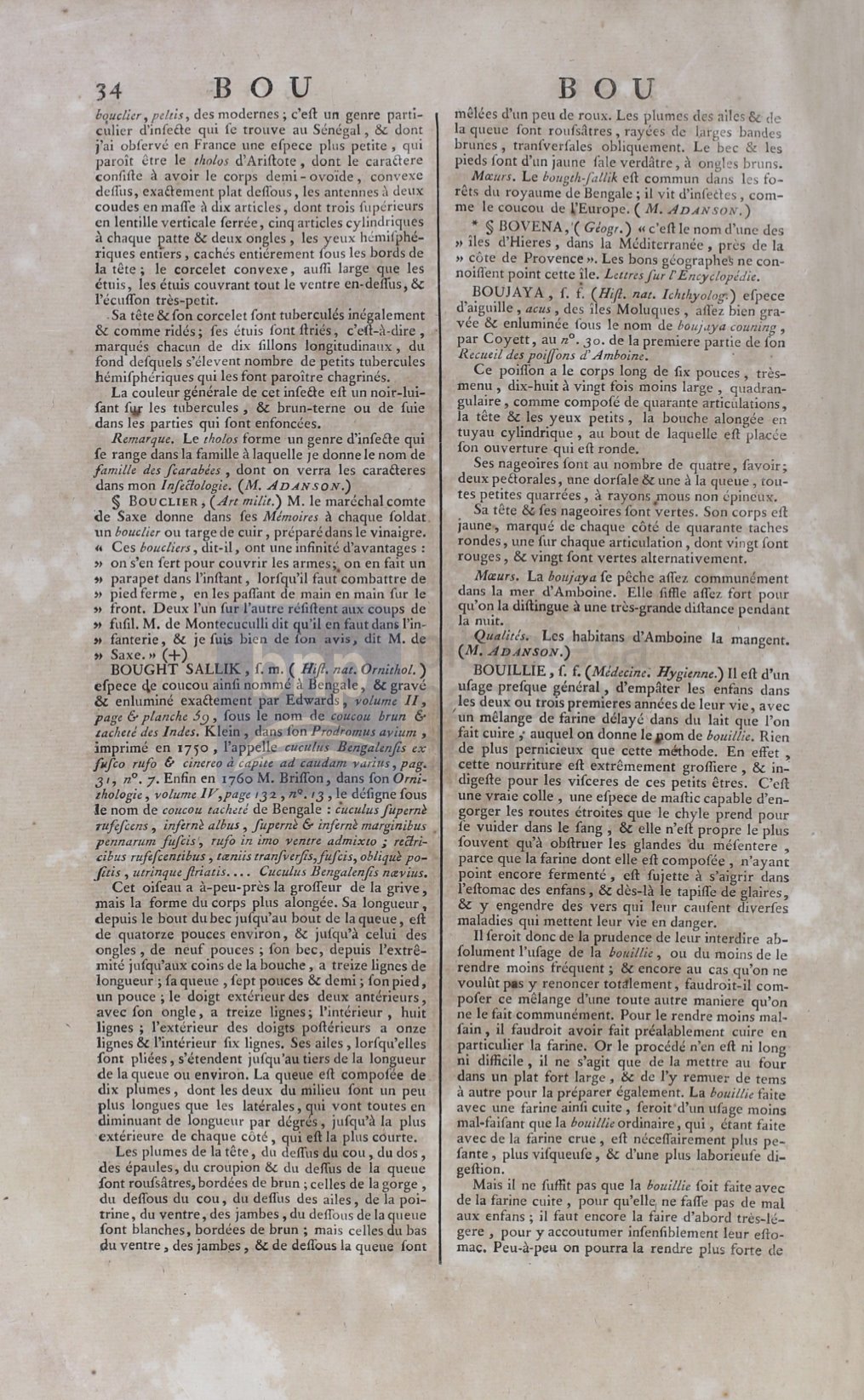
34
BOU
houclier, peltis,
des modernes; c'efr
un
genre parti–
c¡llier d'infeél:e qui fe trouve au Sénégal,
&
dont
j'ai obfervé en France une efpece plus petite, qui
paroit etre le
tfzolos
d~Arifrote
, dont le caraétere
coníifie
a
avoir le corps demi- ovo!de, convexe
deífus, exaétement plat deífous' les anteones
a
deux
co~des
en maífe a dix articles' dont trois fupér.ieurs
en lentille verticale ferrée, cinq articles
cyli?d:tqu~s
achaque patte
&
deux ongles' les yeux hemlfphe–
riques entíers, cachés entiérement fous les bords de
la tete; le corcelet convexe, auffi large que les
étuis, les étuis couvrant tout le ventre en-deffi.1s,
&
l'écuífon tres-petit.
_Sa tete
&
fon corcelet font tuberculés inégalement
&
corrime ridés; fes étuis font ftriés, c'eft-a-dire,
marqués chacun de dix fillons longitudinaux, du
fond defquels s'élevent nombre de petits tubercules
hémifphériques qui les font paroitre chagrinés.
La couleur générale de cet infeae eft un noir-lui–
fant
!i
les tubercules
,
&
brun-terne ou de fuie
dans les parties qui font enfoncées.
Remarque.
Le
tholos
forme un genre d'infeéte qui
fe range dans la famille
a
laquelle je donne le nom de
famille des fcarabées,
dont on verra les cara8:eres
dans mon
lnfiélologie. (M. .ADANSON.)
§
BoucLIER,
(Art milit.)
M.
le maréchal_comte
oe Saxe donne dans fes
Mémoires
a
chaque foldat
un
bouclier
ou targe de cuir, préparé dans le vinaigre.
" Ces
boucliers,
dit-il, ont une infinité d'avantages :
, on 's'en fert pour couvrir les tUrnes; on en fait un
" parapet dans l'infrant, lorfqu'il faut combattre de
" pied ferme , en les paífant de main en main fur le
~•
front. Deux l'un fur l'autre réfifient aux coups de
)' fufil.
M.
de Montecuculli dit qu'il en faut dans l'in–
}) fanterie,
&
je fuis bien de
fon avis,
dit M.
de
,
Saxe.
~'
(
+).
BOUGHT SALLIK,
f.
m. (
Hift.
nat. Ornithol.)
efpece 4e coucou ainfi nommé a Bengale,
&
gravé
&
enluminé exaaement par Edwards,
volume 11
:~
page
&
planche .59
,
f~n1s
le nom
d~
coucou
br~n
&
tacheté des Jndes.
Klem, dans fon
Prodromus avlum,
imprimé en
1750,
l'~ppe~e
cuculus Bengafenjis ex
f~tfco
rufo
Y
cinereo a captte ad caudam vanus, pag.
JI,
n.
0 .
1·
Enfin en 17'6o M. Briífon, dans, fon
Orni–
thologie, volume TV,page
13
2 ,
n°.
'3
,
le defigne fous
le nom de
coucou tachué
de Bengale :
c'uculus fuperne
rufefcens
,
inftrne albus
,
fuperne
&
inferne marginibus
pennarum fufcis
',
rufo in imo ventre admixto
;
reétri–
~ibus
ruft{centíhus, taniis tranfveifzs,fufcis, oblique po–
Jitis, utrinque firiatis .•.• Cuculus Bengalenjis nawius.
Cet oifeau a a-peu-pres la groífeur de la grive,
mais la forme du corps plus alongée. Sa longueur,
depuis le bout dubec jufqu'au bout de la queue, eft
de quatorze pouees environ,
&
jufqu'a celui des
ongles, de neu.f pouees ; fon bec, depuis l'extre–
mité ju(qu'aux coins de la bouche, a treize lignes de
longueur ; fa queue , fept pouces
&
demi ; fon pied,
un pouce ; le doigt extérieur des deux antérieurs,
avec fon ongle , a treize lignes; l'intérieur , huit
lignes ; l'extérieur des doigts pofrérieurs a onze
lignes
&
l'intérieur ftx lignes. Ses ailes, lorfqu'elles
font pliées, s'étendent jufqu'au tiers de la longueur
de la queue ou environ. La queue efi compofée de
dix plumes, dont les deux du milieu font un peu
plus longues que les latérales, 9ni vont toutes en
diminuant de longueur par dégres, jufqu'a la plus
extérieure de chaque coté' qui efr la plus courte.
Les plumes de la tete, du deífus du cou , du dos ,
des épaules, du croupion
&
du deífus de la queue
{ont
rotús~tres,
bordées de brun; eelles de la gorge,
du deífous du cou, du deífus des ailes , de la poi–
trine, du ventre, des jambes, du deífous de la queue
font blanches, bordées de brun ; mais celles du has
du
ventre
~
des
jamb~s
,
&
de deífous la quene font
BOU
melées d'un peu de roux. Les plumes des ailes
&
de
la queue font roufs&tres , rayées de l.arges bandes
bnu1es, tranfverfales obliquement. Le bec
&
les
pieds font d'un jaune fale
verd~tre'
a
ongles bruns.
Mcxurs.
Le
bougth-Jallik
efr commun dans les
fo–
rets du royaume de Bengale ; il vit d'infetles, com–
me le coucou de l'Europe.
(M. A DANSON.)
*
§
BOVENA ,'(
Géogr.)
(<
c'eft le nom d'une des
,. iles d'Hieres , dans la Méditerranée , pres de la
>•
cote de Provence ''· Les bons géographes ne con–
noiífent point cette ile.
Lettres fur
l'
Encyclopédie.
BOUJAYA,
f.
f.
(Hijl.
nat. Ichthyolog. )
efpece
d'aiguille ,
acus
,
des iles Moluques , aiiez bien gra–
vée
&
enluminée fous le nom de
boujaya couning,
par Coyett,
a
u
n°. 3
o.
de la premiere partie de fon
Recueil des poijfons d'.Amboine.
·
Ce poiífon a le corps long de úx pouces , tres–
rnenu , dix-huit a vingt fois mOÍf\S large , quadran–
gulaire, comme compofé de quarante articulations,
la tete
&
les yeux petits ,
la bouche alongée en
tuyau cylindrique , au bout de laquelle eft placée
fon ouverture qui efi ronde.
Ses nageoires font a
u
nombre de quatre, favoir;
deux peél:orales' une dorfale
&
une a la queue ' tou–
tes petites quarrées'
a
rayons mous non épineux.
Sa tete
&
fes nageoires font vertes. Son corps efr
jaune '
marqué de-chaque coté de quarante taches
rondes,
u.nefur chaque articulation, dont vi ngt font
rouges,
& vingt font vertes alternativement.
M~urs.
La
boujaya
fe peche aífez communément
dans la rner
d'
Amboine. Elle fiffie aífez fort pour
qu'on la difiingue
a
une tres-grande diftance pendant
la nuit.
,
Qualités.
Les habitans d'Amboine la rnangent.
(M.
.ADANSON.)
BOUILLIE,
f.
f. (
Médecine; Hygienne.)
I1
eft d'un
ufage prefque général , d'empater les enfans dans
les deux ou trois prernieres années de leur vie, ave
e
1
un melange de farine défayé dans du lait que l'on
fait cuire ; auquel on donne le om de
hquillie.
Rien
de plus pernicieux que cette mélthode. En effet ,
cette nourriture eft extremernent groffiere ,
&
in–
digefte pour les vifceres de ces petits etres. C'cfr
une vraie colle, une efpece de rnaftic capable d'en–
gorger les routes étroites que le chyle prend pour
fe vuider dans le fang ,
&
elle n'efi propre le plus
fouvent qu'a obftruer les glandes du méfentere ,
paree que la farine dont elle efi compofée, n'ayant
point encore fermenté' eft fujette
a
s'aigrir dans
l'efromac des enfans,
&
des-la le tapiífe de glaires,
& y
engendre des vers qui leur caufent diverfes
maladies qui mettent leur vie en danger.
Il feroit done de la prudence de leur interdire ab–
folument l'ufage de la
bouiltie
,
ou du rnoins de le
rendre moins fréquent;
&
encore au cas qu'on ne
voulí'tt pas
y
renoncer tot<tlement, faudroit-il com–
pofer ce melange d'une toute autre maniere qu'on
ne le fait communément. Pour le rendre moins mal·
fain, il faudroit avoir fait préalablement cuire en
particulier la farine. Or le procédé n'en efi ni long
ni difficile , il ne s'agit que de la mettre au four
dans un plat fort large
3
&
de
l'y
remuer de tems
a autre pour la préparer également. La
bouillie
faite
avec une farine ainfi cuite, feroit d'un ufage moins
rnal-faifant que la
houillie
ordinaire, qui , étant faite
avec de la farine ente , eft néceífairement plus pe–
fante , plus vifqueufe ,
&
d'une plus laborieufe di–
gefrion.
Mais il ne fuffit pas que la
bouillie
foit faite avec
de la farine cuite , pour qu'elle
1
ne faífe pas de mal
aux enfans; il faut encore la faire .d'abord tres-lé–
gere
,
pour
y
accoutumer infenfiblement leur efto–
rnac. Peu-a-peu on pourra la rendre plus forte de
















