
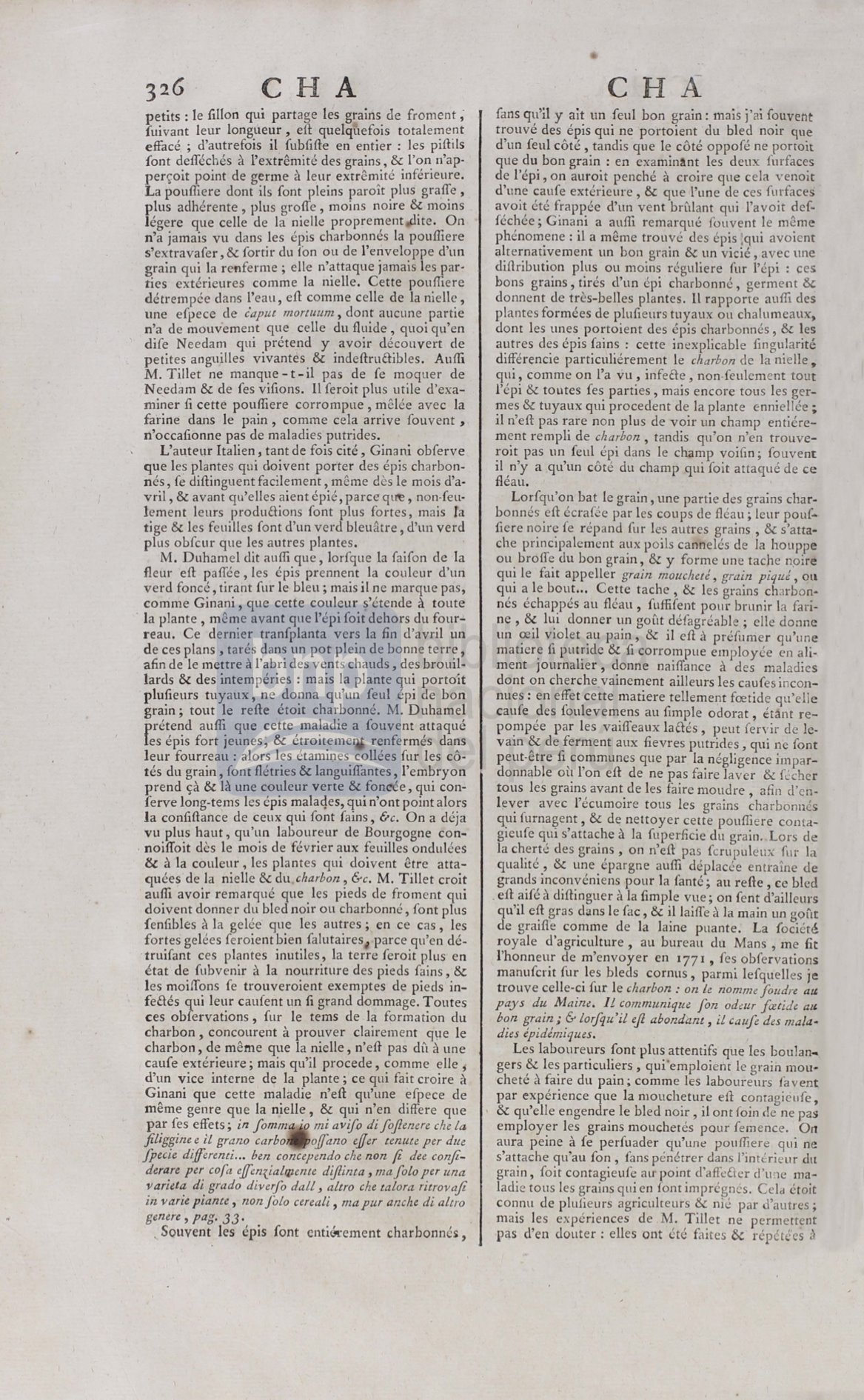
CHA
petits : le ftllon qui partage les grains. de froment;
íuivant leur longneur , efr quelquefo1s totaleme!lt
effacé ; d'autrefois il fubíifie en entier :
les
piíbls
font deíféchés
a
l'extremité des grains'
&
l'on n'ap·
per~oit
point de germe
a
leur exrremíté inférieure.
La pouffiere dont ils font pleins paroit .plus
gra~e
,
P
lus adhérente plus aroífe , moms n01re
&
moms
'
b
d'
o
Iégere que celle de la nielle proprement 1te.
n
n'a jamais vu dans les épis charbonnés la pouffiere
s'extravafer
&
fortir du fon ou de l'enveloppe d'un
grain qui la
~enferme;
elle
n'~ttaque
jamais les par·
ties extérieures comme la melle. Cette pouffiere
détrempée dans l'eau, eíl: comme celle de la nielle,
une efpece de
c"aput mortuum,
dont aucune partie
n'a de mouvement que celle du fluide, quoi qu'en
' dife
N
eedam qui prétend
y
avoir découvert de
petites anguilles vivantes
&
indefiruél:ibles. Auíli
M.
Tillet ne manque-
t-
il pas de fe moquer de
N
eedam
&
de fes viíions.
11
feroit plus
u
tile d'exa–
mi~er
íi cette pouffiere corrompue, melée avec la
farine dans le pain, comme cela arrive fouvent
,
n'occaíionne pas de maladies putrides.
L'a~teur
Italien, tant de fois cité, Ginani obferve
que les plantes qui doivent porter des épis charbon–
nés' fe difiinguent facilement' meme des le mois d'a–
vril,
&
avant qu'elles aient épié, paree qu'e, non-feu·
lement. leurs produél:ions font plus fortes, mais la
tige
&
les feuilles font d'un verd bleuatre, d'nn verd
plus obfcur que les autres plantes.
M. Duhamel dit auffi que, lorfque la faifon de ·la
fleur eíl: paífée, les épis prennent la couleur d'un
verd foncé, tirant fur le bleu; mais il ne marque pas,
comme Ginani, que cette couleur s'étende
a
toute
la plante' meme avant que l'épi foit dehors du four–
reau. Ce dernier tranfplanta vers la fin d'avril un
de ces plans , tarés dans un pot plein de bonne terre,
afin de le mettre
a
l'abri des vents chauds' des brouil–
lards
&
des internpéries : mais la plante qui portoít
plufieurs tuyaux, ne donna qu'un feul .épi de bon
grain; tout le refie étoit charbonné. M. Duhamel
prét,e~d
auffi: que cette,
rna~adie
a fouvent
~ttaqué
les epts fort 1eunes;
&
etrotteme
renferrnes dans
}eur fourreau : alors les étamÍr)eS collées fur les
CO–
tés du grain, font flétries
&
languiífantes, l'embryon
prend
c;a
&
la une couleur verte
&
foncée, qui con–
ferve long-teros les épis rnalaqes, qui n'ont point alors
la confillance de ceux qui font fains,
&c.
On a déja
vu plus haut, qu'un laboureur de Bourgogne con–
noiffoit des le mois de février
aux
feuilles ondulées
&
a la couleur' les plantes qui doivent etre atta–
quées de la nielle
&
du
charbon, &c.
M. Tillet croit
auffi avoir remarqué que les pieds de froment qui
doivent donner du bled noir ou charbonné, font plus
fenfibles
a
la gelée que les autres; en ce cas' les
fortes gelées feroientbien falutaires paree qu'en dé–
·truifant ces plantes inutiles, la terre feroit p.lus en
état de fubvenir a la nourriture des pieds fains'
&
les moiifons fe trouveroient exemptes de pieds in–
feél:és qui leur canfent un fi grand dommage. Toutes
ces obfervations, fur le tems de la formation du
charbon ' concourent
a
prouver clairernent
q~le
le
charbon' de meme que la nielle' n'efr pas dfi
a
une
caufe extérieure; mais qu'il procede, comme elle ,
cl'un vice intcroe de la plante; ce qui fait croire
a
Ginani que cette maladie n'efi qu'une efpece de
meme genre que la nielle'
&
qui n'en differe que
par fes effets;
in fomma ·o mi avifo di foflenere che La
filiggine e
il
grano carbo
oJ{ano e.fler tenute per due
fpecie dif{erenti..• ben concependo che mm
ji
dee conji-
derare per cofa e.f!entialr¡¡.ente dijlinta, mafolo per una
varieta di grado diverfo dalt, altro che talora ritrovaji
in varíe piante, nonJolo cereali, ma pur anche di altro
genere
,
pag. 3 3.
Souvent les épis font entié.:ement charbonnés,
CHA
fans qn'il y ait un feul bon grain: mais j'ai fouvetlt
trouvé des épis qui ne portoient du bled noir
que
cl'un feul coté ' tandis que le coté oppofé ne portoit
que du bon grain : en examinant les deux furfaces
de l'épi, on auroit penché
a
croire que cela venoit
d'une caufe extérieure ,
&
que l'une de ces furfaces
avoit été frappée d'un vent brt'tlant qui l'avoit def–
féchée; Ginani a auffi remarqué fouvent le meme
phénornene :
il
a meme trouvé des épis :qui avoient
alternativement un bon grain
&
un vicié, avec une
dillribution plus ou moins réguliere fur l'épi : ces
bons grains, tirés d'un épi charbonné, germent
&
donnent de tres-belles plantes.
Il
rapporte auffi des
plantes formées de pluíieurs tuyaux ou chalumeaux,
donr les unes portoient des épis charbonnés,
&
les
autres des épis fains : cette inexplicable fingularité
clifférencie particuliérement le
charbon
de la nielle
~
qui, comme on l'a vu, infeB:e, non feulement tout
l'épi
&
toutes fes parties, mais encore tous les ger–
mes
&
tuyaux qui procedent de la plante enniellée;
il n'eft pas rare non plus de voir un champ entiére–
ment rempli de
charhon,
tandis qu'on n'en trouve–
roit pas un feul épi dans le champ voifin; fouvent
il n'y a qu'un coté du champ qui foit attaqué de ce
fléau.
Lorfqn'on bat le grain, une partie des grains char–
bonnés efr écrafée par les coups de fléau; leur pouf–
fiere noire fe répand fur les autres grains ,
&
s'atta–
che principalement aux poils cannelés de la houppe
ou broífe du bon grain,
&
y
forme une tache npire
qui le fait a.ppeller
grain moucheté, g¡ain piqué,
Oll
qui a le bout... Cette tache ,
&
les grains charbon·
nés échappés au fléau, fuffifent pour brunir la fari–
ne ,
&
lui donner un goftt défagréable ; elle
do~me
un
~il
violet
~u
pain'
&
il eft
a
préfume,r qu'une
matlere
íi
putnde
&
fi corrompue employee en ali–
ment journalier ' donne naiffance
a
des maladies
clont on cherche vainement ailleurs les caufes incon–
nues: en effet cette matiere tellement fretide qu'e1ie
caufe des íoulevemens au fimple odorar , étant re–
pompée par les vaiífeaux laél:és, peut fervir de le–
vain
&
de ferment aux fievres putrides, qui ne font
peut-etre íi communes que par la négligence impar–
donnable oi1 l'on eíl: de ne pas faire laver
&
f~cher
tous les grains avant de les faire moudre, afin d'en–
lever avec l'écumoire tous les grains charbonnés
qui furnagent,
&
de nettoyer cette pouffiere conta–
gieufe qui s'attache a la fuperficie du grain. Lors de
la cherté des grains, on n'efi pas fcrupuleux fur la
qualité ,
&
une épargne auffi déplacée entraine de
grands inconvéniens pour la fanté; au refie , ce bled
. eíl: aifé
a
difringuer
a
la íimple vue; on fent d'ailleurs
qu'il efi gras dans le fac'
&
illaiífe aJa main un gofrt
de graiíle comme de la laine puante. La fociété
royale d'agriculture, au bureau du Mans , me
fit
rhonneur de m'envoyer en 177
I ,
fes obfervations
manufcrit fur les bleds cornus, parmi lefquelles je
trouve celle-ci fur le
charbon : on le nommefoudre au
pays du Maine.
ll
communique fon odeur fcetidr. au
bon grain;
&
lorfqu'il
ejl
abondant,
il
caufe des mala·
dies épidémiques.
Les laboureurs font plus attentifs que les boulan...
gers
&
les particuliers, qui·emploienr le grain mou·
cheté
a
faire du pain; comme les laboureurs favent
par expérience que la moucheture efi conragi eufe ,
· &
qu'elle engendre le bled noir, il ont foin de ne pas
employer les grains moucherés pour femence. On
aura peine
a
fe perfuader qu'une pouffiere qui ne
s'attache qu au fon' fans pénétrer dans l'int
1
rieur
nll
grain, foit contagieufe au point d'affeél:er d'une ma–
ladie tous Ies grains quien font imprégnés. Cela étoit
connu de pluíieurs agriculreurs
&
ni' par
'autres ;
mais les expériences de M. Tillet ne permettent
pas cl'en clouter : elles ont été faites
&
répét
''es
a
















