
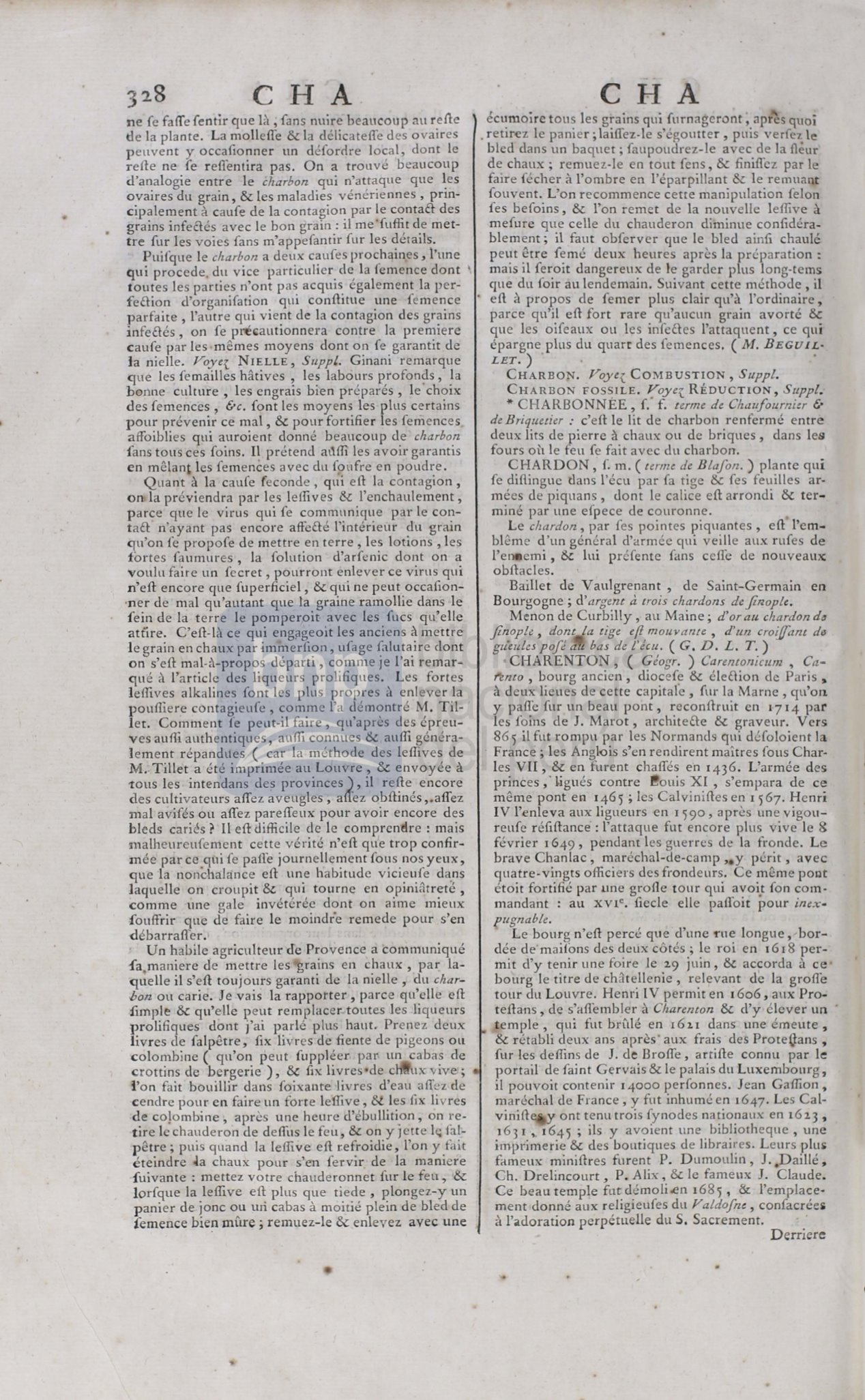
CHA
ne fe faífe fentir que la, fans nuire beaucoup au re!le
de la plante. La molleífe
&
la délicateífe des ovaire
peuvent y occafionner un défordre local, dont le
refre ne fe reífentira pas. On a trouv' beaucoup
d'analogie entre le
charbon
qui n'attaque que les
ovaires du grain,
&
les maladies véneriennes, prin–
cipalement
a
caufe de la contagien par le contaél des
grains infeélés avec le bon grain : il me· fuffit de met–
tre fur les voies fans m'appefantir fur les détails.
Puifque le
c!Larbon
a deux caufes prochaines., l'nne
qui procede dn vice particulier de la femence dont •
toutes les parties n'ont pas acquis également la per–
feélion d'organifation qui conftitue une femence
parfaite , l'atitre qui vient de la contagien des grains
infeélés, on fe precautionnera contre la premiere
caufe par les memes moyens dont on fe garantit de
la
nielle.
Voyez:
NI
ELLE,
Suppt.
Ginani remarque
q ue les femailles
h~hives
, les labours profonds, la
bonne culture , les engrais bien prépar 's , le choix
des femences,
&c.
font les moyens les plus certains
pour prévenir ce mal,
&
pour fortifier les fen1ences
affoiblies qui auroient donné beaucoup de
charbon
fans tous ces foins.
Il
prétend a
ffi
les avoir garantís
en melan les femences avec du foufre en poudre.
Quant a la caufe {econde, qui eíl: la contagien'
on la préviendra par les leffives
&
l'enchaulement,
paree que le virus qui fe communique par le con–
taél n'ayant pas encere affeélé l'intérieur du grain
<Jn'on fe propofe de mettre en terre, les lotions, les
fortes faumures, la folution d'arf< nic dont on a
voulu faire un fecret, pourront enlever ce virus qui
n'efl: encere que fuperficiel,
&
qui ne peut occafion–
·ner de mal qu'autant que la graine ramollie dans le
fein de la ten·e le pomperoit avec les fucs qu'elle
atfire. C'efi-la ce qui eng¡tgeoit les anciens
a
mettre
le grain en chaux par immerfion, ufage falutaire dont
on s'eft mal-a-propos départi, comme je l'ai remar–
qué a l'article des liqueurs prolifiques. Les fortes
leffives alkalines font les plus propres
a
enlever la
pouíliere contagieufe, comme l'a démontré M. Til–
ler. Comment fe pent-il faire, qu'apres des 'preu–
ves auffi authentiques, auffi connues
&
auffi gén
1
ra–
lement répandttes ( car la méthode des leffives de
M. Tillet a été imprimée au Louvre,
&
envoy' e
a
-tous les intendans des provinces ) , il reíl:e encore
des cultivateurs affez aveugles, aítez obfiinés ,.aífez
mal avifés ou aífez pareffeux pour avoir encere des
bleds cariés? 11 eíl: difficile de le comprendre : mais
tnalheureufement cette vérité n'efi que trop confir–
mée par ce qui fe pafle journellement fous nos yeux,
que la nonchalance efr une habitude vicieufe dans
laquelle on croupit
&
qui tourne en
opini~hreté,
comme une gale
invétérée dont on aime mieux
fouffrir que de faire le moindr'e remede pour s'en
débarraíler.
Un habile agriculteur de Provence a communiqué
{a maniere de mettre les grains en chaux , par la–
quelle il s'eít toujours garantí de la nielle, du
char–
.bon
ou carie.
J
e vais la rapporter, paree qu'elle efr
fimple
&
qu'elle peut remplacer toutes les liqueurs
prolifiques dont j'ai parlé plus haut. Prenez deux
livres de falpetre, fix li res de fiente de pigeons o u
colombine ( qu'on peut fuppléer par un cabas de
crottins de bergerie ) ,
&
fix livres ·de eh ux ive;
l'on fait bouillir dans foi. ante li res d'eau alfez de
eenclre pour en faire un forre leíiive,
&
les fix li vres
de colomb1ne, apre une heure d lbullition, on re–
tire le chauderon de deífus le feu,
&
on y jette 1 fal–
petre; puis quand la leffive efi refroidie, l'on y fait
éteindre
~a
chaux pour s'en fervir de la maniere
{uivante : mettez votre hauderonnet fur le fen,
&
lorfque la leffive efr plus que tiede, plongez-y un
panier de jonc ou uri cabas
a
moiti, plein de bled de
femence
bie~
mttre; remuez-le
&
enlevez avec une
CHA
écumoire tous les grains qui fnrnageront apr s quoi
retirez le panier; laiífez-le s goutter pnis verfe1 le
bl d dans un baquer · faupoudrez-le avec de la
fleur
de chaux ; remuez-le en tout
.D
ns
finiffi z par
l
faire
cher
a
1
ombre en
1'
1
parpillant
r
le remnant
fou en
t.
L on recommence cette manipnlation íelon
fes befoins,
&
l'on rem
t
de la nonv
lle
leffi e a
mefure que celle du chanderon diminue confid 'ra–
blement; il faut obferver que le bled ainfi chaulé
peut
~' rre
femé deux heures apr s la pr 'paration :
mais
il
feroit dangereux de le garder plus long-tems
que du foir au lendemain. Suivant cette m 'thode ,
il
. efi
a
propos de femer plus clair qu'a
1
ordinair ,
paree qu'jl efi fort rare qu'aucnn grain avorté
&
que les oifeaux o
u
les infeéles l'attaqnent, ce qui
épargne plus du quart des fe menees.
(M.
BEGULL·
LET.)
CHARBON.
P'oyt{
CoMBUSTION,
Suppl.
CHARBO
FO
ILE.
Voyez:
RÉDUCTION,
uppl.
*
CHARBONNÉE, f.
f.
terme
de
Clzaufourniu
é?
de Briquetier :
c'eft le lit de charbon renfermé entre
deux lits de pierre
a
chanx ou de briques' dans le9
fours ou le feu fe fait avec du charbon.
CHARDON,
f.
m. (
tenne
de
Blafon. )
plante qui
fe difiingue dans l'écu par fa tige
&
fes feuilles ar–
mées de piquans, dont le calice efr acrondi
&
ter–
miné par une efpece de cauronne.
Le
clzardon,
par fes pointes piqnantes, efr l'em–
bleme d'un général d'arm
1
e
qui
veille aux rufe de
l'en emi,
&
lui pr 'fente fans ceífe de nouveaux
obíl:acles.
Baillet de Vaulgrenant , de Saint-Germain en
Bourgogne; d'
argent
a
trois chardons de fin opte.
Menon de Curbilly, a
u
Maine;
d'
or au clzardon
d~
jinople, dont
la tige efl
mouyante
,
d'un croijfant dt}
gu·eule.s
pofé
au has
de l'écu.
(
G.
D. L. T.)
CHARENTON , (
Géogr.
)
Carentonicum
,
Ca–
rento
,
bourg ancien , diocefe
&
éleélion de Paris
~
a
deux lieues de cette capitafe, fur la Marne, qu'on
y paífe fur un beau pont , reconftruit en
17 14
par
les foins de
J.
Marot, architeéle
&
graveur. Vers
86 5 il fut rompn par les Normands qui défoloient la
France; les Anglois s'en rendirent maitres fous
Char~
les VII,
&
en furent chaífés en
1436.
L'armée des
princes, · tigués centre
ouis XI , s'empara de ce
meme pont en
1465;
les Calvinifres en
I
567. H enri
IV l'enleva anx ligueurs en 1590, aprc!s une vigou–
reufe réfifiance : l'attaque fut encere plus vive le 8
février
I
649, pendam les guerres de la fronde. Le
brave Chanlac, maréchal-de-camp
,.y
périt, avec
quatre-vingts officiers des frondeurs. Ce meme pont
étoit fortífié par une groíle tour qui avoi.t fon com–
mandant : au xvre. fiecle elle paífoit pour
ine."t:•
pu.gnable.
Le bourg n'efr percé que d'une t'ue longue ,... bor–
dée de maÍfons des deux COtés ; le rOÍ en 16
I
8
per–
mÍt d'y tenir une foire le
29
juin,
&
accorda
a
ce
bourg le tirre de
ch~he llenie,
relevant de la groífe
tour du Louvre. Henri IV permiten
1
6o6,
a tx Pro–
teftans, de s'aírembler a
Clzarenton
&
d'y élever un
temple, qui fut brí'tlé en r 6
21
dans une ' meute,
&
rétabli deux ans apres aux frais des Prote(lans ,
fur les deffins de J. de Broífe, artifie connu par le
portail de faint Gervais
&
le palais du Luxembourg,
il pouvoit contenir
14000
perfonnes. Jean Gaffion,
rnaréchal de France, y fut inhuméen
1647·
Les Cal–
viniít
y
onttenutrois fynodes nationaux en 1623,
16
3
1 ,
164
5 ; ils y avoient une bibliotheque , une
imprimerie
&
des boutiques de libraires. Leurs plui
fameux rninifrres furent P. Dumoulin, J .•Daillé,
h. Drelincourt., P. Alix,
&
le famenx
J.
Claude.
Ce beautemple
futd~moli..en
1685,
&
l'emplace
4
ment donné aux religieufes du
Y aldofne
,
confacréell
a
l'adoration perp
1
tu lle du
• Sacrement.
Derriere
















