
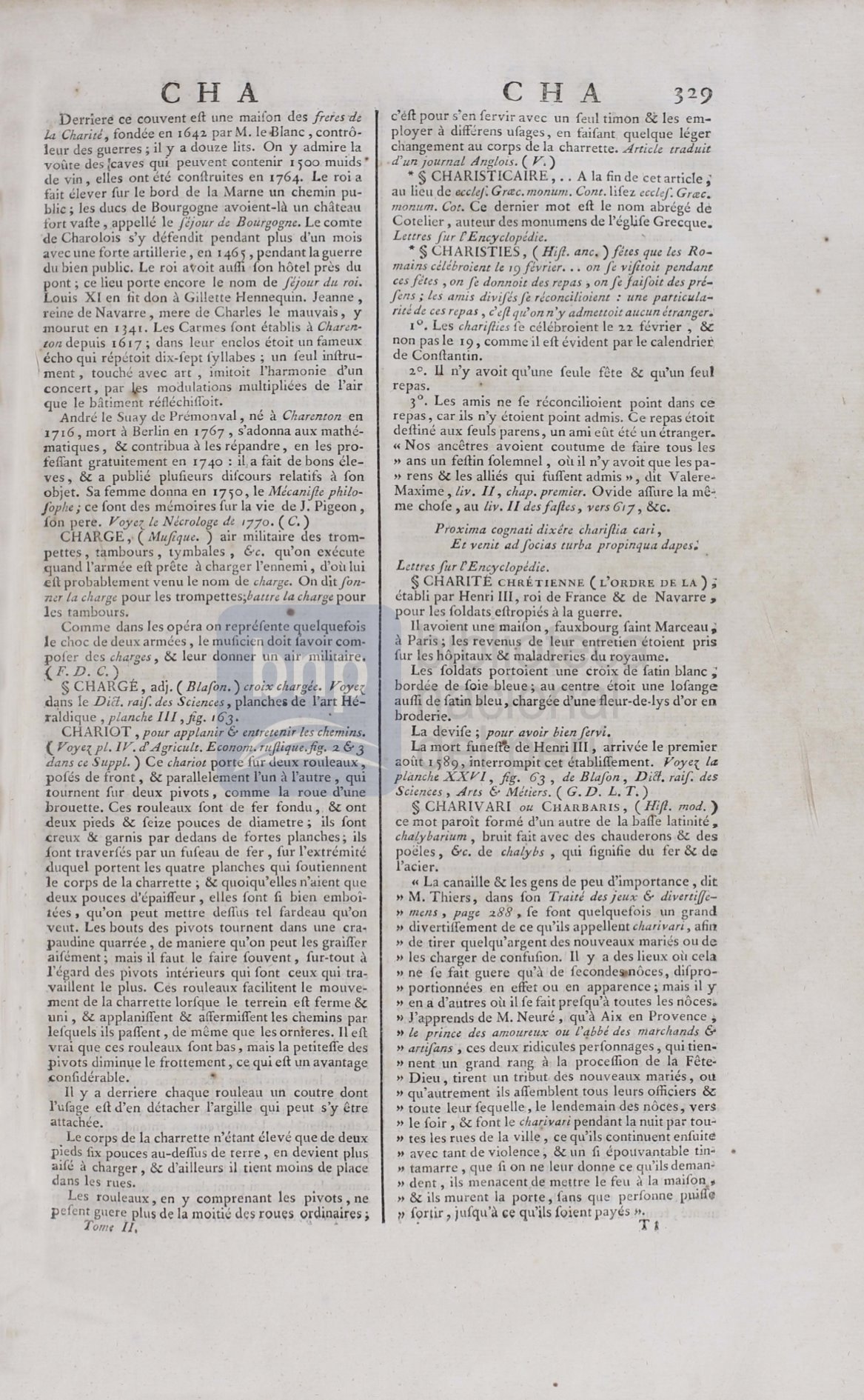
CHA
Derríere ce couvent efi une maifon des
freres -de
la
Charité
fondée en
1642
par
M.
le Blanc , contro–
leur des
g~erres
; il
y
a douze lits. o.n y admire. la
voC
1
te des [caves qm peuvent contemr
I
500 mmds ·
de vin , elles ont été confrruites en
I
764- Le roi
a
fait élever fur le bord de la Marne un chemin pu–
blic;
les ducs de Bourgogne avoient-la un chatea
u
fort vafie, appellé le
féjour de Bourgogne.
Le comte
de Charolois s'y défendit pendant plus d'un mois
2
vec
une forte artillerie, en
146
5,
pendant la guerre
du
bien public. Le roi a"oit auffi fon hotel pres du
pont ; ce lieu porte encore le nom de
féjour du roí.
Louis
XI
en fit don
a
Gillette Hennequin. Jeanne,
reine de Navarre, mere de Charles le mauvais, y
mourut en
1341.
Les Carmes font établis a
Charen.–
torz
depuis
I
6 17 ; dans leur enclos étoit un fameux
écho qui répétoit dix-fept fyllabes ; un feul infrru–
ment, touché avec art , imitoit l'harmonie d'un
concert , par les modulations multipliées de l'air
que le batiment réfléchiífoit.
André le Suay de Prémonval, né
a
Clzarenton
en
I
7
I
6 ' mort a Berlín en
I
767 ' s'adonna aux mathé–
matiques, & contribua
~
les répandre, en les pro–
fe ífant gratuitement en 1740 :
ilJ
a fait de bons éle–
ves' & a publié plufieurs difcours relatifs
a
fon
objet. Sa femme donna en 1750, le
Mécanijle philo·
fophe ;
ce font des mémoires fur la vie de J. Pigeon,
fon pere.
Voye7._ le N écrologe
de
'7JO.
(C.)
CHARGE, (
Mujique.
) air militaire des trom–
pette.s,
t~mbours,
tymbales ,
&c.
qu'on exécute
quand l'armée efr prete a charger l'ennemi' d'otllui
.efr probablement venu le nom de
charge.
On dit
fon–
ner La charge
pour les
trompettes;battre la charge
pour
les tambours.
Comme dans les opéra on repréfente quelquefois
le
choc de deux armées, le muficien doit Ütvoir com–
pofer des
cha,rges,
& leur donner un air miliraire.
(F.D.C.)
. §
CHARGÉ, adj. (
Bla(on.) croix chargée. Voyez
.dé!nS le
Diél. raif. des Sciences,
planches de l'art Hé–
raldique
,planche
111
,jig.
163.
CHARIQT,
pour apptanir
&
entretenir les clzemins.
(
Voyezpl.
IV .
d'
Agricult. Econom. ruflique.fig.
2
&
3
áans ce Suppl.)
Ce
chariot
porte fur deux rouleaux,
pofés de front ' & parallelement l'un
a
l'autre ' qui
tournent fur deux pivots, comme la roue d'une
brouette. Ces rouleaux font de fer fondu,
&
ont
.c:leux pieds
&
feize pouces de diametre ; ils font
.creux
&
garnis par dedans de fortes planches; ils
Íont traverfés par un fufeau de fer, fur l'extrémité
.duquel portent les quatre planches qui foutiennent
le corps de la charrette; & quoiqu'elles n'aient que
<leux pouces d'épaiffeur, elles font fi bien emboi–
tées, qu'on peut mettre deífus tel fardeau qu'on
veut. Les bouts des pivots tournent dans une cra–
paudine quarrée , .de maniere qu'on peut les grailfer
aifément; mais il faut le faire fouvent' fur-tout
a
l'égJrd des pivots intérieurs qui
fo~t
ceux qui tra–
vaillent le plus. Ces rouleaux facilitent le mouve–
m ent de la charrette lorfque le terr-ein efi ferme
&
uni ,
&
applaniífent
&
affermiffent les chemins par
lefquels' ils paífent' de meme que les ornieres. Il efi
vrai qu e ces rouleaux font bas, mais la petiteífe des
pivots diminue le frottemcnt, ce qui efi un avantage
.confidérable.
·
ll
y
a derriere chaque rouleau
uh
coutre dont
l'ufage efi d'en détacher l'argille qui peut s'y etre
attachée.
Le corps de la charrette n'étant élevé que de deux
p~eds
frx pouces au-deífus de terre , en devient plus
~ufé
a
charger '
&
d'ailleurs il tient moins de place
dans les rues.
Les rouleaux, en
y
comprenant les pivots , ne
p efent
gner~
plus de la rnoitié
des
rou~s o~d¡naires
j
Tome
/1,
...
C
f-I A
c'éíl: pour s'en fervir avec un feul timon
&
les em–
p loyer a diff¿rens ufages' en faifant quelque léger
changement au corps de
la
charrette.
Article traduit
d'un joumal Anglois.
(V. )
*
§
CHARISTICAIRE, ..
A
la fin de cet arricle
~
au lieu de
ecclej~
Grcec. monum. Cont.
lifez
ecclef. Grcec:
monum. Cot.
Ce dernier mot efi le nom abrégé de
Cotelier , auteur des monumens de l'églife Grecque.
L ettres fur
l'
Encyclopédie.
*
§
CHARISTIES, (
Hijl. anc.) fttes que les Ro–
mains célébroient le
19
flvrier.
..
on f e
11
ijitoit pendant
ces /étes
,
on fe donnoit des repas
,
on
fe
Jaifoit des pré.–
fens; les amis divifésfe réconcilioient : une patticula–
rid
de ces repas
,
e'efl
qu'on
n
y
admettoit aucun étranger
.'
1°.
Les
charifiies
fe célébroient le
22
février ,
&
non pas le
19,
comme il efr évident par le calendrier,
de Conl1:antin.
2
°.
Il
n'y avoit qu'une feule fe te & qu'un feul
repas.
·
3
°.
Les amis ne fe réconcilioient point dans ce
rep~s,
car ils n'y étoient point admis. Ce repas étoít
defimé aux feuls pareos, un ami eut été un étranger.
HNos ancetres avoient coutume de faire tous les
H
ans un fefrin folemnel, oit il n'y avoit que les pa–
H
rens
&
les alliés qui fuífent admis }) , dit
Valere~
Maxime,
liv.
11,
chap. premier.
O vide aífure la me"'.
me chofe , au
liv.
11
des fafles, vers
6'17,
&c.
Ptoxima cqgnati dixire charijlia cari,
Et venit
ad
focias turba propinqua dapes;
L ettres fur
L'
Encyclopédie.
§
CHARITE
CHRÉTIENNE ( L'ORDRE DE LA);
établi par Henri III, roi de France & de Navarre,
pour les foldatsvefiropiés a la guerre.
Il avoient une maifon, fauxbourg faint Marceau;
a Paris; ...le.s re venus 4e leur en.tretien étoient pris
fur les hopttaux & maladreries du royaume.
Les foldats portoient une croix ele fatin blanc ;
bordée de foie bleue; au centre étoit une lofange
auffi de fatin bleu, chargée d'une fleur-de-lys d'or en
broderie.
La devife ;
pour avoir hien fervi.
La mort
fune~
de Henri III, arrivée le premier
aout
1
589, interrompit cet établiffement.
V
oye{ La
planche
XXVI,
fig.
ÓJ ,
de BLafon, Ditl. raif. de$
Sciences, Arts
6·
Métiers.
e
G.
D. L. T.)
§
CHARIVARI
ou
CHARBARIS'
e
Hijl.
mod.)
ce mot paroit formé d'un aufre de la baífe latinité,.
chalybarium,
bruit fait
avec
des chauderons
&
des
podes,
&c.
de
chalybs
, qui fignifie du fer
&
de
l'acier.
((La canaille
&
les gens de peu d'importance, dit
)) M. Thiers, daos fon
Traité des jeux
&
divertij{e–
»
mens
:~
page
:1.88,
fe folilt quelquefois un grand
)) divertiífement de ce qu'ils appellent
c!zarivari,
afin
»
de tirer quelqu'argent des nouveaux mariés o u de
'' les charger de confuíion. 11
y
a des lieux
oi1
cela.
" ne fe fait guere
qu'~
de fecondes
naces'
difpro–
»
portionnées en effet ou en apparence; mais il
y
~'
en a d'autres ott il fe fait prefqu'a toutes les
no
ceso
•>
J'apprencls de M. Neuré , qu'a Aix en Provence
~
))
le princt: des amoureux ou L'q.bbé des matc!zands
&
~'
artifans
:~
ces deux ridicules perfonmtges, qui tien–
>)
nent un grand rang
a
la proG:effion de la Fete..–
H
Dieu, tirent nn tribut. des nouveaux mariés, ott
>)
qu'atltt'ement ils aífemblent tous leurs officiers
&
" toute leur fequeUe, le lendemain des no
ces,
vers
»
le foir, & font le
clzarivari
pendant la nuit par tou-–
" tes les rues de la ville, ce qu'ils continuent enCuite
)) avec tant de violence, & un fi épouvantable tin..
, tamarre , que
fi
on ne lenr donne ce qn'ils ciernan·
" dent ' ils menacent de mettre le fe u
a
la
maif~ll. "
" &
ils mu rent la porte, fans que perfonne pw.fft:
~'
fortir? jufqu'a ce
qu'ils
fo.ient payés
J>.
. .
T
¡ .
















