
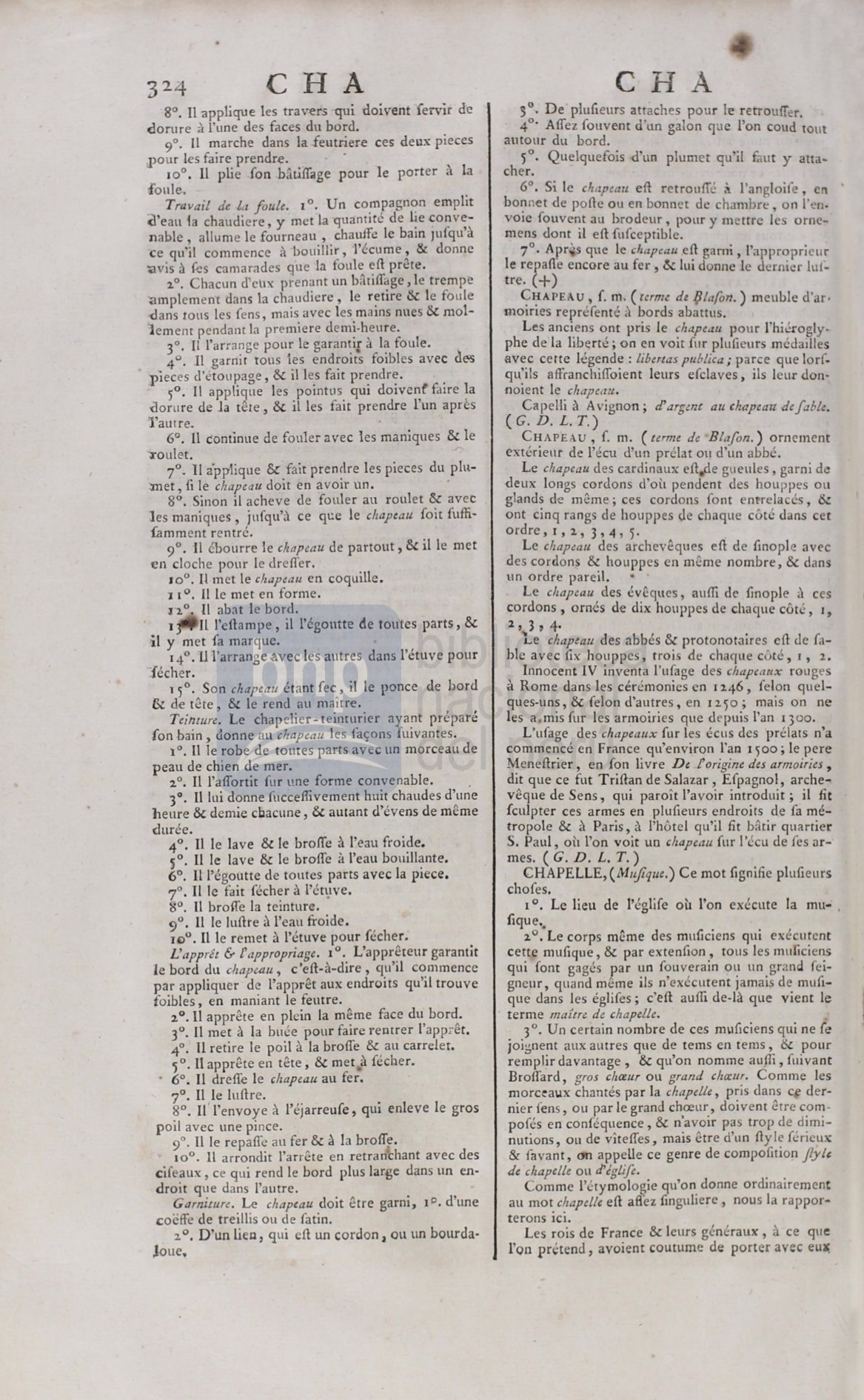
CHA
8°, U
applique
les
travers -qui doivent
fervir
de
dorure
a
lune des faces dn bord.
9
o.
ll
marche dans la feutriere ces deux pieces
.pour les faire. prendre. .
-
·
,
ro
0 •
Il
plie fon bati!fage pour le porter
a
la
fonle.
Travail
cú
la Joule.
¡
0 •
Un
co_rnpagn~n
emplit
<l'ean fa chaudiere,
y
met la quanute de
l~e ~o~v~
nable, allume le fourneau , cbauffi
le bam Jnfqu a
ce
qu'il
commence
a
bouillir,
·1'
1
cume,
&
donne
:avis
a
f.escamarades que
la
foul~
:fr
prthe.
2°.
Chacun
d~ct1x
prenant un bauífage, le trempe
-amplement daos la chaudiere, le retire
&
le foule
'<lans tous les fens, mais ave
e
les mains nues
&
mol–
lement pendant la premiere demi-heure.
3°. 11
l'arrange pour
le
garantir a la foule.
4
o.
11 _garnir tous 1es endroits foibles avec
el~
pieces
d'
' toupage,
&
illes fair prendre.
5°. I1
appli3ue les pointus qui doivenf faire la
.Oorure de
la
tete,
&
il les fait prendre
1
un
apr'
s
TaLttre.
6°. I1
cont'inue de fouler a
vec
les maniques
&
le
~oulet.
7°1
ll
a·pp1ique
&
fait prendre les pieces du plu–
met, file
chapeau
doit en avoir un.
8°.
Sinon il acheve de fou.ler an roulet
&
avet
les maniques, jnfqu'a ce qce le
chapeau
foit fuffi–
famment rentré.
9°. 1l
ébourre le
ckapeau
de partout,
&
ille met
en
doche pour le dreífer.
J0°.
H
met le
chapeau
en coquiile.
1
1°.
Ille met en forme.
1 "2.
0 •
n
abat le bord.
I
Il
l'eframpe,
il
l'égontte
de
toutes parts,
&
il
y
met {a
marqu~
14
°.
Ul'arrange .avec les autres dans l'étuve pour
iécher.
r
5°.
Son
clz.apeau
étant fec, il le ponce de hord
&
de tete,
&
le rend au mairre.
Teituure.
Le chapelier- teinrurier
a~ant
préparé
fon bain, donne au
clzapeau
les fac;ons fuivantes.
1°.
ll
le robe de toutes parts av
e
un morceau de
peau de chien de mer.
2°.
Il
l'aífortit fur tme forme convenable.
.
3°.
Illui donne fucceffivement buit chaudes d'une
heure
&
demie c);¡acune,
&
autant d'ével)S
de
meme
duré
e.
4°.
Il
le lave
&
le
broífe
e\
l'eau froide.
5°. Il le
lave
&
le braífe
a
l'eau bouillante.
6°.
Ill'égoutte de toutes parts avec la piece.
7°. Il
le fait fécher
a
l'étt_IVe~
3°. I1
broífe la teinture.
9°. Il
le lufrre
a
l'eau froide.
10°,
Ille remet
a
l'étuve pour fécher.
L'
apprét
&
l'
appropriage.
1°.
L'apprereur garantir
le bord du
chapeau,
c'eft-a-dire, qu'il commence
par appliquer de l'appret aux endroits qu'il trouve
foibles, en maniant le feutre.
2°.
Il
apprete en plein la meme face du bord.
J
0 •
Il
met
a
la buée pour faire renrrer l'appret.
4°.
u
retire le poil
a
la broífe
&
au carrelet.
5°· Il
apprete en tete'
&
meta fécher.
6°. Il
dreífe le
chapeau
au fer.
7°.
Il
le lufire.
8°. Il
l'envoye
a
l'éjarreufe' qui enleve
le
gros
poil avec une pince.
9°.
Ille repaífe au fer
&
a la broífe.
1
o
.o.
11
arrondit l'arrete en retranchant avec des
cifeaux, ce qui rend le bord plus large daos un
en–
droit que dans l'autre.
Garniture.
Le
chapeau
doit etre garni,
¡P.
d'une
coeffe de treillis ou de fatin.
2
°.
D
un lieu, qui eft un cordon) o u un bourda–
Joue.
CH
S
0
•
De piuíieurs at ache po tr Ie retro
1ífer.
4
o.
Aífez fouvenr d'un ga on q..t
1
on coud tout
autour du bord.
5°.
Quelquefois d
un
plumet qu
'il
f:
ut
y
att ..
cher.
6°. Si
le
chapeau
eft
retrouít ~
· 1'angloiíe , e
bon et de poíle ou en bonnet de hambre on l'en–
voie fouvent au brodeur, pour y mettr
1
orne–
mens dont
it
efi fufceprible.
7°.
Apr
s
que le
chapeau
eíl:
gami
l'approprieur
le repaífe encore au fer,
&
luí donne le d rnicr lui–
tre. (
+)
CHAPEA
U,
f.
m, (
rerme de Bla{on.)
meuble d'ar·
moiries repr
1
[enté
a
bords abattus.
Les anciens ont pris le
chapeau
pour l'hiéro"'ly–
phe de la liberté; on en voir fur plufieurs m
1
dailles
avec cette légende :
Libertas publica;
par e que lor(–
qn ils aff
ranchiífoient leurs efclaves, ils leu.r don–
noient le
clz.ap· eau•
CapeHi
aA
ignon;
d'argmt a
u
'hapeart deJable.
(G. D. L. T.)
CHAPE
u ,
f. m. (
terme
de
Blafon.)
ornement
extérieur de l'écu d'un pr
1
lat ou d'un abb
1
•
Le
chapeau
des cardin ux efr de guenles, garni
d~.;
<leux longs cordons d'oü pendent des houppes ou
glands de meme; ces cordons font entrela
S,
&
ont cinq rangs de houppes de chaque c"t
1
daos cet
ordre,
1
,
2.,
3,
4 ,
5.
Le
clzapeau
des archeveques
eít
de fioople avec
des -cordons
&
houppes en
m
eme nombre,
&
dans
Hn ordre pareil.
-
Le
chapeau
des éveques, auffi de finople
a
ces
cordons' ornés de dix houppes de chaque coté'
1'
2,3,4-
Le
chapeau
des abbés
&
protonotaires
efi
de fa–
ble avec fix houppes, trois de chaque
COt
1
,
I
7
2..
Innocent
IV
inventa l'ufage des
chapenux
rouges
a
Rome dans les cérémonies en 1246, felon quel–
ques-uns,
&
felon d'autres, en
I 250;
mais on ne
les a mis fur les armoiries que depuis l'an
1300.
L'ufage des
chapeaux
fur les écus d s prélats n'a
commencé en France qu'environ l'an
1500;
le pe re
Meneftrier, en fon livre
De:
.l'origine des armoiries,
dit que ce fut Trifran de Salazar, Efpagnol, arche-.
veque de Sens,
qui
paroit l'avoir introduit;
il
ñt
fculpter ces armes en plufieurs endroits de fa mé–
tropole
&
a
Paris,
a
!'hotel qu'il fit batir quartier
S.
Paul, ott l'on voit u
o
chapeau
fur
1
'écu de fes ar–
mes. (
G. D. L. T.
)
CHAPELLE, (
Mujique.)
Ce mot íignifie pluúeurs
chafes.
1°.
Le
lieu
de l'églife ou l'on exécute la mu.–
fique ...
2
°.
Le corps
m
eme des muficiens qui exécutent
cette mufique,
&
par extenfion, tous les muficiens
qui font gagés par un fouverain ou un grancl fei–
gneur' quand meme ils
n
exécutent jamais de mufl–
que dans les églifes; c'eft auffi de-la que vient le
terme
maítre de chapelLe.
3°.
Un certain nombre de ces
m~1ficiens
qui ne fe
joi3nent aux autres que de tems en tems,
&
pour
remplir davantage,
&
qu'on nomme
auffi,
fuivant
Broífard,
gros chaur
ou
grand cha:ur.
Comme les
morceaux chantés par la
chapelle,
pris dans ce der–
nier fens' o u par le grand chreur' doi vent etre com–
pofés en conféquence,
&
n'avoir pas trop de dimi–
nutions' ou de vireífes' mais etre d'un fiyle féri
ux
& favant, on appelle ce genre de compofition
jlyie
de
chape/le
on
d'égLife.
omme
l'
1
rymologie qu'on donne ordjnairement
au mor
chapelle
efi afiez finguliere, nous la rappor–
terons ici.
Les rois de France
&
leu.rsgénéraux ,
a
ce que
1
on
prétend, avoient coutume de porter avec
eu~
















