
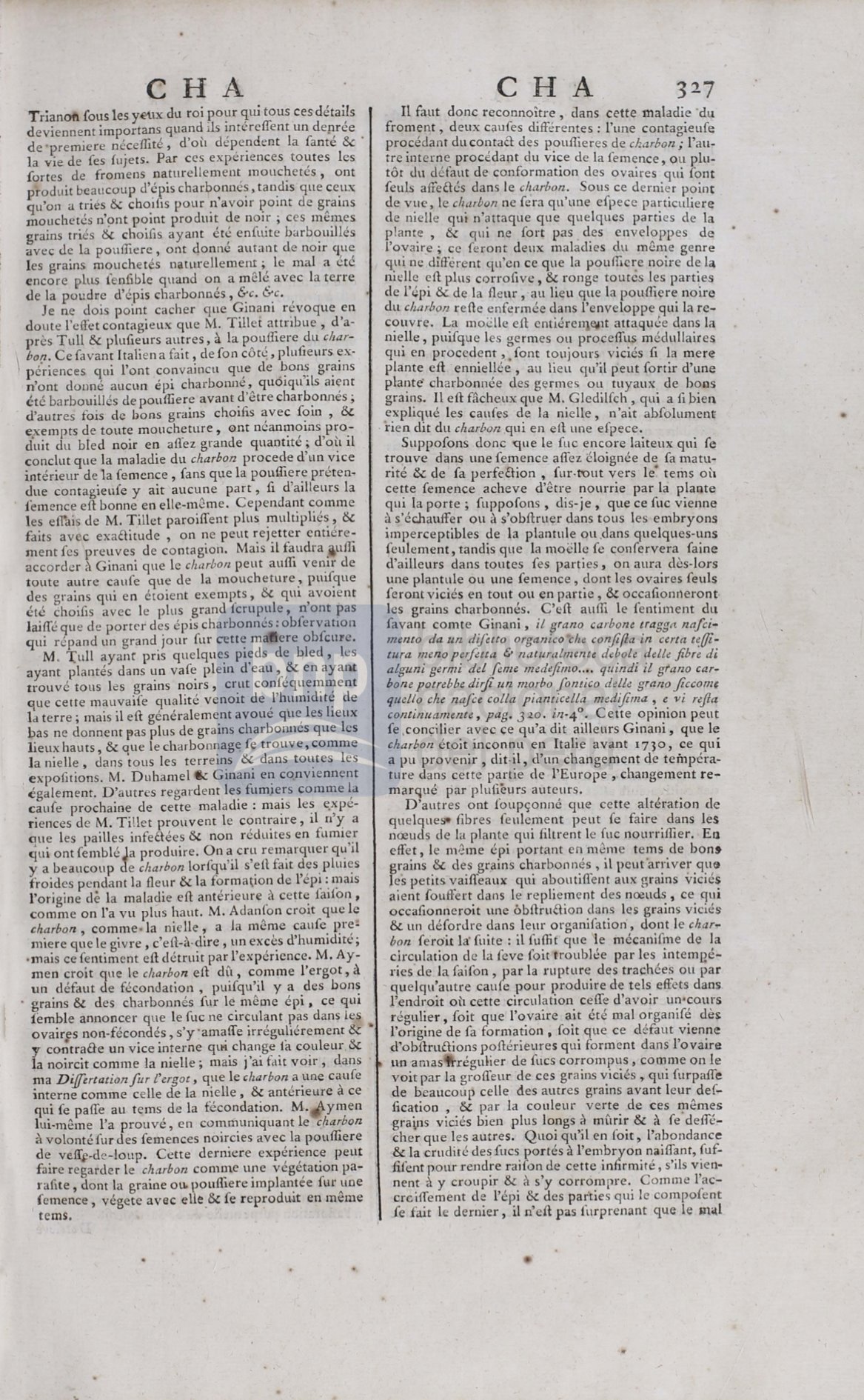
CHA
Trianon fous les
y~tx
du roi po:1r
c¡.ui
tous
ces
d
'taills
deviennent
imp~:>rtans, qua~~
lis
:nr
reífent un
de~r
e .
de premiere
n
.ceflit , d ou
de~e~dent
la fant
&
la vie de fes fuJets. Par ces exp nences toutes les
fortes de fromens naturellement mouchetés, ont
produit be.aucoup
d'~pis charb~nné~,
tan.dis que
ce.uxqu'on
a
tnes
&
cho.1íis pour
~
av01r l?omt de g;ams
mouchetés n'9nt pomt prodmt de notr ; ces memes
grains triés
&
choiíis ayant éré enfLúte barbouillés
avec de la pouffiere, ont donné autant de noir que
les grains mouchetés nanM"ellemenr; le mal a
1
té
encore plus fenfible qnand on a melé avec la terre
de la poudre d'épjs charbonnés,
&c. &c.
Je ne doi point cacher que Gioaoi révoque en
dome l'effet contagieux que
M.
Tillet attribue, d'a–
pres Tull
&
pluíieurs autres,
a
la
pouiliere
duchar-
\
ho(l.
Cefavanr Italiena fait, defon coté , plufieurs
~x
périences qui l'ont convaincu
qt~e
de
.~on; gr~ms
n'ont donné aucun épi charbonn , quorqu
lls
a1ent
été barbouill ls de
pouffier~
avant ?'etre charb?nn 's;
d'autres fois de hons grams ch01fis
~vec
Í?m ,
&
exempts de toute
mouch~ture,
0nt n
ant?~ms,p~o.duit du bied noir en afiez grande quantlte ; d ou
ü
conclut qne la maladie du
charbon
procede d'un vice
intérieur de la femence, fans que la pouffiere préten–
due contagieu(e y ait aucune part ,
fi
d'ailleurs la
femence efi bonne en elle-m"me. Cependant comme
les eírai de
M.
Tillet paroiffent plus
~ultipli~~ ~
&
faits av e exaél:itude , on ne peut reJetter entlere–
ment fes preuves de contagien. Mais
il
faudra. uffi
accorder
a
Ginani que le
charbon
peut auffi vemr de
toute autre caufe que de la moucheture .'
pui~que
cles grains qui en éroient exempts,
&
qm av01ent
été
choifi.s avec le plus grand fcrupule, n'ont pas
laiífé que de porter des épis charbonn
' s:
obfervation
qui répand un grand jour fur
cett~
ma ere obfcnre.
M ,
Tull ayanr pris quelques p1eds de bled , les
ayant plantés dans un vafe ple
in d'eau,
&
en ayant
trouve tous les grains
no~rs,
cr.utcon,Céqn~n:-~ent
que cette mauvaife qualite ven01t de
l
hmmdtt~
de
ld
terre · mais il efi généralement avoué qtte les heux
'
1
1
bas ne donnent pas plus de grains charbonnes que es
lieux hauts
&
aue le charbonnage fe trouve, comme
la nielle
dans tous les terreins
&
dans toutes les
, expoíiti;ns.
M.
Duhamel
Gina
ni er: conviennent
également. D'autr
s
regardent
le~
fum.Ie.rscomme
lla
c_aufe
prochain~
de cette rnalad1e :
ma~s le~ ~~pe
nences de
M.
T1llet prouvent le contrau·e,
xl
n
y a
oue les pailles infeétées
&
non r
1
dttites en
fi
tmier
qui ont femblé Ja produire. On
~ cr~t
rem.arqner
q~'il
y
a beaucoup de
charbon
lorfqu'Ü
s
~fi
fatt
~~s. plm~s
froides pendant la fleur
&
la
forma~10n
de
1
ep~
=.
ma1s
l'origine de la maladie efi antérieure
a
cette iatfon,
comme on l'a vu plus haut.
M.
Adanfon croit que le
charhon'
comme la
nielle' a la meme caufe pre–
rniere que le o-ivre' c'
efi:-a.dire' un exces d'humidité;
·mais ce
fenti~ent
efl: détruit par l'expérience.
M. Ay–
meo croit que le
charhon
efi: dft' comme ¡•ergot'
a
un défaut de fécondation , puifqu'il
y
a des bons
grains
&
des charbonn
1
S
fur le
m
eme épi
,
ce qui
íemble annoncer que le fue ne circulant pas dans les
ovaires non-fécondés, s'y •amaífe irréguliétement
& •
y
co~trafre
un vice interne qu.i change
Üt
couleur
&
la noircit comme la nielle ; mais
i
'ai
fait
voir , dans
ma
Dijflrtation fur L'ergot,
que le
charbon
a
une ca
u
fe
interne comme celle de la nielle '
&
antérieure
a
ce
qui fe paífe au tems de la fécondation. M.
ymen
lui-meme ra prouvé' en communiquant le
cb.arhon
a
volontéfur des femences noircies avec la pouffiere
de vefft-de-loup. Cette derniere expérience peut
faire regarder le
charbon
comme une végétation pa–
raíite , dont la g-raine o
u.
pouffiere implall:tée fY.l' ;me
femence, végete avec elle_& fe reproduJ.t en meme
tems.
CHA
Il
faut
done reconnoitre, dans
cette
maladie du
froment, deux caufes différentes : l'une contagieufe
procédanr du conraét des pou.ffieres de
charhon
·
l'au–
tre interne proc 'dant du vice de la femenee,
o~t
pin–
tor
un
d 'faut de conformation des ovaires qui font
feuls affeétés dans le
cl!fZrbon..
ous ce dernier point
de vue, le
charbon
ne fera qu'une efpece particuliere
de nielle
qui
n'attaque que quelques parri es de la
plante ,
&
qui ne fort pas . des enveloppes de
l'ovair_e ; ce feront deux maladies dl.t meme genre
q.uioe d1fferent qu'en ce qne la
pouffie~e
noire de
la
melle eíl: plus corroíive,
&
ronge toutes les parties
de
l'
1
pi
&
de la flen.r,
-au
lieu que la pouffiere noire
du
c!tarhon
refie enferm
ée daos l'enveloppe quila re–
c?uvre.
~a
moelle eft
entiéreme.ntattaquée daos la
m~lle,
puifque les germes o
u
proceffus
m '
dullaires
qm en procedent, font toujours viciés fi la mere
plante eft enniellée , au lien qu'il peut fortir d'une
plaz:te· charbonn
1
e des germe o
u
tuyaux de bons
gra1ns.
11
eíl: facheux que
M.
Gledilfch, qui a
fi
bien
expliqué les canfes de
la
nielle, n'ait abfolnment
rien dit du
charbon
quien
efr
une efpece.
Suppofons done que le fue encore laiteux qui
fe
trouve daos une femence affez eloignée de fa matu–
rité
&
de fa perfeétion , fur-rout vers le· tems ou
cette femence acheve d'etre nourrie par la plante
qui
la porte; fuppofons , dis-je, que ce fue vienne
a
s'éc.hauffer ou
a
s'obfi:ruer dans tous les embryons
imperceptibles de la piantule ou .dans quelques-uns
feulement' tandis que la
m
oelle fe confervera faine
d'ailleurs daos toutes fes parties, on aura des-lors
une plantule ou une femence, dont les ovaires feuls
feront viciés en tout o
u
en partíe,
&
occafionneront
les grains charbonnés. c>eft auffi le fentiment dn
favant comte Ginani,
il grano carbone traggrt nafci-
·
mento da un difetto organico che conjifla in certa
t~{/i
tura meno perfitta
&
naturalmente debole delü fibre di
algu.nigermi del Jeme medejimo.... quindi il gtano car–
bone prJtrebhe dii:Ji un morbo fontico delle grano Jiccomt
quello che nafce colla pianticella
medijima,
e vi
nfla
continuamente, pag.
32.0.
in-4°.
Cette opinion peut
fe ,conc;llier avec ce qu'a dit ailleurs Ginani, que le
charbon
étoit inconnu en Italie a:vant
1730,
ce qui
a pu provenir, dit-il, d'un changement de teinpéra–
ture daos cette partie de l'Europe , changement re–
marqué par pluíieurs auteurs.
D'autres ont foupc;onné que cette altération de
quelques-t fibres feulement peut fe faire dans les
nreuds de
la
plante qui filtrent le fnc nourriffier.
Et1
effet, le
m ~me
épi portant en
m
me tems de
bon~
grains
&
des grains charbonnés, il peut arriver qus
les petits vaiífeaux qui aboutiífent aux grains viciés
aient fouffert daos le repliemeot des nreuds, ce qui
occafionneroit une 6bfi:ruél:ion dans les grains viciés
&
un
défordre dans leur organifation, dont
lechar–
hon
ferdit la' fuite :
il
fuffit que le mécanifme de
la
drc_ulation de la feve foit troublée par les intemP.é–
ries de la faifon, par la rupture des trachées on par
quelqu'antre caufe pour produire de tels effets daos.
l'endroit o\1 cette circnlation ceífe d avoir un·cours
régulier, foit qu.e l'ovaíre ait ét
1
mal organifé
des
l'origine de fa formation • foit que ce défaut vienne
d'obfiruétions pofiérieures qui forment dans l'ovaire
un amas
.régulier de fucs corrompus, comme on
1~
voit par la groífeur de ces grains vici
1
s, qui furpaífe
de beaucoup celle des autres grains avant leur def–
fication '
&
par la couleur verte de ces memes
gra\ns viciés bjen plus longs
a
mftrir
&
a
fe deífé–
cher que les autres. Quoi qu'il en foit, l'abondaoce
&
la crudité desfucs portés
a
l'embryon naiífant,
fuf–
fifent pour rendre raifon de cette infirmité, s'ils vien·
nent
ay
croupir
&
a
s'y corrompre. Comme !'ac–
ere i.Jfernent de l'épi
&
des partie qui le compofent
{e
fait
1
dernier,
il
n'efi: pas furprenant que le
mttl
















