
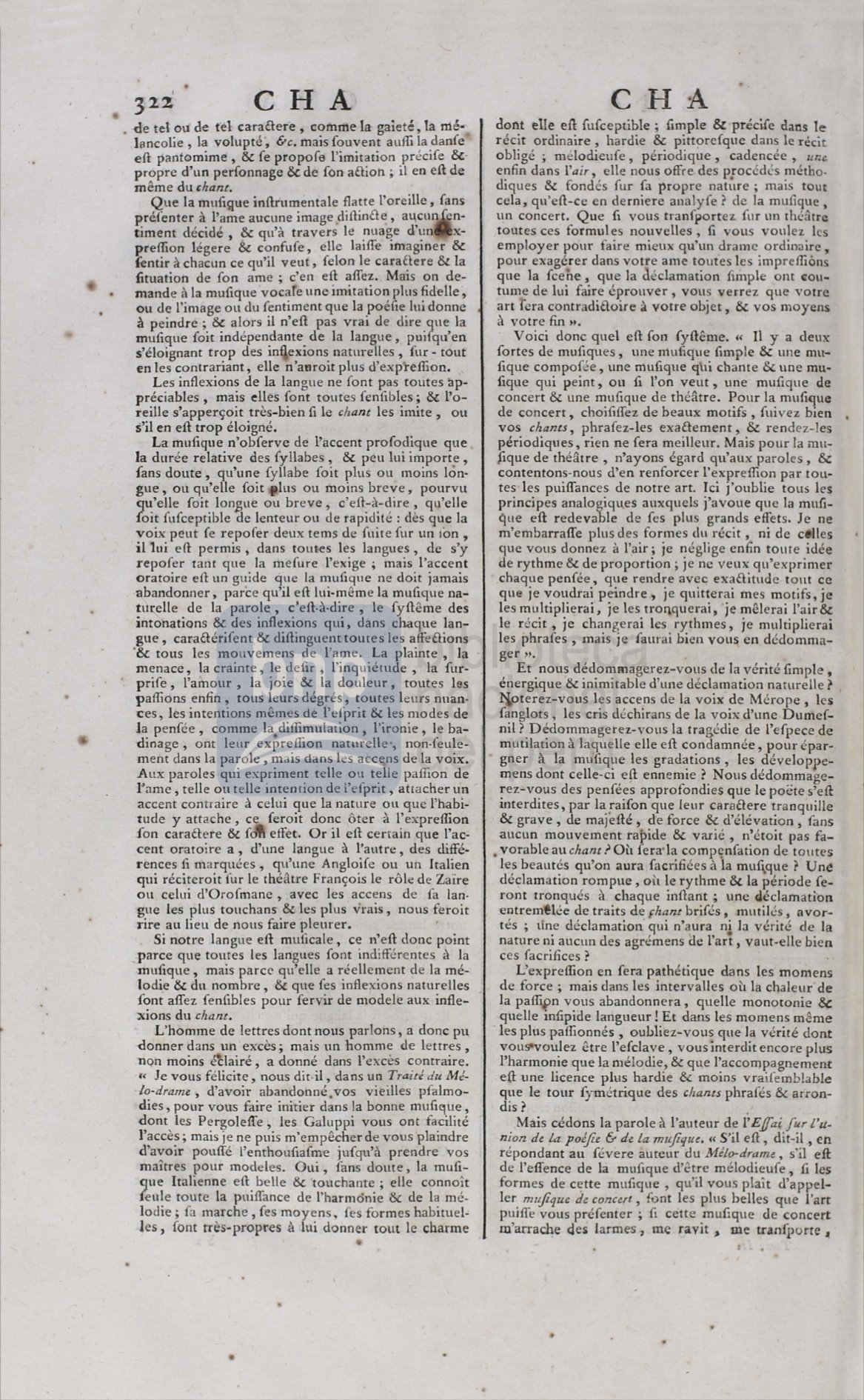
1
322
CHA
de
t el ou
de tel caraaere , comme la gaieté, la
mé-–
l ancolie, la volupté,
Ere.
mais fouvent auffi la danfe
eft pantomime,
&
fe propofe l'imitation précife
& ·
propre d'un perfonnage
&
de fon aétion ; il en efr de
m eme du
chant.
Que la
mufi~ue
infuumentale flatte l'oreille, fans
préfenter
a
l'ame aucune image difiinéte' aucun
n–
timent décidé ,
~
qu'a travers le
~ma&e d'~n
x–
preffion légere
&
confufe, elle lalff-e ltnagmer
& .
fentir
a
chacun ce qu'il veut, felon le
cara~ere
&
la
fituation de fon ame ; c'en eft aífez. Mms on de–
mande
a
la muúque vocaie une imitation plus fidelle'
ou de l'image ou du fentiment que la poéíie lui donne
a
peindre;
&
alors
i1
n'eft pas vrai de dire que la
rnufique foit indépen_dante. de la langue, puifqu'en
s'éloignant trop des rnflex10ns naturelles, fur- tout
en les contrariant, elle n
'at~roit
plus d'expreffion.
Les inflexions de la langue ne font pas toutes ap–
préciables, mais ellés font toutes feníibles;
&
l'o–
reille s'apperc;oit tres-bien fi le
chant
les imite , ou
s'il en eft trop éloigné.
La mufique n'obferve de l'accent profodique que
la durée relative des fyllabes,
&
peu lui importe,
fans doute, qu'une fyllabe foit plus ou moins lon–
gue, ou qu'elle foit
lus ou moins breve, pourvu
qu'elle foit longue ou breve, c'efi-a-dire, qu'elle
foit fufceptible de lenteur ou de rapidit é : des que la
voix peut fe repofer deux tems de fui te fur un ion,
illui efr permis , daos tout:es les langues , de s'y
repofer tanr que la rnefure l'exige ; mais l'accent
oratoire eíl: un guide que la muíique ne doit jamais
abandonner, paree qu'il efi lui· meme la mufique na–
tttt:..,_elle de la parole , c'efi-a-dire , le fyfteme des
intoh~tions
&
des inflexions qui, daos e
ha
que lan–
gue, car-aélétifent
&
difiinguenr toutes les affeélions
"&
tous les mouvemens de l'ame. La plainte , la
menace, la crainte, le defir , l'inquiétude , la fur–
prife, l'amour , la joie
&
la douleur, toutes l<!s
paffions enfin , tous leurs dégrés, toutes leurs nuan–
l:es, les intentions memes de l'efprit
&
les modes de
la penfée , comme la.diffimulation , l'ironie , le ba–
-dinage , ont le ur expreffion naturelle , non-feule–
ment daos la parole, mais dans les accens de la voix.
Aux paroles qui expriment telle ou telle paffion de
rame' telle ou telle inten tion de l' fprit' attacher un
accent contraire
a
celui que la nature ou que l'habi–
tude y attache, ce feroit done oter
-a
l'expreffion
fon caraétere
&
fo effet. Or il eft certain que l'ac–
cent oratoire a' d'une langue
a
l'autre' des diffé–
rences
fi
marquées, qu'une Angloife ou un Italien
qui
réciteroit
ft,¡r
le théatre Franc;ois le role de Zaire
ou celui d'Orofmane, avec les accens de fa lan–
gue les plus touchans
&
les plus vrais' nous feroit
rire au lieu de nous faire pleurer.
Si notre langue eft muficale, ce n'eft done point
pa-ree que tontes les langues font indifférentes a la
muúque , mais paree qu'elle a réellement de la mé–
lod.ie&
du nombre,
&
que fes inflexions naturelles
font aifez fenúbles pour fervir de modele aux infle–
:xions du
chant.
L'homme de lettres dont nous parlons, a done pu
.Conner dans un exces; mais un homme de lettres '
non moins éclairé, a donné daos l'exces conrraire.
f<
Je vous félicite, nous dit-il, dans un
T raid
du
Mé–
i o-drame,
d'avoir abandonné .vos vieilles pfalrno–
dies, pour vous faire initier daos )a bonoe mufiq ue,
<lont les Pergoleífe, les Galuppi vous ont facilité
l'acces; mais je ne puis m'empecher de vous plaindre
d'avoir pouífé l'enthoufiafme ju{qu'a prendre vos
rnaitres pour modeles. Oui , fans doute, la mufi–
que Italienne efi: helle
&
touchante ; elle connoit
fe nle toute la puiífance de l'harmónie
&
de la mé–
lodie ; fa marche , fes moye ns , fes formes habituel–
l es' font rr_es-propres
a
lui donne.r tout le charme
CHA
dotlt elle efr fufceptible · fimple
&
précife dans
le
récit ordinaire , hardie
&
pittorefque dans
le récit
obligé ; mélodieufe , p ériodique, cadencée ,
unt•
enfin daos
l'
air,
elle nous offre des P.rocéd ' s métho–
diques
&
fondés fur fa propre nature ; maí
tour
cela, qu'eíl-ce en derniere ana lyfe ? d
la mufique,
un concert. Que
fi
vous tranfportez fu r un th 'arre
toutes ces formules nouvelles , ú vous voulez. les
employer pour faire mieux qu'un drame ordinaire,
pour exagérer dans votre ame
to~ttes
le
impreffions
que la fcene, que la
d
' clamation fimple ont con..
turne de luí faire éprouver , vous verrez que votre
art fera contradiétoire
a
votre objet'
&
vos moyens
a
VOtre
fin
H.
Voici done quel efi: fon fyfteme.
u
I1 y a deux
fortes de muíiques, une mufique fimple
&
une mu–
fique compofée, une mufique qtü chante
&
une mu–
íique qui peint, ou ú l'on veut, une muúque de
concert
&
une muíique de théatre . Pour la mufique
de concert, choifiífez de beaux motifs , fuivez bien
vos
chams,
phrafez-les exaélement,
&
rendez-l es
périodiques, rien ne fera meilleur. Mais pour
la
mu–
;íique de théatre , n'ayons égard qu'aux paroles ,
&
contentons-nous d'en renforcer l'expreffion par tou–
tes les puiífances de notre art. Ici j'oublie tous les
príncipes analogiques auxquels j'avoue que la mníi–
que eft redevable de fes plus grands effets.
J
e ne
rn'embarraífe plus des formes du récit, ni de e Hes
que vous donnez
a
l'air; je néglige enfin tou te idée
de rythme
&
de proportion; je ne veux qu'exprimer
chaque penfée, que rendre avec exaélitude tont ce
qu~
je voudrai peindre ., je quitterai mes motifs, je
les multiplierai', je les tronquerai, je melerai l'air
&
le récit , je changerai les rythmes, je multiplierai
les phrafes, rnais je faurai bien vous en dédomma–
ger
».
Et nous dédommagerez-vous de la vérité úmple,
énergique
&
inimitable d'une déclamation na turelle?
, oterez.-vous les accens de la voix de Mérope , les
fanglots , les cris d ' chirans de la voix d'une Dumef–
nil? Dédommagerez-vous la tragédie de l'efpece de
mutilation a laquelle elle eft condamnée' pour
J
par–
gner
a
la mufique les gradations ' les développe–
mens dont celle-ci
efl:
ennemie
?
Nous dédommage–
t'ez-vous des penfées approfondies que le poete s'efr
interdites, par la raifon que leur caraétere tranqu1lle
&
grave,
de
majefté, de force
&
d'élévation, fans
.aucun mouvement rapide
&
varié , n'étoit pas fa-
. vorable au
chant?
Ou fera·la
comp~nfation
de toutes
les beautés qu'on aura facrifi ées
a
la muft.que
?
Une
déclamation rompue, o
't
le rythme
&
la période fe–
ront tronqués a chaque infl:ant ; une déclamatron
entrem>@lée de traits de
fhant
brifés, mutilés, avor–
tés ; tine déclamation qui n'aura ni la vérité de la
nature ni aucun des agrémens de l'art, vaut-elle bien
ces facrifices
?
L'expreffion en {era pathétique dans les momens
de force ; mais daos les intervalles ou la chaleur de
la paffipn vous abandonnera, quelle monotonie
&
queUe infipide langueur! Et dans les momens meme
les plus paffionnés , oubliez-vous que la vé rité dont
vou voulez etre l'efclave' vous interdit encore plus
l'harmonie que la mél odie,
&
que l'accompagnement:
eft une licence plus hardie
&
moins vraifemblable
que le tour fym 'trique d-es
chants
phrafés
&
arron–
dis?
Mais cédons la parole
a
l'auteur de 1;
Ejfai fur
l'u.
nion de
La
poéjie
&
de la mufique.
«
S'il eft , dit-il , en
répondant au févere auteur du
M éto· drame ,
s'il eft
de l'eífence de la mufique d'etre mélodieufe,
íi
les
formes de cette mufique, qu'il vous plait d'appel–
ler
mujique de concert
,
font les plus beHes que l'art
puiife vous préfent er ; ú cette muúque de concert
m'arrache
des iarmes
~
me ravit
,
me tranfporte
$
















