
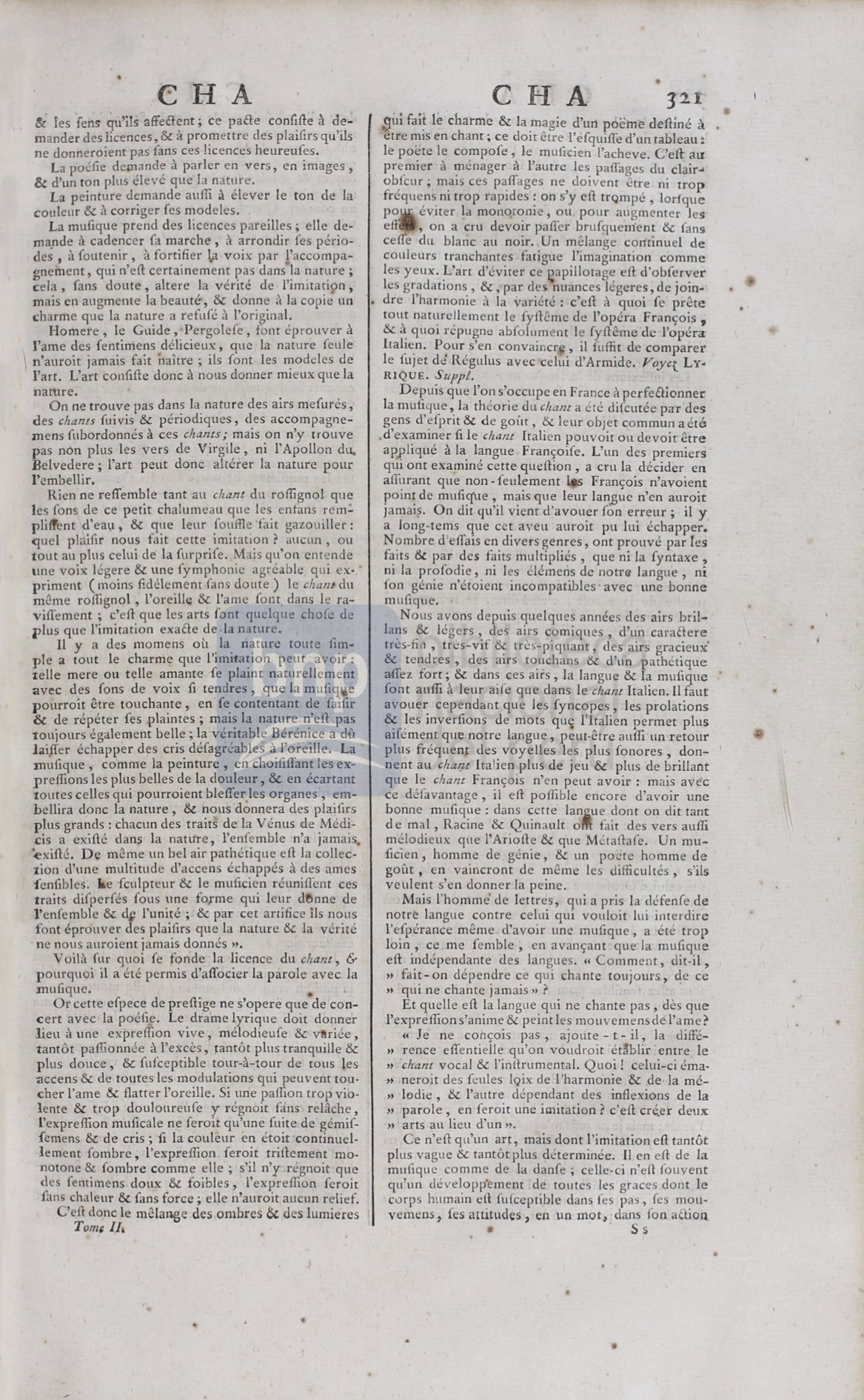
CHA
& les fens gu'ils affeélent; ce paéle
con~fr~
a
~~mander des hcences,
&
a
promettre des platÚl
S
qu
1ls
ne donneroient pas fans ces licences heureufes.
La poéfie demande
a
parler en vérs, en images,
&
d'un ton plus élevé que la nature.
La peinture demande auffi
a
élever le ton de
la
couleur
&
a
corriger fes modeles.
La mufique ptend des licences pareilles ; elle de–
ma.nde
a
cadencer fa marche '
a
arrondir fes pério–
des '
a
foutenir '
a
fortifier ta voix par l'accompa–
gnement, qui n'eft certainement pas dans la nature;
cela , fans doute , altere la vérité de l'imitation ,
rnais en augmente la beauté'
&
donne
a
la copie un
charme que la nature a refufé
a
!'original.
Homete, le Guide, Pergolefe, font éprouver
a
l'ame des fentimens délicieux, que
la
nature feule
\ n'anroit jamais faít naitre ; ils font les modele-s de
. l'art. L'art confifie done
a
nous donner mieux que la
nature.
On ne trouve pas daos la nature des airs mefurés,
des
chants
fui vis
&
périodiques, des accompagne–
mens fnbordonnés
a
ces
chants;
mais on n'y trouve
pas non plus les vers de Virgile, ni
1'
Apollon du.
Belvedere; l'art peut done altérer la nature pour
1'
em
bellir.
Rien ne reífemble tant au
chant
du roffignol que
les fons de ce petit chalumeau que les enfans rem.:.
pliífent d'eau,
&
que leur fouffie ·fait gazouiller:
quel plaifir nous fait cette imitation ? aucun , ou
tout au plus celui de la furprife. Mais qu'on entende
une voix légere
&
une fymphonie agréable qui ex·
priment ( moins fidélement fans doute) le
cham
du
meme roffignol' l'oreille
&
l'ame font dans le ra–
viífement ; c'eft que les arts font quelque chofe de
plus que l'imitation exaae de .la nature.
Il y a des momens oti la nature toute fim..,
pie a tont le charme que l'imitation peut avoir:
telle mere ou telle amante -fe plaint naturellement
avec des fons de voix fi tendres, que la mufiq e
pourroit etre touchante' en fe contentant de faifir
&
de répéter fes .plaintes; mais la nature n'eft pas
t.oujours également belle; la véritable Bérénice a
du
.laiffer échapper
d~s
cris défagréables
a
l'oreille. La
mufique , comme la peinture , en choiíiffant les ex–
preffions les plus belles de la douleur,
&
en écartant
toutes celles qui pourroient bleífer les organes , em–
bellira done la nature ,
&
nous donnera des plaifirs
plus grands : chacun des traits de la Vénus de Médi–
cis a exifté daos la natttre, l'enfemble
n~a
jamais.
~xifté.
De meme un bel air pathétique efi la collec–
tion d'une multitude d'accens échappés
a
des ames
{enfibles. It.e {culpteur
&
le muficien réuniífent ces
traits difperfés fous une forme qui leur denne de
l'enfemble
&
de
l'unité ;
&
par cet artífice ils nous
font éprouver des plaifirs que la nature
&
la vérité
ne nous auroient jamais donnés "·
Voila fur quoi fe fonde la licence du
chant,
&
pourquoi il a été permis d'aífocier la parole avec la
mufique.
•
·
Or cette efpece de prefiige ne s'opere que de con–
cert avec la poéfie. Le drame lyrique doit donner
}ieu
a
une expreffion VÍVe, mélodieufe
&
V
riée,
tantot paffionnée
a
l'exd:s' tantot plus tranquille
&
plus douce,
&
fufceptible tour-a-tour de rous les
accens
&
de toutes les modulations qui peuvent tou·
cher l'ame
&
flatter l'oreille. Si une paffion trop vio·
lente
&
trop doulonreufe y régnoit fans reHiche,
l'expreffion muficale ne feroit qu'une fuite de gémif–
femens
&
de cris; fi la couleur en étoit continuel–
lement fombre, l'expreffion feroit trifiement mo–
notone
&
fombre comme elle ; s'il n'y régnoit que
des fentimens doux
&
foibles,
1'
expreffion feroir
funs chaleur
&
fans force; elle n'auroit aucun reiief.
C'efi done le melan,ge des ombres
&
des lumieres
Tom~
IJ,
.
CHA
J2I
~ui fai~
le chatme
&
la .m:gie d'un poeme defiiné
a '
etre m1s en chanr; ce do1t etre l'efquiífe d'un tableau:
le poete le compofe , le muíicien l'acheve. C'efr au
premier
a
ménager
a
l'autre les paífages du clair-–
ob,fcur ; m.ais ces
p~ífages ne~
doivent etre ni trop
frequens
m
trop rap1des: on
s
y
cfi trompé; loríque
pot
éviter la monotonie, ou, pour augmenter les
effi
, on a cru devoir paífer brufquenient
&
fans
ceífe dn blanc au noir. Un melange conrinuel de
couieurs tranchantes fatigue l'imagination comme
les yeux. L'art d'éviter ce
~apillotage
eft d'obferver
les gradations ,
& ,
par des. nuances légeres, de join–
dre l'harmonie
a
la variété : e'eft
a
quoi fe prete
tout naturellement le fyfteme de l'opéra Frans:ois,
&
~
quoi répugne abfolument le fyfreme de l'opéra:
ltahe.n. Pour s'en convaincre, il fuffit de comparer
le fu;et dé Régulus avee celui d'Armide.
.Voy
e{
LY..
RlQUE.
Suppl.
Depuis que l'on s'occupe en France
a
perfeél:ionner
la mufique, la théorie du
chant
a été difcutée par des
gens d'efprit& de go{tt,
&
leur objet commun aété
d'examiner file
chant
Italien pouvoit ou devoit etre
appliqué
a
la langue Frans:oife. L'un des premiers
qui ont examiné cette quefiion , a cru la décider en
aífurant que non- feulement les Frans:ois n'avoient
point de mufique, mais que leur langue n'en auroit
jamais. On dit qu'il vient d'avouer fon erreur; il
y ,
a long-tems que cct aveu auroit pn lui échapper..
Nombre d'eífais en divers genres, ont prouvé par les
faits
&
par. des faits multipliés, que ni la fyntaxe
~
ni la profodie, ni les élémens de
notn~
langue , ni
fon génie n'étoient incompatibles avec une bonne
mufique.
Nous avons depuis quelques années des aírs bril–
lans
&
légers , des airs comiques , d'un caraélere
tres-fin , tres-vif
&
tres-piquant, des airs graciem.t'
&
tendres , des airs touchans
&
d'un pathétique
aífez fort;
&
dans ces airs, la langue
& la mufique
font auffi
a
leur aife que daos le
chant
Italien.llfaut
avouer cependant que les fyncopes'
les prolations
&
les inverfions de mots
qu~
l'Iralien oermet plus
aifément que notre langue, peur-etre auÍii: un retour
plus fréquent des voyelles les plus {onores, don-
1
nent au
cha7Jt
Iralien plus de jeu
&
plus de brillant
que le
chant
Frans:ois n'en peut avoir : mais avec
ce défavantage, il efr poffible encore d'avoir une
bonne mufique : dans cctte lan ue dont on dit tant
de mal, Racine
&
Quinault o t fait des vers auffi
mélodieux que
1'
Arioll:e
&
que Métafiafe. Un mu–
ficien, homme de génie,
&
un poete homme de
goíH , en vaincront de rneme les difficultés, s'ils
veulent s'en donner la peine.
Mais l'homme' de lettres, qui a pris la défenfe de
notre langue contre celui qui vouloit lui interdire
l'efpérance meme d'avoir une mufique' a été trop
loin, ce me femble, en avans:ant que la mufique
eft indépendante des langues. (( Comment, dit-il,
H
fait- on dépendre ce qui chaote toujours, de ce
»
qui ne chante jamais"
?
Et quelle efi la Iangue qui ne chante pas, des que
l'expreffion s'anime
&
peint les mouvemensdel'ame?
'( J
e ne cons:ois pas , ajoute -
t-
il, la diffé–
" rence effentielle qu'on voudroit étáblir ·entre le
,,
chant
vocal
&
l'inflrumental. Quoi! celui-ci éma·
»
neroit des feules lQix de l'harmonie
&
de la mé–
" lodie ,
&
l'autre dépendant des infle
xionsde la
»
parole, en feroit une imitation? c'efi
cré.erdeux
»
arts au lieu d'un ''·
Ce n'efi qu'un art, mais dont l'imitation efr tantot
plus vague
&
tantót plus déterminée.
Il
en efi de la
mufique comme de la danfe ; celle-ci n'efr fouvent
qu'un développ'ement de. toutes les graces dont le
corps humain efi fufceptible daos fes pas, fes
mou~
vemens' fes anitudes' en un mot, .daos fon aaion.
Ss
















