
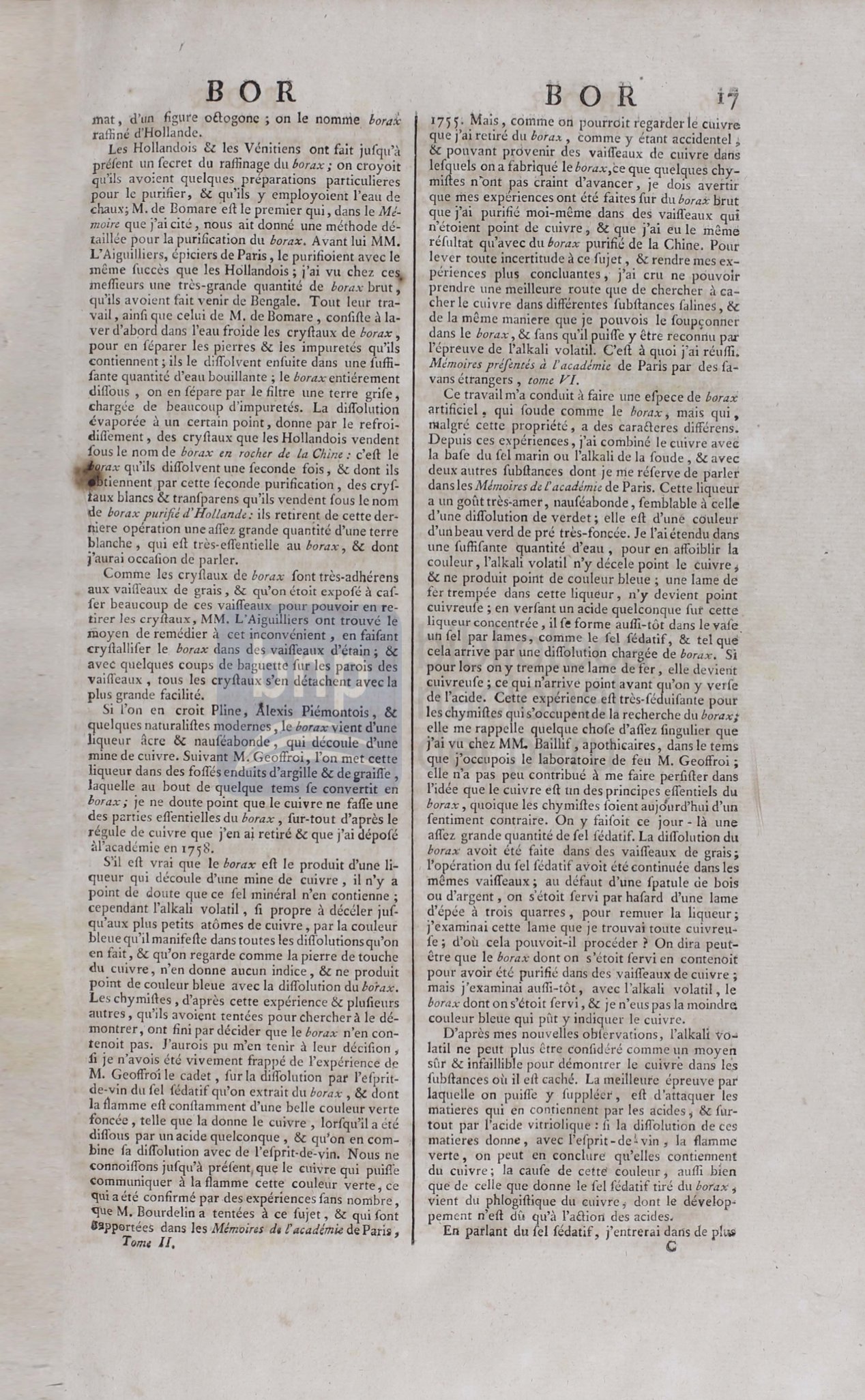
BOR
mat, d'un figure otl:ogone ; on le nomttie.
hora:k
raffiné d'Hollande ..
Les
Hollandois
&
les
V
énitiens ont fait jufqu'a
préfent un fecret du raffinage du
horax;
on croyoit
qu'ils avoient quelques préparations particulieres
pour le puriñer,
&
qu'ils
y
employoient l'eau de
chaux;
M.
de Bomare "efr le premier qui, dans le
Mé–
moire
que j'ai cité, nous ait donné une méthode dé–
taillée pour la purification du
borax.
Avant lui
MM.
L'
Aiguilliers, épkiers de Patis, le purifioient avec le
meme fucd:s que les Hollandois ; j'ai vu chez ces
meffieurs une tr 's-grande quantité de
borax
brut,
qu'ils avoient fait venir de Bengale. Tout leur tra–
vail, ainfi que celui de
M.
de Bomare, confifie a la–
ver d'abprd dans l'eau froide les cryfiaux de
borax,
pour en féparer les pierres
&
les impuretés qu'ils
contiennent; ils le diifolvent enfuite dans une fuffi–
fante quantité d'eau bouillante ; le
borax
entiérement
.difious , on en fépare par le filtre une terre grife,
chargée de beaucoup d'impuretés. La diífolution
évaporée
a
un certain point' donne par le refroi–
diífement, des cryfiaux que les Hollandois vendent
íous le nom de
borax en rocher de la Chi'ne:
c'efr le
rax
qn'ils diifolvent
u.nefeconde fois,
&
dont ils
tiennent par cette fec.onde puriñcation , des cryf–
taux blancs
&
tranfparens qu'ils vendent fous le nom
de
borax purifié d'Hollande:
ils retire11t de cette der–
s}iere opéraúon une aifez grande quantité d'une terre
blanche, qui efr tres-eífentielle au
borax,
&
dont
j'aurai occafion de parler.
Comtne les cryfiaux de
horax
font tres-adhérens
aux vaiífeaux de grais,
&
qu'on étoit expofé
a
caf–
fer beaucoup de ces vaiífeaux pour pouvoir en re–
tirer
les
cryfraux,
MM.
L'Aiguilliers dnt trouvé le
moyen de remédier a cet inconvénient ' en faifant
cryfiallifer le
borax
dans des vaiífeaux d'étain;
&
avec quelques coups de baguette fur les parois des
vaiífeaux, tous les cryfiaux s'en détachent avec
la
plus grande facilité.
Si l'on en croit Pline, Alexis Piémontois,
&
quelques naturalifres modernes ,.le
borax
vient d'une
liqueur
~ere
&
nauféabonde , qui découle d'une
mine de cuivre. Suivant
M.
Geoffroi, l'on met cette
liqueur dans des foífés enduits d'argille
&
de graiífe,
laquelle au bout de quelque tems fe convertit en
horax;
je ne doute point que le cuivre ne faífe une
des pc:rties efi€mtielles du
botax,
fur-tout d'apres le
rigule de cuivre que j'en
ai
retiré
&
que j'ai dépofé
al'académie en
17)8.
S'il efi vrai que le
borax
efr le produit d'une
Ii–
queur
qui
découle d'une mine de cuivre , il n'y a
point de doute que ce fel minéral
n~en
contienne ;
cependant l'alkali volatil '
fi
propre a décéler juf–
qu'aux plus petits atomes de cuivre, par la couleur
bleue qu'ilmanifeíl:e dans toutes les diífolutionsqu'on
en fait,
&
qu
1
on regarde comme la pierre de touche
du cuivre, n'en donne aucun indice,
&
ne produit
point de couleur bleue avec la diífolution du
borax.
Les chymifres, d'apres cette expérience
&
plufieurs
autres' qu'ils avoient tentées pour chercher
a
le dé–
montrer; ont ñni par décider que le
borax
n'en con–
tenoit pas. J'aurois pu m'en tenir
a
leur décifion ;
1i
je n
'avo.isété vivement frappé de l'expéríence de
M.
Geoffroí le cadet , fur la diífolution par l'efprit–
de-vin du fel fédatif qu'on extrait du
borax
,
&
dont
la flamme efr conframment d'une belle couleur verte
foncée , telle que' la donne le cuivre , lorfqu'il a été
diífons par un acide quelconque ,
&
qu
1
on en com–
bine fa diífolution avec de l'efprit-de- vin. Nous ne
connoiífons jufqu'a préfent qu<: le cmivre qui puifie
communiquer
a
la flamme cette couleur verte, ce
qui a été confirmé par .des expéríences fa_ns nombre,
~ue
M.
Bourdelin a tentées
a
ce fujet,
&
qui font
aappenées dans les
·Mémoires
d,
l'
académie
d~
Parii,
Tome
JI.
B
O
R.
í7
1
17
55~
Mais' ccimme
Orl
pourrdit regarder
ié
cb.ivre
que j'ai retiré du
borax,
comme y étant accidente!;
&
ponvant p.t;dvenir des vaiífeaux de cuivre dahs
lefquels on a fabriqué le
borax,'ce
que quelques chy–
mifres n"ont pas éraint d'avancer, je dois avenir
que mes expériences ont été faites fur du
borai
brut
que
j'ai
puriñé moi-menie dans des vaiífeaux qui
n'étoient point de cuivre?
&
que
j'!:li
eu le meme
réfultat qu'avec
du
bora:JS
purifié de la Chine. Ponr
lever toute incertitude a ce fujet ,,
&
rendre mes ex–
périences plus concluantes ,. j'ai cru ne pouvoit
prendre une meilleure route que de
cherch~r
a ca–
cher le cui vre dans différentes fubfrances falines,
&.
de la meme maniere que je pouvois le foups:onner
dans le
borax'
&
fans qu'il puiífe y etre reconriu par
l'épreuve de l'alkali volatil. C'efi
a
quoi j'ai réuffi..
Mémoires préftntés
a
l'
académie
de Paris par des fa–
vans étrangers ,
tome VI.
Ce travail m'a conduit
a
faire une efpece de
berax
artiñciel
~
qui foude comrne le
l3orax,
mais. qui ,
malgré cette propriété, a des caraél:eres différens.
Depuis ces
expérien~es,
j'ai combiné le cuivre ave e
la bafe du fel marin ou l'alkali de
la
foude ,
&
avec
deux atltres fubilances dont je rr¡e réferve de parler
dans les
Mémoires deL'académie
de Paris. Cette liquet+r
a un gout tres:.amer' nauféabonde' femblable a éelle
d'une diífolution de verdet; elle eíl: d'uné cduleur
d'un beau verd de pré tres-foncée.
J
e 1'ai étendu dans
une fuffifame quantité d'eau , pour en affoiblir la
couleur, l'alkali volatil n'y décele point le cuivre;
&
ne produit poirtt de couleur bleue ; une lame de
fer trempée dans cette liquéur,
n'y
devient point
cuivreufe; en verfant un acide quelconque fui' cetté
liqueur
concentrée, il fe forme auffi-tot da"ns le
va.fe.uh
(el
par lames, comme le fel fédatif,
&
te
l quecela arrive par une diífolution chargée de
borax.
Si
pour lors on
y
trempe une lame de fer, elle devierit
cuivreufe;
C€
qui n'arrive point avant qu'on y ve:rfe
de l'acide. Cette expérience efi tres-féduifante pour
les chymifres qui s'occupent de la recherche du
boraxJ
elle me rappelle quelque chofe d'aífez fingulier que
j'ai vu chez
MM.
Baillif,
apothi~aires,
dans le tems
que j'occupois le laboratoire de feu
M.
Geoffroi;
elle n'a pas peu contribué a me faire perfifier dans
l'idée que le cuivre efi nn des príncipes
~ífentiels
du
borax,
quoique les chymifies foient aujC:urd'hni d'un
fentiment contraire. On
y
faifoit ce jour- la une
aífez grande quantité de fel fédatif. La diífolution du
borax
avoit étcb faite dans des vaiífeaux de grais;
l'opération du fel fédatif avoit été continuée dans les
m~mes
vaiífeaux; au défaut d'une fpatule de bois
ou d'argent, on s'étoit fervi par hafard d'une lame
d'épée a trois quarres ' pour remuer la liqueur;
j'examinai cette lame que je trouvai toute
cuivre~t·
fe;
d'ou cela pouvoit-il procéder
?
On dira peut–
etre que le
borax
dont on s'étoit fervi en contenoit
pour avoir été puriñé dans des vaiífeaux de cuivre ;
mais j'examinai aufii-tot, aveG: l'alkali volatil, le
borax
dont on s'étoit fervi,
&
je n'eus pas la moindre.
couleur bleue qui put
y
indiquer le cuivre.
D'apres mes nouvelles obfervations, l'alkali
vo.a
latil ne pellt plus etre confidéré comme t1n
moye~
sf1r
&
infaillible pour démontrer le cuivre dans les
fubfrances oú il efr caché. La meitleure épreuve pat
laquelle on puiífe
y
fuppléer, efr d 'attaquer les
matieres qui en contiennent par les acides
1
&
Ú1r–
tout par l'acide vitriolique : fi la diífolution de c'es
matiens donne, avec l'efprit-
de~
vin
1
la flamme
verte, on peut en conclure· qu'elles contienn;nt
du cllivre;
Ja
caufe de cette coulenr; aufii bten
que de celle que donne le fel féGlatif tiré du
botax
1
vient du phlogifrique du euivre; dont le dével6p•
p~ment
n'efi dft qu'a }'aétion. des
acid.es.En parlant du
fel
íedatif,
)'ent
rera1 darts qe
phw
e
















