
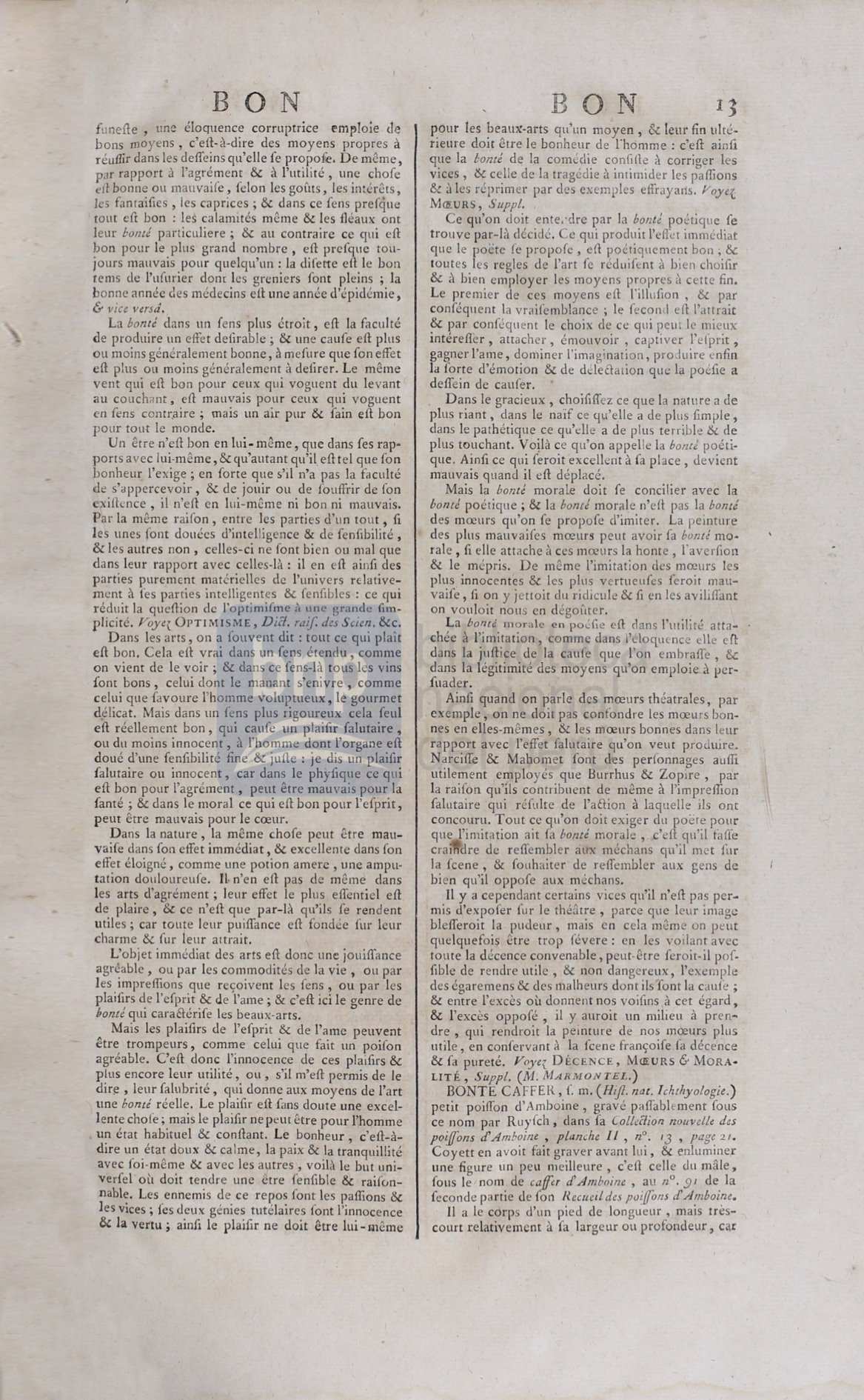
·B O N
funeíl:e , une éloquence corruptrice empioie
de
bons moyens' c'eíl-a-dire des moyens propres
a
réuflir dans les deffeins qu'elle fe propofe. De meme,
par
rapport
a
l'agrémem
&
a
l'utilité ' une chofe
eft
bonne ou mauvaife, felon les gotus, les iAtérets,
Jes
fantaiúes , les
capric~s;
&
dans ce fens prefque
tout eft bon :
le$
calamités meme
&
les fléaux ont
leur
bonté
particuliere ;
&
au contraire ce qui eíl
bon pour le plus grand nombre , efi: prefque tou–
jours mauvais pour quelqu'un : la difette efi: le bon
rems de l'ufurier donr les greniers font pleins ; la
bonne année des médecins efi: une année d'épidémie,
&
vice versd.
La
bonté
dans un fens plus étroit, efi
la
faculté
de produire un effet deúrable ; & une caufe
eft
plus
o u moins généralement bonne'
a
mefure que fon effet
efi:
plus ou moins généralement
a
deúrer. Le meme
vent qui efi: bGn pour ceux qui voguent du levant
au
couchant, efi mauvais pour ceux qui voguent
en fens contr.aíre ; mais un air pur & fain efi: bon
pour tout le monde.
Un etre n'efi bon en lui-meme, que dans fes rap•
ports avec lui-meme,
&
qu'autant qu'il.eíl: tel que fon
bonheur l'exige; en forre que s'il n'a pas la faculté
e s'appercevoir,
&
de jouir ou de fouffrir de fon
e;x.i.ílence , il n'efi: en lui-meme ni bon ni mauvais.
Par la meme raifon, entre les parties d'un tout, fi
les
unes font douées d'intelligence
&
de fenúbilité ,
&
les atltres non , celles-ci ne font bien ou mal que
dans leur rappon avec celles-la : il en efi: ainfi des
parties purement rnatérielles de l'univers relative–
ment
a
fes parties intelligentes
&
fenúbles : ce qui
réduit la quefi:ion de
l'optimifme
a
une grande íim–
plicíté.
Voye{
ÜPTIMISME,
DiE!.
raif. des
S
cien.
&c.
Dans les arts, on a fouvent dit : tout ce qui plait
eft bon. Cela efi: vrai dans un fens étendu, cornme
on vient de le voir ;
&
dans ce fens-la tous les vins
font bons, celui dont le rnanant s'enivre, comme
celui que {avoure l'homme voluptueux, le gourmet
délicat. Mais dans un feos plus rigom·eux cela feul
efi: réellement bon, qui caufe un plaiúr falutaire ,
ou dn moins innocent' a l'homme dont l'organe efi:
doué d'une fenúbilité fine
&
jufle : je dis un plaifir
falutaire ou innocent, car dans le phyfique ce qui
efi: bon pour l'agrérnent ' peut etre mauvais pour la
fanté ;
&
dans le moral ce qui efi: bon pour l'efprit,
peut etre rnauvais pour le creur.
Dans la nature, la meme chofe peut etre rnau–
vaife dans fon effet irnrnédiat,
&
excellente dans fon
effet éloigné, comme une potion amere , une ampu–
tation douloureufe.
u
n'en efi: pas de rneme dans
les arts d'agrément ; Jeur effet le plus eífentiel efi
de plaire, & ce n'efi que par-la qu'ils fe rendent
utiles ; car tonte leur puiífance efi: fondée fur leur
charrne
&
fur leur attrait.
L'objet immédiat des arts eíl: done une jouiífance
agreable , ou par les cotnmodités de la vie , ou par
les irnpreffions que rec,:oivent les fens , ou par les
plaiúrs de l'efprit
&
de l'ame;
&
c'efi: ici le genre de
úonté
qui caraél:érife les beaux-arts.
Mais les plaiíirs de l'efprit
&
de l'ame peuvent
etre trompeurs' comme celui que fait un poifon
agréable. C'efi: done l'innocence de ces plaiúrs
&
plus encore leur urilité, ou, s'il m'eíl: permis de le
dir~
, leur falubrité, qui donne aux moyens de l'art
une
honté
réelle. Le plaiúr efi: fans doute une excel–
lente chofe; mais le plaifir ne peut etre pour l'homme
un état habituel
&
,coníl:ant. Le bonheur, c'efi-a–
dire un état doux & calme, la paix & la tranquil!ité
avec foi-meme & avec les autres, voila le but uni–
verfel-
Otl
doit tendre une etre fenfible
&
raifvn–
nable. Les ennemis de ce repos font les paffions
&
les vices; fes deux génies tutélaires font l
'innocen.ce&
la vertu ; ainfi le plaifir ne doit etre lui- meme
B ON
13
pour tes beaux-atts qn'un moyen ,
&
lenr fin tllté–
tieure doit etre le bo nheur de rhómme : c'eíl: ai nú
que la
bo~té
de la comédie conúHe
a
corriger les
vices '
&
celle de la tragédie
a
intimider les paffions
&
a
l.esréprimer par des exemples effrayarts.
Y oye{
M<EURS,
SuppL.
Ce qu'on doit ente.'dre par la
bontd
poétique fe
trouve par-la décidé. Ce quí produit l'eífct immédiat
que le poete
fe
propofe'
ea
poétiquement bon ;
&
toutes les regles de l'art fe réduifent
a
bien choifir
&
a
bien ernployer les moyens propres
a
cette fin.
Le premier de ces rnoyens efi: ,l'illufion ,
&
par
conféquent la vraifemblance ; le fecond efi: l'att rait
&
par conféqu ent le choix de ce qui peu le mieux
intérefier, attacher, émouvoir , captiver l'efprit,
gagner l'ame, dorniner l'ima gi nati on , produ ire enfin
la forte d'émorion
&
de déle étation que la poéíie
a
deifein de caufer.
Dans le gracieux , choifiífez ce que la nature
a de
plus riant, dans le naif ce qu'elle
a
de plus íimple,
dans le pathétique ce qu'elle a de plus te rrible & de
plus touchant.
Vo~la
ce qu'on appelle
la
bonté
poéti–
que . Ainfi ce qui feroit excellen't
a
fa
pl ~ ce,
devient
mauvais quand
il
efi
déplacé.
Mais la
bonté
morale doit fe concilier avec
Ia
bonté
poétique ;
&
la
bonté
morale n'eíl pas la
bond
des mreurs qu'on fe propofe d'irniter. La peinture
des plus rnauvaifes mreurs peut avoir fa
bonté
mo–
rale' ú elle attache
a
ces rnreurs
la
honte' l'averúon
&
le m 'pris. De
m
eme l'irnitation des mreurs les
plus innocentes
&
les plus v ertueufes feroit ma u–
vaife, ú on y jettoit du ridicule & fi en les aviliffant
on vouloit nous en dégoürer.
.
La
bonté
m o r ale en poéíie eíl:
dans l'utilité atta•
chée
a
l'imitation' cornrne dans l'éloqu ence elle eít
dans la jufiice de la caufe que l'on embraífe ,
&
dans la légitimité des moyens qu'on emploie
a
per–
fuader.
Ainfi
quand
on parle
des
mreurs théatrales, par
exemple, on ne doit pas confondre les rnreu rs bon–
nes en
elles-m eme~
,
&
les mreurs bonnes dans leur
rapport avec l'effet falutaire qu'on veut procluire.
NarciíTe
&
Mahornet font eres pedonnages auffi
utilement employés que Burrhus
&
Zopire , par
la raifon qn'íls contribuent de meme
a
l'impreffion
falutaire qui réfulte de l'aétion
a
laqu elle jls ont
concouru. Tout ce qu'on doit exiger
du
poere pour
que l'imitation ait fa
bomé
rnorale , . c'efi: qu'il faffe
craindre de reífernbler aux méchans qu'il met fur
la fcene ,
&
fouhaiter de reífembler aux gens de
bien qu'il oppofe aux rnéchans..
I1
y
a cependant certains vices qu'il n'efr pas per–
mis d'expofer fur le théatre , paree que leur image
blefferoit la pudeur ' mais en cela meme on p eut
quelquefois erre trop févere : en les voílant avec
toute la décence convenable, peut-erre feroir-il pof–
fible de rendre utile,
&
non dangereux, l'exemple
des égaremens
&
des rf1alheurs dont
ils
font la caufe ;
&
entre l'exces ou donnent nos voifins
,a
cet égard,
& l'exces oppofé '
il
y auroit un milien
a
pren–
dre , qui rendroit la peinrure de nos mreurs plus
utile' en confervant
a
la fcene frans:oife fa décence
& fa pureté.
Voyez.
DÉcENCE, M<EURS
&
MORA•
LITÉ,
Suppl.
(M.
MAR'MON TEL.)
BONTE
CAFFER ,
f.
m.
(Hifl.
nat. l chthyologie.)
perit poiffon d' Amboine , gravé paífablernent fous
ce nom par Ruyfch, dans fa
ColüRion nouvelü des
poif{ons d'A mboine
,
planche 11
,
n°.
13
,
page
2 1.
Coyett en avoit fait graver avant lui,
&
enluminer
une figure un pe u meilleure ' c'eíl celle dn rnale,
fous le t nom de
caffir d'Amboine
,
au
n°.
9'
de la
feconde partie de fon
RecueiL des pvij{ons d'Amboineo
Il a le cdrps d'un pied de longueur , mais tres–
court relativement a fa .largeur ou profondeur; car
















