
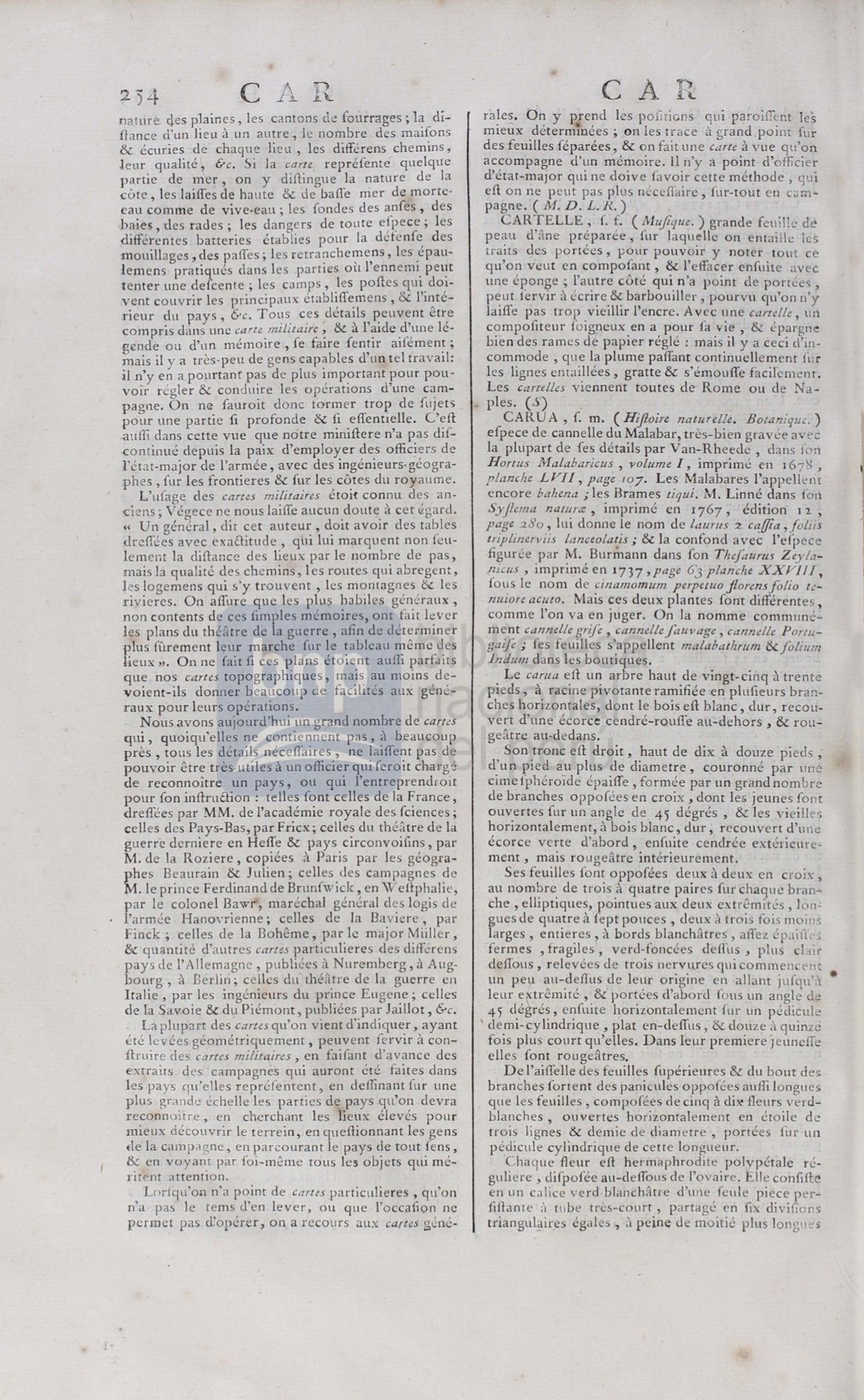
2)4
e
na ture qes p1aines, les cantons de fourrages; 1a dí–
llanee d'un lieu
a
UD
autre, le nombre d
S
maifons
&
écuries de chague lieu , les différens chemins,
lellr qualité,
&c.
Si la
carte
repréfente quelque
partie de mer, on
y
diíl:ingue la nature de la
cote' les laiífes de haute
&
de baile mer de morte–
eau comme de vive-eau; les {ondes des anfes, des
baies 'ues rades ; les dangers de toure efpece; les
<:lifférentes batteries établies pour la défe nfe des
mouillages, des paires; les retranchemens, les .épau–
lemens pratigués dans les parties ot1l'<mnem1 peut
tenter une defcente ; les camps , les po.fies qui doi–
vent couvrir les principaux
établ~íf~mens,
&
l'i~té
rieur du pays,
&c.
T01.~s. c~ s deta~ls, ~euv~nt
etr,e
compris dáns une
c:ute.mtLttaT-re
~
&
a 1
~1de
_d ,une le–
gende ou d'un mem01re , fe fa1re {entir atfement ;
mais il y a tres-peu de gens capables d'un tel travail:
il
n'y
en a pourtanr pas de plus important pour pou- .
voir r éoler
&
conduire les opérations d'une cam–
paane. On
n~
fauroit done former trop de fujets
po~Ir
une partie fi profonde
&
íi
eífentielle. C'efi
auffi dans cette vue que notre minifiere n'a pas dif–
.continué depuis la paix d'employer des
offic~ers
de
l'état-major de l'armée, avec des ingéniel:lrs-géogra–
phes 'fur les frontieres
&
fur les cotes du royaume .
L'ufage des
cartes militaires
étoit connu des an–
<:iens; Véaece ne nous laiífe aucun doute
a
cet €gard.
H
Un général, dit cet auteur, doit avoir des tables
<lreífées avec exaél:itude, qüi lui marquent non feu–
lement la diíl:ance des
l~eux
par le nombre de pas,
mais la qualité des chemins, 1es routes qui abregent,
les logemens qui s'y trouvent , les momagnes
&
les
i"Ívieres. On aífure que les plu$ habíles généranx ,
non contents de ces íimples mémoires, ont fait lever
]es plans du théatre de la guerre, afin de d ' termioer
plus fttrement
l~ur
marche fur le tablean meme des
lieux ''· On ne fait
fi
ces plans éroient auffi parfaits
que nos
cartes
topographiques, mais au moins de–
voient-ils donner beaucoup de facilités aux géné–
raux pour leurs opérations.
Nous avons aujourd'hui un grand nombre de
carus
qui' quoiqu'ell es ne contiennent pas,
a
b.eaucoup
pres , tous les détails néceíraires , ne laiífent pas de
pouvoir etre tres-utiles
a
un officier qui feroit chargé
de reconno1tre un pays, o
ti
qui l'entreprendroi t
pour fon inftruél:ion : telles font celles de la France,
-dreífées par MM. de l'académie royale des fciences;
cell es des Pays-Bas, par Fricx; celtes du théatre de la
guerre derniere en Heífe
&
pays circonvoiíins, par
M. de la Roziere, copiées
a
París par les géogra–
phes Beaurain
&
Julien; celles des campagnes de
M.leprince Ferdinand de Brunfwick , en Weítphalie,
par le colonel Bawr, maréchal général des logis de
l'armée Hanovrienne; celles de la Baviere, par
Finck ; celles de la Boheme, par le majo r Miiller,
&
quantité d'autres
cartes
particulieres des différens
pays de 1' Allemagne, publiées
a
Nuremberg,
a
Aug–
bourg ,
a
Berlin; celles du théatre de la guerre en
ltalie, par les ingénieurs du prince Eugene; celles
de
Ia
Savoie
&
du Piémont, publiées par Jaillot,
&c.
La p lupart des
cartes
qu'on vient d'indiquer, ayant
été levées géométriquement' peuvent fervir
a
con–
il:ruire des
cartes militaires,
en faifant d'<!vanee des
extrairs des campagnés qui auront été faites dans
l es pays qtr'elles repréfe ntent, en deflinant fur une
plus grande échelle les parties de pays qu'on devra
réconnóitre , en cherchant les lieux élevés pour
mieux découvrir le terrein, en queílionnant les gens
('le la campa gne, en parcourant ]e pays de tout fens,
&
en voyant par
foi-m~me
tous les objets qui mé–
ritent attention.
Lorfqu'on n'a po_int de
cartes
particulieres , qu'on
na ... pas le tems
el'
en lever, o u que l'occ.aíion ne
permet pas cCopérer, on a recours aux
cartes
géné-
CA
ra~e~.
dn
y
p·rend les poúti ns qui paroiífent les
mxeux détermmées ; onles tr ace
a
grand poin t fur
des fe1.1Ílles féparées,
&
on fait une
cartea
vue qu'on
accompagne d'un mémo1re. Il n'y a point d'officier
d'état-major qui ne doive favoir cette méthode, qui
efi on ne peut pas pl us n ' ceífaire, fur-tout en cam–
pagne.
(M: D.
L.
R.)
CARTELLE, f. f. (
Mujique.)
grande feu ille de
peau d'ane préparée, fur laquelle on entailie les
traits <:les portées, pour pouvoir y noter tou t ce
qn'on veut en compofant,
&
l'effacer enfuite avec
une éponge ; l'autre coté qui n'a point de portées
peut fervir
a
écrire
&
barbouiller' pourvu qu'on n'y
laiífe pas trop vieillir l'encre. Avec une
canelle
un
c?mpofiteur foig!:eux_en a pour fa vie ,
&
épa:gne
b1en desrames dé pap1er réglé : mais il y a ceci d'in–
commode , que la plume paífant continuellement fur
les lignes entaillées, gratte
&
s'émouífe facilemenr.
Les
cartelLes
viennent toutes de- Rome ou de Na-
- ples.
(S)
CARUA ,
f.
m. (
Hijloire naturelle. Botaniqu
·. )
efpece de cannelle du Malabar, tres-bien gravée avee
la plupart de fes détails par Van-Rheede , daos
f
n
Hortus Malabaricus
,
yolume
l,
imprimé
en
1678 ,
planche LVII, page
107.
Les Malabares l'appellent
encore
bahena
;
les Brames
tiqui.
M. Linné dans fon
Syflema
natz~rce,
imprimé en 1767, édition
12 ,
page
28o ,
lm donne le nom de
laurus z caJlia ,foliis
triplinerviis lance.olatis;
&
la confond avec l'efpece
figur ée par M. Burmann dans fon
T!zefaurus Zeyla–
n icus,
imprimé en
1737
,page 63 planche
XXPIII,
foL~S
le nom de
~inamomum
perpetuo jlorens folio u–
muore acuto.
Mats ces deux plantes font différentes
1,
.
1
'
comme on va en ¡uger. On a nomme communé-
ment
cannelle grife , cannelle fauvage, cannelle Portu–
galfe;
fes feuilles s'appellent
malabathrum & folium
lizdum
dans les
~boutiques.
. Le
carua
~fi u~
arbre haut
.d~
vingt-cinq
a
trente
pleds'
a
racme ptvotante ramifiee en plufieurs bran–
ches horizontales, dont le bois eft blanc, dur, recou–
vert d'une écorce cendré-rouife aü-dehors,
&
rou–
geatre au-dedans.
Son tronc efi droit, haut de dix
a
douze pieds ·
d'
. d
'
un p1e au plus de diarnetre, couronné par une
cimefphéro1de épaiífe, formée par ungrandnombre
de branches oppofées en croix , dont les jeunes font
ouvertes fur un angle de 45 dégrés ,
&
les vieilles
horizontalement,
a
bois blanc' dur' recouvert d'une
écorce verte d'abord , enfuite cendrée extérieure"'"
ment, mais rougditre intérieurement.
Ses feuilles font oppofées deux
a
deux en croix ,
au nombre de trois
a
quatre paires fur chaq ue bran–
che , elliptiques, pointues aux deux extremit 's , lon–
gues de quatre
a
fept pouces ' deux
a
trois fois moins
larges' entieres'
a
bords blanchatres' aífez ,paifte-:;
fermes , fragiles, verd-foncées deífus , plus clai r
deífous, relevées de trois nervure.s qui commen ent
un
pe~
au-defius de leur origine en allant jufqu'a
leur etctremité ,
&
portées d'abord Io us un anole d
45 dégrés, enfuite horizontalement fur un
p é~licule
' demi-cy lindrique, plat en-deífus,
&
douze
a
quinze
fois plus court qu'elles. Dans Ieur premiere jeuneífe
elles font rougeatres.
De l'aiíf.elle des feuilles fupérieures
&
du bout des.
branches forrenr des panicules oppofées au:ffi longnes
que les feuilles' compofées de cinq
a
di~
fleurs verd–
blanches , ouvertes horizontalemenr en étoile de
trois lignes
.&
demie de diametre , porrées fur un
pédicule cylindrigue de cette longueur.
Chaque fleur eíl: hermaphrodite polypétale r é–
guli ere, d.ifpofée au-deífous de l'ovaire. Ell e coníiire
en un calice ve rd blanchatre d'une fenle piece per–
fiftante
a
t ube tres-court, partagé en
f1X
di viGcns
triangulaires égales '
a
peine de moitié plus longnes
















