
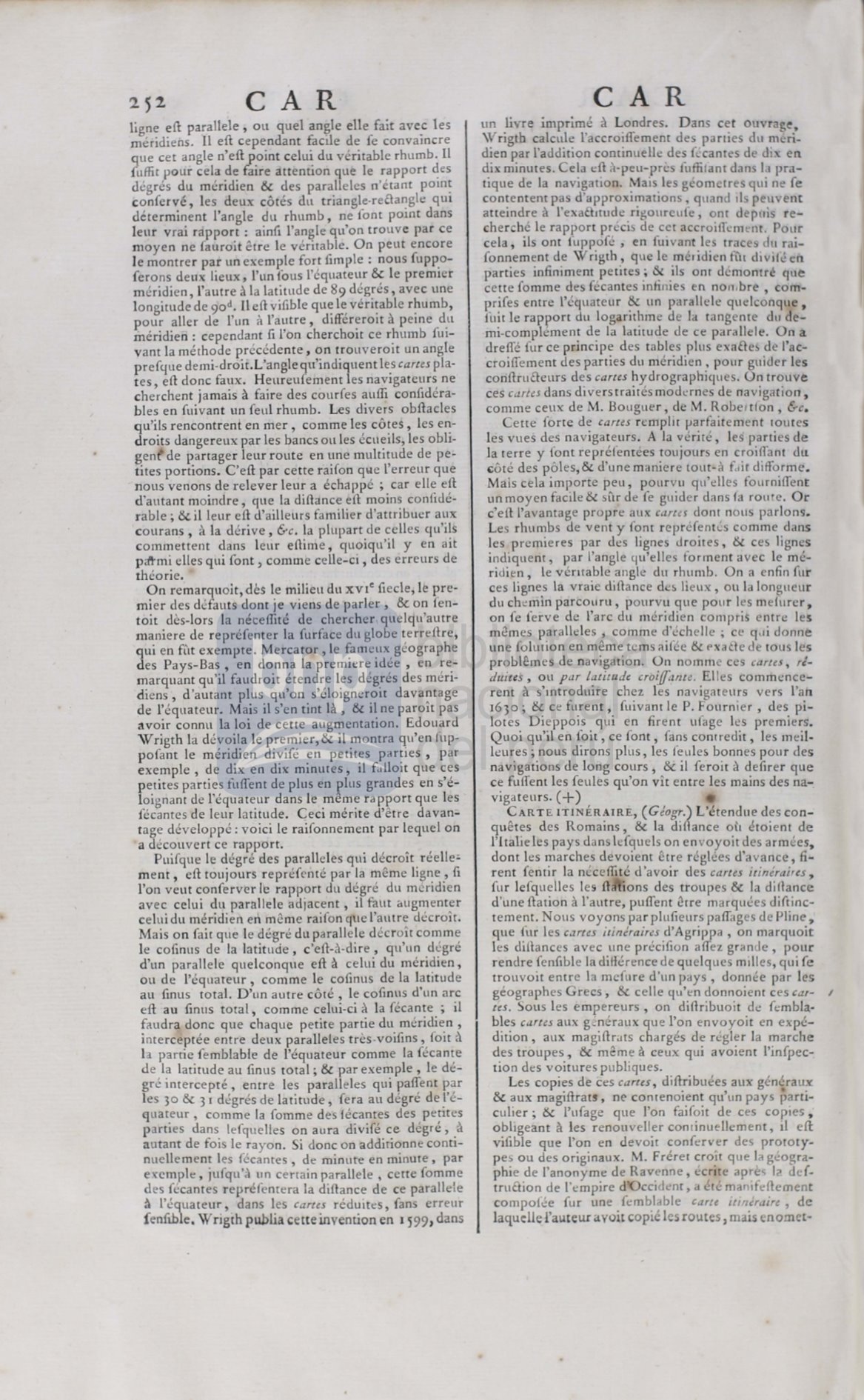
CAR
1l
ne e
parallele ou quel an le elle air av e les
mendiens.
Il
e
ependant acile de
(
onvain re
que cer an len efi point e luí du
v
' ri able rhumb.
U
uffir
pour cela de faire atrention que le rapporr
d~s
degr ' s du m ridien
&
des parallel
s
n' ranr
poin~
con{¡ rvé, les deu. coté du triangle-re angle qUl
décerminent
1
angle du rhumb, ne fonr poínr dans
leur vraí rapport : aíníi
1
angle qu'on rrouve par ce
moyen ne auroit "tre le
'rirable.
n peur encore
le montrer par un exemple fort fimple : nous fupp.o–
fero ns deu . lieux, l'un ous
1
quateur
&
le premt r
m éridien ,
1
autre
a
la latitude de
89
d 'gr ' s, ave
e
une
longirude de 90d,
Il
{l
ifible que le véritable rhumb,
pour all r de l'un
a
l'autre' différeroit
peine du
méridien : cependant
fi
1
on cherchoit ce rhumb fui-
ant la m ' [hode pr
1
e
1
dente, on trouveroit un angl
prefque demi-droit.L'angle qu indiquent les
carees
pla–
te , efi done faux. Heureufement les navigat urs ne
cherchent jamais
a
faire des courfes auffi coníid ,ra–
bles en fuivant un feul rhumb. Les divers obftacles
qu'ils rencontrent en mer
comme les cotes,
l
sen–
droits dangereux par les bancs oules
1
cueils, les obli–
gent de
p
nager leur route en une multitude de pe–
tites portions. C'efi par cette rai on que
l
erreur que
nous venons de relever leur a échapp' ; car elle efl
d'autant moindre, que la difiance efi moin conftdé–
rable ;
&
illeur eft d'ailleurs familier d'atcribuer au
courans,
a
la d
1
rive,
&c.
la plupart de celles qu'il
commettent dans leur eílime, quoiqu'il y en ait
pa'l-mi Hes qui font, comme celle-cí, de erreur de
théorie.
On remarquoit, des le milie
u
du
XVI
e
íiecle,
le
pre–
rnier des d 'fauts dont je viens de parler,
&
on fen–
toit d s-lors la néc:effité de chercher quelqu aurre
maniere de repréfenter la furface du globe terrefire,
quien
fttt
exempte. Mercator, le fameu g ' ographe
des Pays-Bas , en donna la premiere idée , en re–
marquant qu'il faudroit étendre les d
1
gr
1
s des meri–
diens, d 'autant plus qu'on s'éloigneroir davantage
de
1'
1
quateur. Mais
il
s' n tint
la ,
&
il
ne paroit pas
avoir connu la loi de cette augmentation. Edouard
\V
rigth la dévoila le premier,
&
il montra qu'en lnp–
pofant le méridien divifé en petires parties , par
exemple , de dix en dix minut s,
il
f..dloit que ces
perites parrie fuffent de plus en plus grandes en s'é–
loignant de
1"
qua reur dans le meme ra pport que les
¡¡ ~cantes
de leur latitude.
eci mérite d' "tre da van–
tage d
1
elopp
1
:
voici le raifonnemenr par lequel on
a d couvert ce rapport.
Puifque le d ' gré des paralleles qui décroit réelle–
ment'
fi
toujours repr ' fenté par la meme ligne'
fi
1
on veut conferver
le
rapport du dégré du m ridien
avec celui du parallele adjacent, il
fam
augmenter
celui du méridien en meme raifon que l'autre d
1
roir.
Mais on fair que le dégré du parallele d ' roír comme
le cofinus de la latitude, c'eft-a-dire, qu'un dégré
d
un parallele quelconque eft
~
celui du méridien,
o
u
de
1
1
quateur, comrne le cofinus de la latitude
au finus total. D'un autre cot
1
'
le cofimlS d'un are
ft
a
u
finus to al, comme celui-ci
¡:\
la
fil
cante ;
il
faudra done que chaque petit partie dn m ridien ,
interceptée en re deux paralleles tr '
S·
oifins, foit
a
1
partie emblable de l'équareur comme la
1
can e
de la laritude au íinus rotal;
&
par exemple
le dé–
gr~
intercepté, entre les paralleles qui paífent par
le
30
,.
31
dlgrésdela itude, era au d lgr ' del'–
q uareur
omme la fomme des fécantes des perites
p arrie
dans le quelles on aura di ifé ce d gré, -
autant de 01
lera
~on .
i
done on addirionne conri–
nuellement les
1
canre
d~
minute en minute, par
e
'
mplt!, jufqu'a
un
errain parallele
e
tt
omme
d
s (,
cantes repré en era la di ance de ce parall
~e
a }
1
quateur
danS les
C
r.
tS
rédUl
~
fan
rreur
fenfilile,
ngth publi e tteinv ntion en 1599,
dans
u
livre imprim'
t
rigt
cal
l
le l'a
dien ar l'aJdition
1
·r
lu m
t
n~
dt
·
en
· rlitant
d
n lt
1
r -
tique de la nav1 a on.
1
ta '
le
' om"tre quin,
co ntenten pa d'a pro. ima
10n
,
qu n
.I
pe
1 ·
nc
aueindre
a
l'e).a
HUd
rigonr
tle
nt
d
ptn
re-
her
b
le rappon pr
1
d
e
a
roitl'·m
r.•
P
ur
cela, il onr fu po
e ,
en
tui
ant
l
tr
:.
, r
i–
fonnement de
rigth
qu 1
m ·,
idien
hu
dn
11
t
<.:n
parties infimmem p
m
;
ils
onr
d
montr
q
1
cene fomme de
ante
infi,
ie
n
n0 11 bre
m-
prifes entre
1
qua eur
r
un
. rallel qu
1
onque
fuit le rapport
du
looarirhm
d
la
t
n
nt
du
d
~
mi-compl menr de
la
lamude de ce parall le.
na
drefic fur ce príncipe d es rabies plu e
d
1
ac–
croi lfemenr de
p
rries du m
1
ridien
¡
ur
uider
1
s
coní
hu9-
ur des
arces
hydrographiqu
.
n trou
e
ces
u.rts
dan di erstrait' mod \. rnt de na igdtion,
omme ceu de
1.
Bouguer,
d M.
Robe rton,
•
ett
forr de
cart
s
rcmpll[ parfait ment roures
les u
es
s
na \'igateurs.
la
l:rirc.:
le pani
la terre
y
f
nt reprélent e roujour
n
roiífan t JL1
~ot
1
des p oles,
&
d'une manier
tour-a
.ir diffi rme ..
Mais cela import peu, pour u qu'clles fourniffi nt
un moyen ac1le
&
~rrr
de fe guidcr dans
1
ro
u
e.
r
c'efi l'avantage propre au.
art
J
donr nou parlon9.
Les rhumb de vent
y
fonr repr
en r~...
comme d ns
les pr mieres par d
s
lignes Jroires,
&
lign
s
indiquenr, par
1
angle qu'elles forment avec le m
1
-
ridien, le v n rable angle du rhumb.
n a enfin ur
ces ligne_s la vraie d.iílance d
·~
lieu · , ou
la
longueur
du eh ·mm parcouru, pourvu que pour les mefurer,
on fe ferve d
1
are du méridien compri e ntre les
meme paralleles ' comme d'c helle ; ce q..ti donne
une foluÜOn en meme tl.m
rtÍ
ce
&
P.
e
<.1
tOU
les
problemes de naviga tion. On nommt.
e
caru
,
ré–
dttites,
ou
p
zr Latitude
croij[am
.
Elle
commcnce–
r m
a
'lOtroduire chez les na vigateur
er
l'an
1630;
~
ce fu_rent '· fuivanr le
. fournter , des pi–
lotes D1epp01s qm en fir ent
u
age
1
premi ers.
uoi qu'il en foit, ce fonr, fans conrrcdit, le meil–
leures; nous dirons pl us , les feul
5
bonnes pour de
na vigarions de long cours ,
&
il feroit
a
defirer que
ce fuífent les feules qu'on
vn
entre les mains des na-
igateurs. (
+)
CART E
ITI
ÉRAIRE, (
Géogr.)
L'étendue des con–
quetes des Romains,
&
la diflance ou éroient de
l'ltalie
1
s
pays d an
lt
..
fqu ls on envoyoit des arm
'·es.,
dont les marches devoienr '·tre r 'gl es d'
ance,
fi–
rent fenrir la n
1
ceffit d 'a oír des
cartts itinérairts.,
fur lefquelles le
fta ions des troupe
&
la
difiance
d'une fiation
a
l'antre, puífent erre marquée diftJOC–
tement.
ous oyons par plufieurs paífage de line,
que fur les
c.zrus icinérairu
d'Agrippa
on marquoit
les difian es ave une pr ' ciíion aífez grande
pour
rendre enfible la ditférence de quelque m1lles qui fe
trou oxt entre la m
ure d'un pays
donnée par les
géogra he
r
es,
celle
qu
en donnoi
m ces
car–
ees.
ous les empereur , on dillnbuoit de fcmbla·
bles
..trt s
aux
g~n
' rau que l'on en
voit
en
expé–
dirion, aux
ma giílrt..~ts
chargés de régler la marche
des troupes,
m~me
a
ceu, qui avoienr l'infpec–
tio n dt!s voicure publiques.
Les copies de
ces carus ,
difiribuées aux gén ra
x
&
aux magiftrat , ne con1 enoient qu
111
pa
¡
arü-
cuher ·
&
l'ufage que
1
on aifoit de
ce
o ies ,
ob ltgeant
a
les
f
110\1\'el er on inuelJcment,
¡{
fi:
ifible que l'on en de oi
confc:r er des pro oty–
pes ou des originaux.
M.
Frérer croi
que
1
g
1
ogra–
phie de l'anonyme de
avenne ccri
e
apr
1?.
t:
f–
tru810n de
l
rnpire d
cci cnr, a
é
1
ni efl
~menr
compol e fur une femblable
caru ituuraire
,
de
laqu
l'a
t
ur a oit
cop·
' 1
rou
s
l
·
nome •
















