
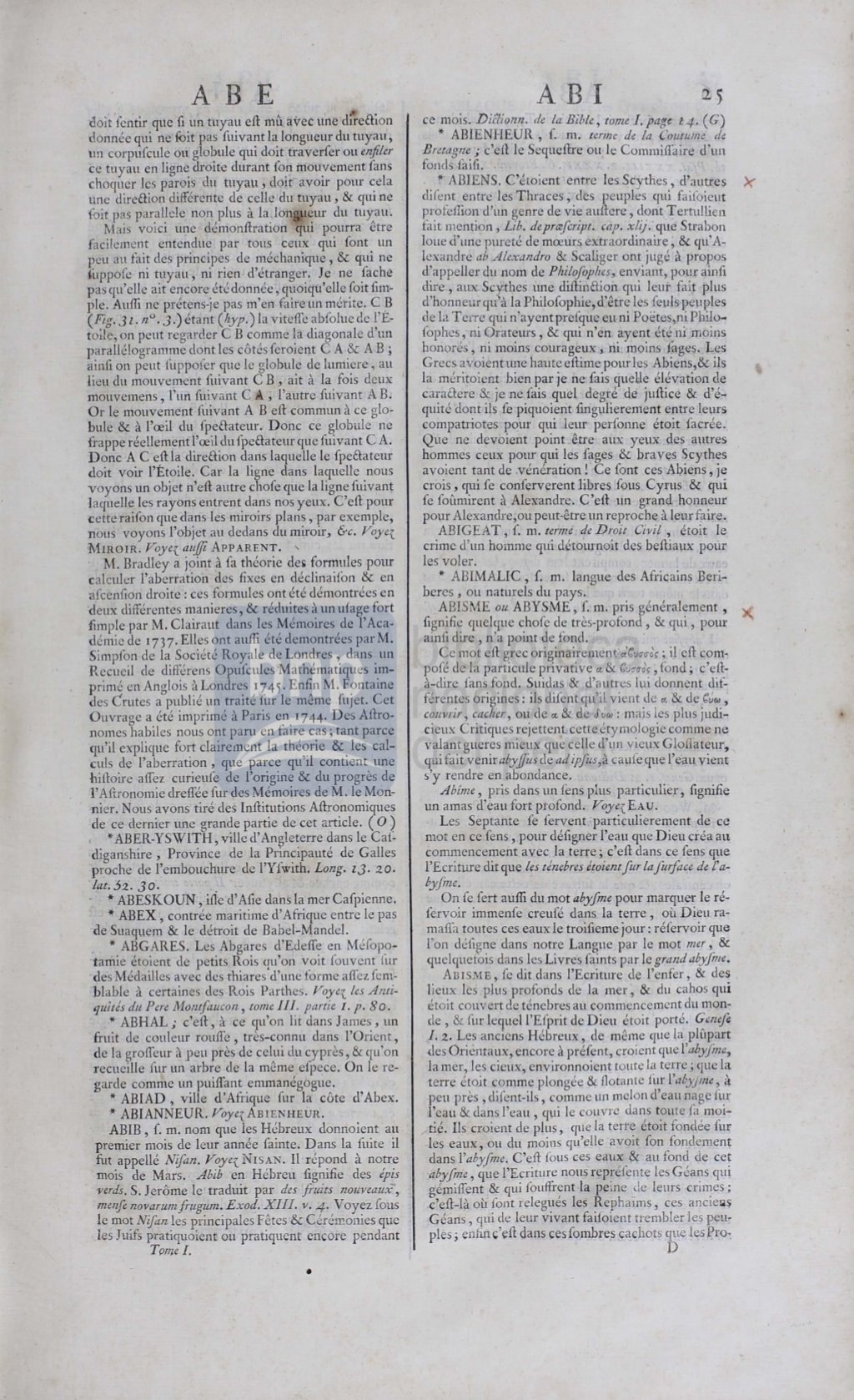
ABE
doit fentir que íi un tuyau ell: mu avec une clti-etEon
dOllnée qui ne f(lit pas fuivant la longueur du tUY,Hl,
un corpufcule ou globule qui doit traverfer ou
enfiLer
ce tuyau en Iigne droite durant ion mouvement fans
choquer lcs parois du tuyau, doit avoir pour cela
une direélion différer1te de celle du tuyau,
&
'lui ne
{oit pas parallele non plus
a
la
1011!~ueur
du tuyau.
Mais voici une démonllration qui pourra (!tre
faeilemcnt entendue par tous ceux qui font un
peu au fait des principes de méchanique, & 'lui ne
lilppofe ni tuyau, ni rien d'étranger. Je ne fache
pas qu'elle ait encore étédonnée, quoiqu'elle foit fUl1-
pie. AulIi ne prétens-je pas m'en faire un mérite.
e
B
(Fig.
3
z.
nO.
3.) étant
(hyp.)
la viteíre abfolue de I'É–
to;¡e,on peut regarder
e
B comme la diagonale d'un
parallélogra1l1me dont les cotés feroie!}t
e
A & AB ;
ainíi on peut fuppofer que le globule de lurniere, au
lieu du 1l10uvement fuivant C B , ait
it
la fois deux
mouve1l1ens, I'un (uivant CA, I'autre [uivant A B.
01'
le 1l10uvement fuivant A B eft commun
a
ce glo–
hule &
a
I'oeü du fpeélateur. Donc ce globule ne
frappe réellement l'oeildu fpeélateur que fuivant CA.
Done A C eft la direLtion dans lac¡uelle le fpeLtateur
doit voir l'Étoüe. Car la ligne dans laquelle nous
voyons un objet n'eft autre chofe que la ligne fuivant
laquelle les rayons entrent dans nos yeux. Ceft pour
cette raifon que dans les miroirs plans, par exemple,
nous voyons l'objet au dedans du miroir,
&c. Voye{
MlROIR .
Voye{ alljft
ApPARENT. ,
M. Bradley a joint
a
fa théorie dei formules pour
calcu1er I'aberration dcs fixes en déclinaiíon & en
afceníion droite : ees formules ont été démonu'ées en
deux différentes manieres, & réduites
a
un ufage fort
fimple par M. Clairallt dans les Mémoires de l'Aca–
démie de
1737.
Elles ont aulIi été demontrées par M.
Simpfon de la Société Royale de Londres, dans un
RecueiJ de différens OpufeuJes Mathématiques im–
primé en Anglois
a
Londres
174
S.
Enfin M. Fontaine
des erutcs a publié un traité fur le mame fujet. Cet
Ouvrage a été imprimé
a
Paris en
1744.
Des Afuo–
nomes habiles nous ont pan! en faire eas; tant paree
'lu'il explique fort clairement la théorie & les eal–
culs de l'aberration, c¡ue parce c¡u'i1 contient une
hiftoire aífez curieufe de l'origine & du progres de
l'
Afuonomie dre/lee fur des Mémoires de M. le Mon–
nier. Nous avons tiré des lnftitutions Afrronomi9ues
de ce derruer une grande partie de cet article. ( O )
..ABER-YSWITH, villc d'Angleterre dans le
Ca!~
diganshire , Province de la Pnncipauté de Galles
proche de l'embouchure de I'yfwith.
Long.
z3.
20.
lato
.)2.30 .
. .. ABESKOUN, ilie d'Afie dansIa merCaf¡lienne.
.. ABEX, contrée maritime d'Afriquc entre le pas
de Suaquem
&
le détroit de Babel-Mandel.
.. ABGARES. Les Abgares d'Edeífe en Mé(opo–
tamie étoient de petits Rois qu'on voit fouvent (ur
desMédailles avec des thiares d'une forme alfez fcm–
blable
a
certaines des Rois Parthes.
Voye{ les Anti–
'luités du Pere Montfallcolt, tome
JII.
parde
l.
p.
80.
*
ABHAL; c'ell,
a
ce
~u'on
lit dans James , un
/Tuit de couleur rouífe, tres-connu dans l'Orien! ,
de la groífeur
a
peu pres de celui du eypl'es,
&
(¡u'on
recueille fur un arbre de la meme efpece.
011
le re–
garele comme un puilfant emmanégoguc.
*
ABIAD , ville d'Afrique (ur la cote d'Abex.
*
ABIANNEUR. Voye{ABIENHEUR.
ABlB,
f.
m. nom que les Hébreux donnoient au
premier mois ele leur année faintc. D ans la fuite iI
fut appellé
Ni/an. Voye{
NISAN.
11
répond
a
notre
mois de Mars.
Abib
en Hébreu íignifie des
épis
""ds.
S. Jerome le traduit par
des fnúts 1l0llVeaUx,
melif'e novaramfmgum. Exod.
XIiI.
v.
4. Voyez fous
le mot
Ni/an
les principales Fetes & Cérémonies que
les Juifs pratiq110ient ou pratic¡uent encore pendant
Tpp¡e l.
A B 1
ce l1lois.
niaioml. de la Bible, tome
l.
page
L./.
(G)
*
ABIENHEUR,
f.
ro.
terllle de la CoutlLlne
d~
Bmagne;
c'efi le Sequeíhe ou
le
Commiífaire d'un
fOllelS faili.
.
*
ABIENS.
Cétoient entre les Scythes, d'autres
X
elifent entre les Thraces, des peuples qui faifoieut
profeiIion d'un
~enre
de vie auil:ere, dont Tertullien
fait mention,
LIb.
deprmfeript. cap. xlij.
que SU'abon
loue<l'une pureté de moeurs extraordinaire, & c¡u'A–
Icxandre
(lb Alexandro
&
Scaliger ont jugé
a
propos
d'appeller du nom de
PhiloJoplzes,
enviant, pour ainfi
dire, aux Scythes une di1l:inétion qui leur fait plus
d'honneurqu'a la Philofophie,d'atre les (euls peuples
de la Terre qui n'ayentprefquc eu ni Poetes,ni Pllllo–
fophes, ni Orateurs, & 'luí n'en ayent été ni moins
honorés, ni moins courageux, ni -moins ?,¡ges. Les
Grecs avoient Ime haute efrirne pourles Abiens,& ils
la mérítoient bien par je ne fais queUe élévation ele
cal'aLtere
&
je ne (ais quel degré de juilice
&
d'é–
quité dont ils fe piquoient íingulierement entre leurs
compatriotes pOIll' qui 1eur perfonne étoit [acrée.
Que ne devoient point etre aux yeux des mItres
hommes ceux pour
~ui
les fages & praves Scythes
avoient tant de .véneration! Ce font ces Abiens, je
crois, qui (e conferverent libres fous Cyrus & qui
fe fOlmúrent
¡\
Alexandre. C'eft un grand honneur
pour Alexanclre,ou peut·etre un reproche
a
leurfaire.
ABIGEAT,
f.
m.
mme
de
Droit Civil,
étoit le
crime d'un homme qui détournoit des befiiaux pour
les voler.
• ABIMALIC, f. m. langue des Africains Beri–
beres , Ol! naUlrels du pays.
ABISME
ou
ABYSME,
f.
m. pris généralement ,
fignifie quelc¡ue chofe de tres-profond ,
&
qui , pour
ainii dire , n'a point de fondo
Ce mot efi grec originairement dbur;crJ
f ;
il eft com–
pofé de la particule privative
<k
&
bucrcrJ~,
fond; c'eft–
a-dire fans fondoSuidas
&
d'autres lui donnent dif–
férentes origines: ils di(ent qu'ü vient de '"
&
de b¿", ,
couvrir, cacheT,
ou ele '"
&
de
J'~",
:
mais les plus judi–
cieux Critiques rejettenLcetteétymologie eomme ne
valantgueres mieux que celle d'lIn vieux Gloilateur,
qui fait venir
abyiJilS
ele
adipJits,a
caufeque I'eau vient
s'y rendre en abondance.
Abíme,
pris dans un (ens plus particulier, íignifie
un amas d'can fort ptofond.
Voye{
EAU.
Les Septame fe fervent particulierement ele ce
mot en ce fens , pour déíigner I'eau que Dieu créa an
commencement avec la terre; c'efi dans ce fens que
l'Ecriture dit que
les
témhm
étoientfur lafurfoce
&
l'
a–
byfme.
On fe fert aulIi du mot
abyjine
pour marquer le ré–
fervoir immenfe creuCé dans la tene, Oll Dieu ra–
malfa toutes ces eaux le troilieme jour: réfervoir que
ron
deíi~ne
dans nou'e Langue par le mot
mer,
&
quelc¡uefois dans les Livres faints par le
grandabyfme.
ABISME, (e dit dans l'Ecriture de l'enfer,
&
des
Iieux les plus profonds de la l11er,
&
du cahos qui
étoit couvert de ténebres au commencement du mon–
de,
&
fuI' lequel l'Efprit de Dieu étoit porté.
Geneft
1.2.
Les anClcns Hébreux, de meme que la plllpart
des Oriéntaux, encore
a
préfent, eroient que
I'ahyjim,
la mer, les eieux, environnoient tonte la terre; que la
terre étoit comme plongée
&
flotante fur
I'aóyjllle,
~
peu pres ,difent-ils, comme un melon d'eau nage (uI'
l'cau
&
dans l'eau , qui le couvre dans toute fa moi–
tié. Ils croient de plus, que la terre étoit fondée (ur
les eaux, OH elu moins qu'elle avoit (on fonelement
dansl'abyjine.
C'eft {ous ces eaux
\k
aH fond de cer
abyjine,
que l'Eeriture nOlls repréfeme les Géans qui
gémi{fent
&
qui (ouffrent la peme de leurs crimes;
c'eft-Ia Oll font relegués les Rephalms, ces
ancieg~
Géans, c¡ui de leur vivant faiíoient trembler les peu"
pies; enfin , 'eft dans ,es[ombres cachots que lespro.
D
















