
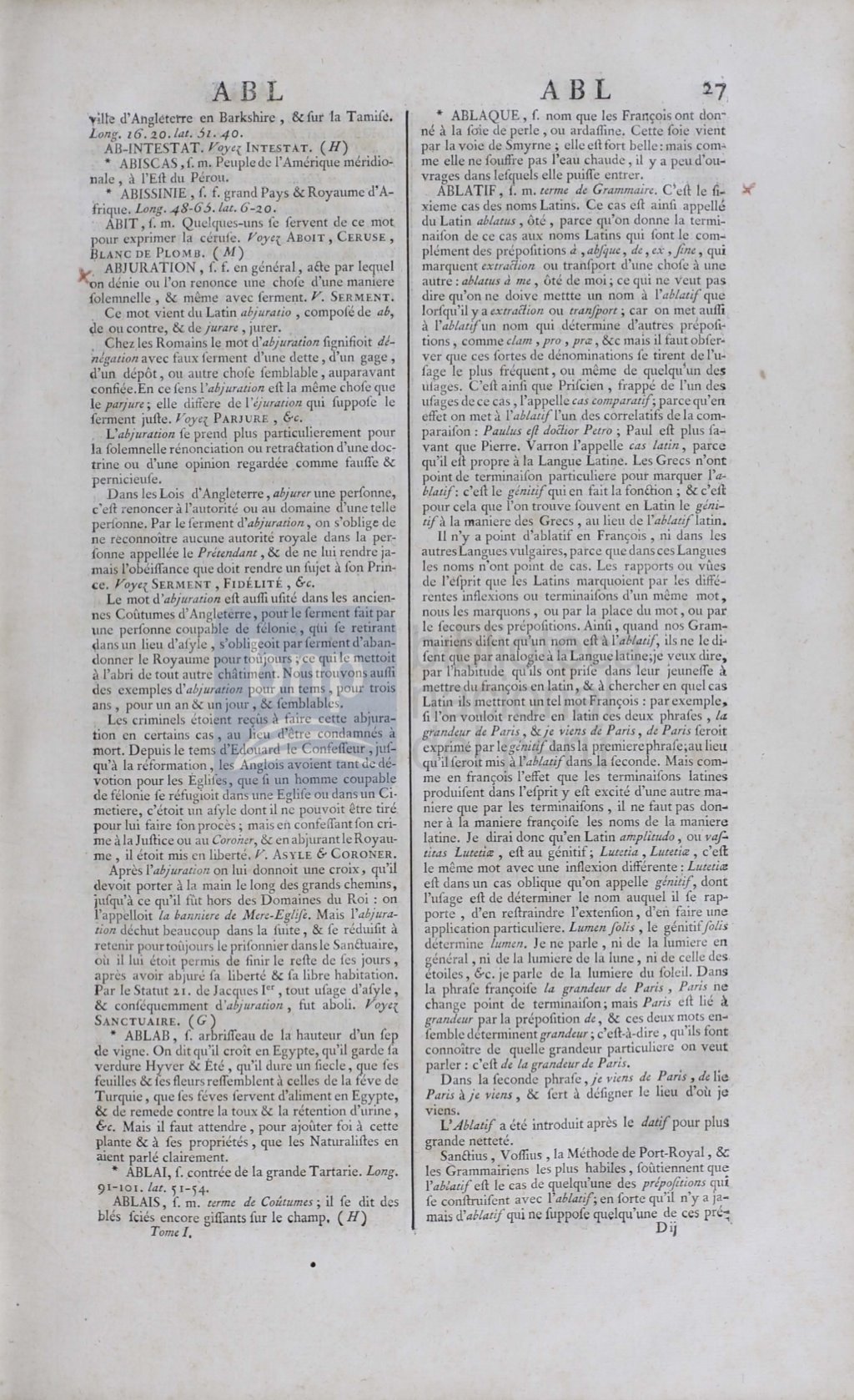
ABL
'Yil~
d'Angletctre en Barksrure, & fut la TamiJe.
Long. Z6.20.lat. J1.40.
AB-INTEST
AT.
Voye{
INTESTAT.
(H)
*
ABISCAS ,f. m. Peuplede l'Amérique méridio–
Dale,
a
l'Ea
du Péroll.
*
ABISSINIE, f. f. grand Pays & Royaume d'A–
frique.
Long. 48-6J.lat. 6-20.
ABIT,
t:
m. Quelques-uns fe fervent de ce mot
pour exprimer la céru{e.
f/oye{
ABOIT, CERUSE,
BLANC DE PLOMIl.
(M)
ABJURATION , f. f. en général, aé.l:e par lec¡uel
on dénie ou l'on renonce une chofe d'une maniere
folemnelle, & m&me avec fermento
V.
SERMENT.
Ce mot vient du Latin
abjuratio
,
compofé de
ab,
¡;le ou contre, & de
jurare,
jurel'.
. Chez les Romains le mOt d'
abjuration
fignifioit
d¿–
négation
avec faux ferment d'une dette, d'un gage,
d'un dépot, ou autre chofe femblable, auparavant
conliée.Encefens
l'abjuration
efr la meme chofe que
le
parjllre;
elle dilfere de
l'"juration
qui fuppofe le
ferment jufre.
Voye{
PARJURE,
&c.
L'abjuration
fe prene! plus particulierement pour
la folemnelle rénonciation ou retraé.l:ation d'un,e doc–
trine ou c!'une opillion regardée comme fauffe &
pernicieufe.
Dans les Lois d'Angleterre,
abjlmr
une perfonne,
c'efl: renoncer
a
l'autorité ou au domaine d'une telle
perfonne. Par le ferment
d'abjllration,
on s'oblige de
ne reconnoltre aucune autorite royale dans la per–
fonne appeIlée le
Pdtendant
,& de ne lui rendre ja–
mais l'obéiffance que doit rendre nn fujet 11 fon Prin–
ce.
Voye{
SERMENT , FIDÉLlTÉ ,
&c.
Le mot
d'abjuration
ea anffi ufité dans les ancien–
nes COlltumes d'Angleterre, pout le ferment fait par
une perfonne coupable de félonie, qhi fe retirant
dans un lieu d'afyle , s'obligeoit par ferment d'aban–
donner le Royaume pour toujours ; ce qui le mettoit
a
l'abri de tout autre chatiment. Nous trouvons auffi
des exemples
d'abjuration
pour un tems, pour trois
ans, pour un an & un jour , & femblables.
Les criminels étoient re<;us 11 faire cette abjura–
tion en certains cas, au lieu d'etre condamnés
a
mort. Depuis le tems c!'Edouard le Confeffeur ,jtÚ–
qu'l! la réformaríon, les Anglois avoient tant de dé–
vorion pour les Églifes, que fi un homme coupable
de félonie fe réfugioit dans une Eglife ou dans un Ci·
metiere, c'étoit un afyle dont
il
ne pouvoit &tre riré
pour luí faire fon proces ; maisen confe{[antfon cri–
me
a
la Iuilice ou au
Coroner,
& en abjurantleRoyau–
me ,
il
étoit rnis en liberté,
Yo
ASYLE & CORONER.
Apd!s
l'abjuratioll
on lui donnoit une croix, qu'i1
devoit porter a la main le long des grands chernins,
jlúqu'a ce qu'il fút hors des Domaines du Roi : on
l'appelloit
la bannim de Mere-Egl!fe.
Mais
l'abjura–
tion
déchut beaucoup dans la fllite,
&
fe réduifit
a
retenir pour tOiljOurSle prifonnier dans le Sané.l:uaire,
011
il lui étoit perrnis de linir le reae de fes jours,
apres avoir abjuré (a liberté & fa libre habitation.
Par le Statut
21.
de Jacqtles
le, ,
tout ufage d'afyle,
&
conféqtlemment
d'abjllration,
fut aboli.
Voye{
SANCTUAIRE.
(G)
*
ABLAB,
r.
arbriffeau de [a hauteur d'un fep
de vigne. On dit qtl:il crolt en Egypte, qu'il garde fa
verdure Hyver & Eté , qu'i[ dure un fieele, que fes
feuilles & fes fleurs re{[emblent
a
celles de la féve de
Turquie, qtle fes féves fervent d'aliment en Egypte,
&
de remede contre [a toux & la rétention d'mine ,
&c.
Maís
il
faut attendre, pour ajoltter foi
a
cette
plante &
a
fes propriétés, qtle les Nantralifres en
aíent parlé elairement.
*
ABLAl, f. contrée de la grande Tartarie.
Long.
9I-10l.lat,p-54·
ABLAlS,
f.
m.
tume de Coúlltmes;
il
fe dit des
blés fciés eneore giffants fur le champ.
(H)
Tome!.
ABL
*
ABLAQUE,
r.
nom que les Fran<;ois ont don–
né
a
la fO'ie de perle, ou ardailine. Cette foie vient
par la voie de Smyrne ; elle eafort belle: mais com.
me elle ne fouffre pas l'eau chaude,
il
ya peu d'ou–
vrages danslefqtlels elle puj{[e entrer.
ABLATIF, Cm.
terme de Grammaire.
C'ea le
u–
xieme cas des noms Latins. Ce cas efr ainft appellé
du Latin
ablams,
oté, parce qll'on donne la terrni–
naifon de ce cas am: noms Latins qtli font le com–
pl¿ment des prépo/itions
a
,alfquc, de, ex
,fine,
qtü
marquent
extraaion
OH t:ranfport d'une chofe a une
autre:
ablatus
a
me,
oté de moi; ce qUl ne veut pas
dire qtl'on ne doive mettte un nom
a
l'ablati¡
qtle
lorfqu'il y a
extrallion
ou
tranfPort;
car on met auffi
a
l'ablatifun
nom qui déterrnine d'autres prépo(¡–
tions, comme
clam
,
pro, prO!
,
&c mais il faut obfer–
ver qtle ces (ortes de dénominations fe tirent de l'u–
fage le plus fréquent, OH meme de qtlelqll\ll1 des
ufages, C'ea ainft que Prifcien , frappé de l'un des
ufages de ce cas, l'appelle
cas comparatif;
paree qtt'en
elfet on meta
l'ablatifl'UI1
des correlatifs de la com–
paraifon :
Palllus
ifl
doaLOr Petro
;
Paul
ea
plus fa–
vant que Pierre. Varron l'appelle
cas latin,
parce
qu'il eH propre
a
la Langue Latine. Les Grecs n'ont
point de ternlinauon particuliere pout marquer
l'
a–
blatif:
e'ea le
génitif
qttÍ en faít la fonfrion ; & c'
e.il:pour cela que l'on trouve fouvent en Latin le
géni–
tifa
la maniere des Grecs, au lieu de
l'ablatiflatín_
Il
n'y a point d'ablatif en Fran<;ois , ni dans les
autresLangues vulgaires, paree que danscesLangues
les noms n'ont point de caso Les rapports ou viles
de l'efprit que les Latins marqlloient par les
dilfé~
rentes inflex10ns ou terminaifons d'un meme mot>
nous les marquons, on par la place du mot, ou par
le fecoms des prépofitions. Ainfi, quand nos Gram–
mairiens difent qu'un nom ea a l'
ablatif,
ils ne le di..
fent
~ue
par analopie
a
laLangue latine;je veux dire,
par 1habinlde qtl
ils
ont prife dans lem jettneffe
a
mettre du fran<;ois en latín,
&
a
chercher en quel cas
Latin
ils
mettront un tel mot Fran<;ois : parexemple,
fi l'on vouloit rendre en latín ces deux phrafes ,
la;
grandellr de Paris, &je viens de Paris, de Paris
feroit
exprimé par
legénitif
dans la prernierephrafe;au liel!
qu'il ferOlt mis
a
l'
ablatif
dans la (econde. Mais
com~
me en fi'an<;ois l'elfet que les terminaifons latines
produiJent dans l'efprit y ea excité d'une autre ma–
niere que par les terminaifons,
il
ne faut pas don..
ner
a
la maniere fran<;oife les noms de la maniere
latine. Je dirai donc qtl'en Latin
amplitudo, ou·va.f–
titaS LutetlO!
,
ea au génitif;
Lumia, LutetiO!
,
c'ea
le meme mot avec une inflex10n dilférente :
LlltetilZ
ea dans un cas obliqtle qtt'on appelle
géniiif,
dont
l'ufage ea de déternúner [e nom aUC¡llel
il
fe
rap~
porte, d'en reHraindl'e l'extenfion, d'eñ faire une
application particllliere.
LUTllmJolis
,
le génitifJolis
détermjne
lumen.
Je ne parle, ni de la lumiere en
général , ni de la lumiere de la [une, ni de celle des
étoiles, &c. je parle de la lumiere du foleil. Dans
la phrafe fran<;oife
la grandeur de Paris, Paris
ne
change point de terminauon; mais
Paris ea
lié
a
grandear
):lar la prépofition
de,
& ces deux mots en–
femble
determinentgrandeur;
c'efr-a-dire, qtl'ils font
connoitre de quelle grandeur particuliere on veut
parler: c'ea
de la grandear de Paris.
Dans la feconde phrafe,
je viens de Paris, de
líe
Paris aje viem,
& fert 11 défigner le lieu d'Oll je
viens.
L'
Ablatif
a été introduit apres [e
datif
pour plus
grande netteté.
Sanfrius, Voffius ,la Méthode de Port-Royal,
&
les Grammairiens les plus habiles, foí'ttiennent que
l'ablatif
ea le cas de c¡ue[qll'une des
prépoJitions
qai
fe confl:ruifent avec
I'ablatif;
en forte qtl'il n'y a ja–
mais
d'ablatif
qtü ne [uppo[e
qllelqu'uneDd~
ces
pré~.
I}
















