
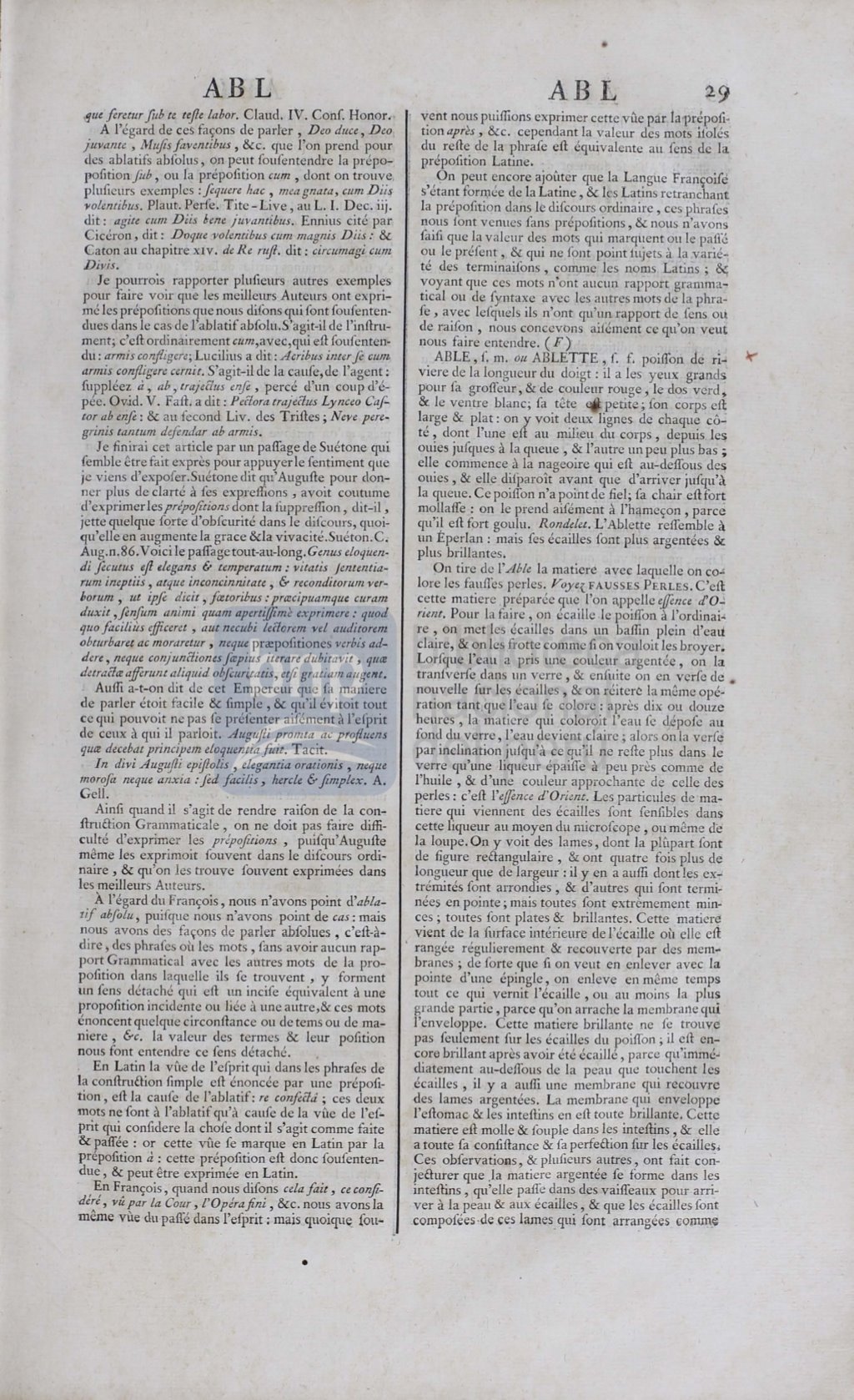
'ABL
.fJue firetur filb
te
tejle labor.
Claud. IV. Conf. Honor.
A l'égard de ceS
fa~ons
de parler ,
D eo duce, D eo
juyame, MujisfayentibIls,
&c. que l'on prend pour
des ablatifs abfolus, on peut foufentendre la prépo–
poíition
Ji,b,
ou la prépoíition
CIlm
,
dont on trouve
pluíieurs exemples
:feqllere hac, meagnata, cIlmDiis
'l'olentibus.
Plaun. Perfe. 1"ite - Live, au
L.
1.
Dec. iij.
dit:
agite cllm D iis Irene jIlyantibus.
Ennílls cité par
Cicéron, dit:
Doque lIolentibus CU1ll magnis D iis:
&
Caten au chapitre XIV.
deRe
mft.
dit:
cirellmagi cum
Diyis.
le poulTois rapporter pluíieurs autres exemples
pour faire voir que les meilleurs Auteurs ont expri–
mé les prépoíitions que nOlls difons c¡ui font foufenten–
dues dans le cas de l'ablatifabfolll.5'agit-il de l'infuu–
ment; c'eft ordinairement cUlll,avec,qui efr foufenten–
du:
armis conjligerB;
Lucilius a dit:
Acribus interfe Gllm
armis conjli¡;ere cemit.
S'agit-il de la callfe,de I'agent:
fu}'pléez
a,
ah,
trajeaIls enfe,
percé d'lIn coup d'é–
pee.
Ov.id.V. Faft. a dit:
Pefforatrajeaus Lynceo Caf–
tor ab enfe:
& au {econd Liv. des Trifres;
Nwe pere–
grillis tantum difendar ab armis.
J
e finirai cet article par un paífage de Suétone c¡ui
femble &tre fait expres pour appllyer le fentiment que
je viens d'e:¡.:pofer.Sllétolle di! qu'Augufte pour don–
ner plus de clarté
a
fes expreilions , avoit coutume
d'exprimerles
prépojitions
dont la fuppreflion, dit-il,
jette c¡uelc¡ue forte d'obfcurité dans le difcours, quoi–
qll'elle en augmellte la grace &la vivacité.Suéton.C.
Aug.ll.86.Voici le paífage tout-atl-Iong.
Genus eLoqueTl–
di jecutus
ejl
eLegans
(;.
temperatrtm: yitatis jentmtia–
rum ineptiis
,
atque inconcinnÍtate
,
&
reconditorum Yer–
borum, llt ipfe dicít , ffEtoribus
:
prlEcipuamque Cltram
duxit ,fenfum animi quam apertiffime exprimere
:
quod
'Juo fociLius efftcem
,
aut necubi teicorem veL auditorem
obturbaret ac moraretur, Ileq/U
prrepoíitiones
yerbis ad–
dere, ntque conjunaiollesflEpius iterare dubitayit
,
qIllE
delra(1lE afforunl aLiqlúd obfcuritatis, eifi gratiam augelfl.
Aufli a-t-on dit de cet Empereur c¡ue fa maniere
de parler étoit facile & íimple , & qu'il évitoit tout
ce qui pouvoit ne pas fe préfenter aifément a l'efprit
de ceux
a
qui il parloit.
AUgIlfli promla ac projluens
'lUlE decebat principem eL0'luentia fuit.
Tacit.
In diyi Augufti epiftoLis
,
elegancia orationis
,
ntq/le
moroJa neque anxia :fed fociLfs, herele
&
jimpLex.
A.
Gel!.
Aillíi c¡uand il s'agit de rendre raifon de la con–
ftruélion Grammaticale, on ne doit pas faire diffi–
culté d'exprimer les
prépojilions,
puiCc¡u'Augufre
meme les exprimoit fouvent dalls le difcours ordi–
naire, & c¡u'on les trouve fOllveot exprirnées dans
les meilleurs Auteurs.
A
I'égard du Franc;ois, nous n'avons point d'
abLa–
zif abJoLu,
puifque nous n'avons point de
cas:
mais
nous avons des [a\=ons de parler abfolues , c'eft-a–
dire, des phrafes
Ol!
les mots , fans avoir aucun rap–
port Grammatical avec les armes mots de la pro–
pofition dans laquelle ils fe trouvent , y forment
un (ens détaché quí efr un incife équivalent a une
propoíition incidente ou Iiée
a
une autre,& ces mots
énoncentquelque circonil:ance ou de terns OLl de ma–
niere,
&c.
la valeur des termes & leur poíitioo
nous font entendre ce fens détaché.
En Latin la ví'le de l'efprit 'luí dans les phrafes de
la confrruélion íimple eíl: énoncée par une prépoíi–
tion, eíl: la caufe de I'ablatif:
re confiad;
ces deux
mots ne font a l'ablatifc¡u'a cau{e de la ví'le de
I'e[..
prit qui coníidere la chofe dont il s'agit comme faite
& paífée : or cette ví'le fe marque en Latin par la
prepoíition
a
:
cette prépofition efr donc fou{enten–
due, & peut &tre exprimée en Latin.
En Fran<j:ois, quand nous di{ons
cela foit,
ce
co,yi–
déré, ylt par La COllr, L'Opérafini
,
&c. nous avonsla
meme Vlte du palle dans l'efprit ; mais
'lnojqu~
[On"
ABL
vent nous puiflions exprimer cette viie par laprépoíi•
tion
apr~s,
&c. cependant la valeur des mots Í10lés
dll refre de la plu'afe efr equivalente au fens de la
p'répoíition Latine.
On peut encore ajoí'lter que la Langue Fran¡¡:oife
!
~'étant
forl\lée de la Latine, & 1('5Latins retranchant
la prépoíition dansle di{cours ordinaire , ces phrafes
nous lont venues fans prepoíitions, & nous n'avons
faifi que la valeur des mots qui marquent ou le paífé
ou le préfent ,
&
c¡ui ne fom point Ílljets
a
la varié–
té des terminaifons, com.1lle les
J~oms
Latios ;
IX;
voyant c¡ue ces mots n'ont aucun rappon gramma–
tical ou de fyntaxe avec les atltres mots de la phra–
fe> avec le{quels ils n'ont qn'un rapport de fens ou
de rai{on, nous concevOns aiíement ce qu'on veut
nous faire entendre.
(F)
ABLE,
f.
m.
Ótt
ABLETTE ,
f.
f. poiífon de ri-
~
viere de la longuellr du doigt : il a les yeux grands
pour fa groifeur, & de couleur rouge , le dos verd;
&
le ventre blanc; fa t&te
peüte; fon corps eíl:
large & plat: on y voit deux lignes de chaque co-
té, dont I'une efr au milieu du corps , depuis les
otues jufques
a
la c¡ueue , & l'autre un peu plus bas ;
elle commence
a
la nageoire c¡ui efr au-deífous des
ouies,
&
elle diíparoit avant que d'arriver jufqu'a
la c¡ueue. Ce poiífon n'a point de fiel; fa chair eftfort
moUaífe : on le prend aifément
a
I'h'lme~on
, parce
Cju'il efr fort goulu.
ROllde/u.
L'Ableue reifemble
a
un Éperlan : mais fes écailles {ont plus argentées
&
plus brillantes.
On tire de
l'AbLe
la matiere avec lac¡uelle on co'"
lore les faulI"es perles.
Voye{
FAUSSES PERLES.
C'eíl:
cette matiere préparée 9'te I'on a.ppelle
efJence
cfO~
rient.
Pour la faire , on ecaille le poiífon
a
l'ordinai~
re , on met les écailles dans un baflin plein d'eati
c1aire, & on les frotte comme íi on vouloit les broyer.
Lorf'Iue l'eau a pris une conleur argentée, on la
tran{ve¡{e dans un verre , & enfuite on en verte de •
nouvelle fuI' les écailles , & on réiterC la m&me opé–
ration tant que I'eau fe colore: apres dix
Ol!
dome
heures, la maticre qtu coloroit l'eau {e dépofe au
fonel du verte, I'eau devient c1aire; alors ollla verfe
par inclinatíon jll/clu'a ce qll'il ne reil:e plus dans le
verre qu'une Iiqueur épaiífe
a
peu pres comme ele
l'huile , & d'une couleur approchantc ele celle eles
perles: c'efr
l'efJence d'Orient.
Les particllles de ma–
riere qui viennem eles écailles font fenfibles elans
cette Iic¡ueur au moyen du microfcope , ou meme de
la loupe. On y voit des lames, dont la plí'lpart {ont
de figure reélangulaire, & om qtlatre fois plus de
longueur que de largeur
¡
il Y en a aufli elont les ex-'
trérnités font alTondies ,
&
d'autres qui font termi–
nées en pointe ; mais toutes font e:Ktremement min–
ces; toutes {ont piates & brillantes. Cette matiere
vient de la furtace intérieure de l'écaille on elle efr
. rangée réglllierement & recouverte par des
mem~
branes ; de forte que íi on veut en enlever avec la
pointe d'une épingle, on enleve en m&me temps
tout ce qtU vernit l'écaille , ou au moins la plus
grande partie , parce qu'on arrache la membrane qui
l'enveloppe. Cette matiere brillante ne {e trouve
pas feulement ftu les écailles du poiífon ; il ell: en–
core
hl~llant
apres avoir été écaillé, parce c¡u'immé–
diatement all-eleifous de la peau que touchent les
écailles , il Y a auffi une membrane c¡ui recOuvre
des lames argentées. La membrane ql:i enveloppe
l'eftomac & les inteilins en efr toute brillante. Cette
matiere efr molle & {ouple dans les intefuns ,
&
elle
a toute fa coníifrance & fa perfeélion fur les écaillesd
Ces obfervations, & pluíieurs alltres, ont fait coll–
jeélurer que .la matiere argentée fe forme dans les
intefuns, qu'elle paífe dans des vaiifeaux pOllr arri–
ver
a
la peau & aux écailles , & c¡ue les écailles font
compofées.deces lames.qui {ont arrangées
Go¡nm~
















