
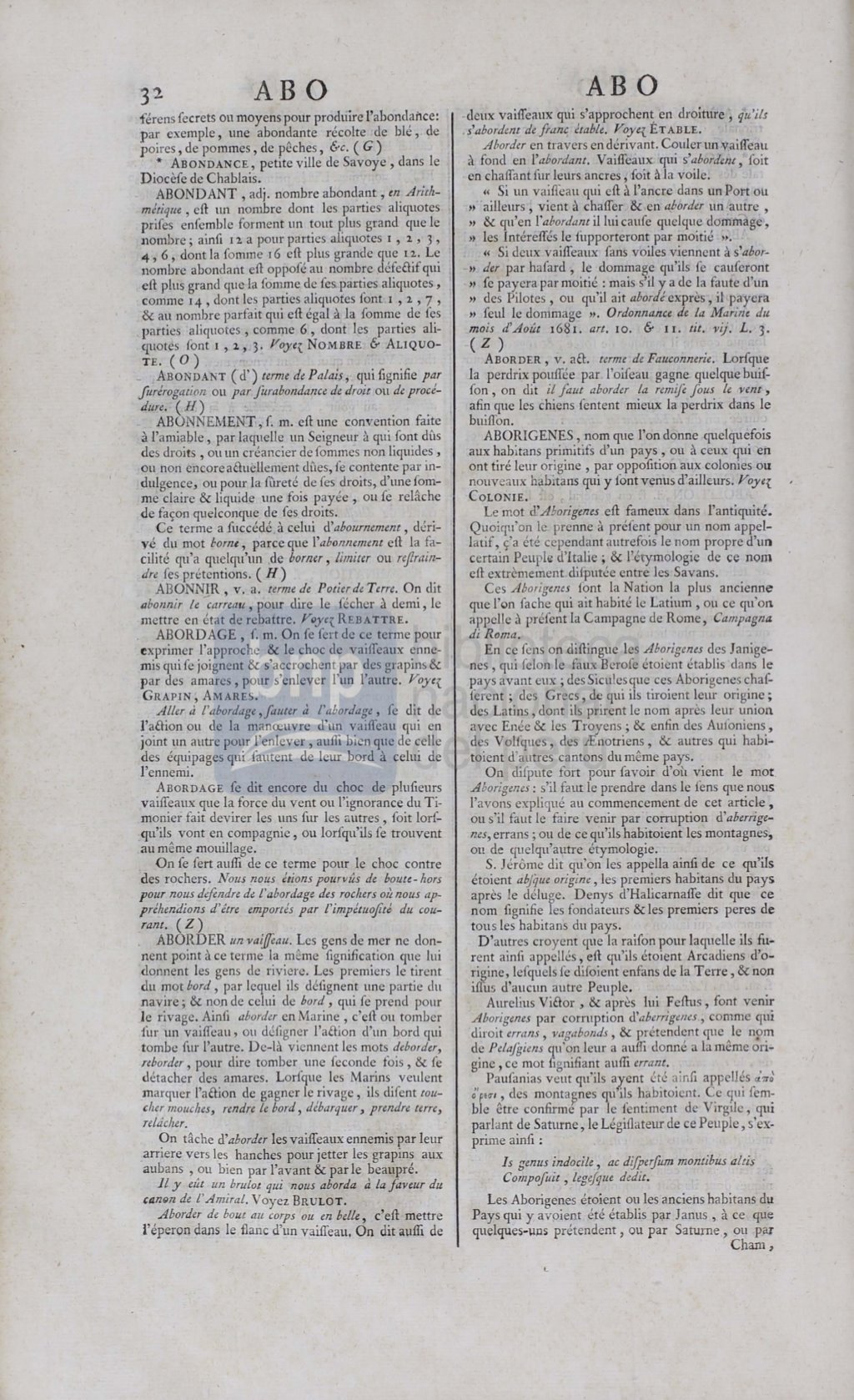
3
2
ABO
férens fecrets on moyenspour produire l'abondance:
par exemple, une abondante récolte de blé, de
poires, de pommes , de peches,
&c.
(
G )
*
ABONDANCE, petite ville de Savoye, dans le
DiocHe de Chablais.
ABONDANT , adj. nombre abondant,
en Arieh–
métique
,eíl: un nombre dont les parties aliquotes
prifes en(emble forment un tout plus grand que le
110mbre; ainú
12.
a pour parties aliquotes
1 , 2.,
3,
4, 6,
dont la (omme
16
eíl: plus grande que
12..
Le
nombre abondant eíl: oppofé au nombre défeB:if 'luí
eíl: plus grand que la [omme de fes parties aliquotes ,
comme
14 ,
dont les parties aliquotes (ont
1 , 2. ,
7 ,
&
au nombre parfait qui eíl: égal
a
la
{omme de fes
parties aliquotes, comme
6,
dont les parties ali–
quotes font
1 ,
2.,
3.
Voye{
NOMBRE
&
AUQuo–
TE.
(O)
ABONDANT ( d')
mme d, Palais,
<lui úgnifie
par
furérogatiolL
ou
par jitrabondance de droit
ou
de procé–
dure.
(H)
ABONNEMENT,
f.
m. eíl: une convention faite
a
l'amiable, par laquelle un Seigneur
a
qui (ont dCIS
des d.roits , ou un créancier de (ommes non liquides,
ou non encoreaB:udlement dCles, (e contente par in–
dulgence, ou pour la (w'eté de (es droits, d'une (om–
me claire
&
liquide une fois payée , ou (e relll.che
de fac;on quelconque de (es droits.
Ce terme a {uccédé
a
celui
d'abournement,
déri–
vé
du mot
borne,
paree que
l'abonnement
eíl: la fa–
cilité qu'a quelqu'un de
borner, limiter
ou
rejfrain–
dre
(es prétentions.
(H)
A130NNIR,
v. a.
terme de PotiudeTerre.
On clit
I1bonnir le carreaf¿,
pour dire le (écher
a
demi, le
mertre en état de rebattre.
Y"ye{
REDATTRE.
ABORDAGE , (. m. On (e fert de ce terme pour
exprirner l'approche & le choc de vaiífeaux enne–
mis qui (e joignent & s'accrochent par des grapins &
par des amares, pour s'enlever I'un l'autre.
Yoye{
GRAPIN, AMARES.
Alter
ti
l'abordage ,fauter
a
l'abordage,
fe dit de
l'attion ou de la manceuvre d'un vaiífeau qui en
joint un autre pOllr l'enlever , auffi bien que de celle
des équipages qui fautent de leur bord
a
celui de
l'ennemi.
ABORDAGE fe dit encore
dll
choc de plufieurs
vaiífeaux que la force du vent ou l'ignorance du T i–
monier fait devirer les uns (ur les autres , foit lorf–
Cjll'ils vont en compagnie, ou lorfqu'ils fe trouvent
au meme mOlúllage.
On (e fert auffi de ce terme pour le choc contre
des rochers.
Nous nous bions pourvús de boute- hors
pour nous dqendre d, l'abordage des rochers ounous ap–
préhendions d'ecre emportés par l'impétuojité du cou–
rant.
(Z)
ABORDER
un vaij[eau.
Les gens de mer ne don–
nent point
a
ce terme la meme úgnification que lui
donnent les gens de riviere. Les premiers le tirent
du mot
bord
,
par lequel ils déúgnent une partie du
navire; & nO)1 de celui de
bord,
qui {e prend pour
le rivage. Ainú
aborder
en Marine, c'eíl: ou tomber
Úlr un vaiífeau, ou déúgner l'aB:ion d'un bord qui
tombe
(m
l'autre. De-la vierLllent les mots
deborder,
reborder,
pour dire tomber une feconde fois,
&
fe
détacher des amares. Lorfque les Marins veulent
marquer l'aB:ion de gagner le rivage,
ils
di(ent
tou–
eher 1/louches, rendre le bord, débarquer, prendre terre,
relácher.
On
t~che
d'
aborda
les vaiífeaux ennemis par leur
arriere vers les hanches pour jetter les grapins aux
aubans , ou bien par I'avant & par le beaupré.
11
y
eút un brutol qui nous aborda
a
la faveur du
camm de l'Amiral.
Voyez BRULOT.
Aborder de boue all corps ou en belle,
c'eíl: mettre
l'éperon dans le flanc d'lIn vaiífeau, On dit auffi de
ABO
-deux vaiífeaux qui s'approchent en droítme,
'llt'ils
.s'abordent de /rane tltable.
Yoye{
ÉTABLE.
Aborder
en travers endérivant. Colllenm vaiífeau
a
fond en l'
abordant.
Vaiífeaux qui s'
abordmt,
(oit
en cha{[antfur leurs ancres , {oit
a
la voile.
" Si un vai{[eau qui eíl:
a
l'ancre dans un Port olt
)) ailleurs, vient
a
chaífer & .en
aborder
un autre ,
" &
qu'en
I'abordant
illui cauCe quelque dO'mmage,
>1
les Intéreífés le iupporteront par moitié ".
" Si deux vaiífeaux (ans voiles viennent
a
s'abor–
))
der
par ha(ard, le domrna!?e qu'ils (e cau{eront
" fe payera par moitié : mais s il y a de la faute d'un
" des Pilotes, ou qu'il ait
abord.fexpres,
il payera
11
feul le dommage
11.
Ordonnance de la Marine du
mois d'Aoút
1681.
arto
10.
&
11.
tit. lIij. L. 3.
(Z )
ABORDER,
V.
att.
terme deFauconnerie.
Lor{que
la perdrix pouífée par l'olleau gagne quelque bllif–
fon , on dit
il faut aborder la remife fous le vent,
afin que les chiens (entent mieux la perdrix dans le
buiflon.
ABORIGENES, nom que ['on donne quelquefois
aux habitans primirifs d'un pays , ou
a
ceux qui en
ont tiré leur origine, par oppofition aux colonies ou
nouveaux habitans qui y lont venus d'ailleurs.
Voye{
(OLONIE.
Le mot
d'Aborigenes
eíl: fameux dans l'antiquité.
Quoiqu'on le prenne
a
pré(ent pour un nom appel–
latif,
~'a
été cependant autrefois le nom propre d'un
certain
Peupl~
d'ftalie ; & l'étymologie de ce nom
eíl: extremement difputée entre les Savans.
Ces
Aborigenes
lont la Nation la plus ancienne
que l'on (ache qui ait habité le Latiurn ,on ce qu'on
appelle
a
pré{ent la Campagne de Rome,
Campagna
di Roma.
En ce (ens on diíl:ingue les
Aborigenes
des Janige–
nes, qui (elon le faux Bero(e étoient établis dans le
pays avant eux ; des Siculesque ces Aborigenes chaf–
lerent ; des Grecs, de qui ils tiroient leur origine;
des Latins, dont ils prirent le nom apres leur union
avec Enée
&
les Troyens ; & enfin des AuJoniens ,
des Volfques, des JEnotriens,
&
autres qui habi–
toient d'alltres cantons du meme pays.
On difpute fort pour favoir d'oi! vient le mot
Aborigenes:
s'il fam le prendre dans le lens que nous
I'avons expliqué au commencement de cet article,
on s'il faut le faire venir par corruption d'
aberrige–
nes,
errans ; ou de ce qll'ils habitoient les montagnes,
on de qllelqll'autre étymologie.
S. Jérome dit qu'on les appella ainú de ce qu'ils
étoient
aiji¡ue origine,
les premiers habitans du pays
apres le déluge. Denys d'Halicarnaífe dit que ce
nom úgnifie les fondateurs &Ies premiers peres de
tous les habitans du pays.
D'alltres cl'oyent que la rallon pour laquelle ils fu–
rent ainú appellés, eíl: qu'ils étoient Arcadiens d'o–
rigine, le{quels (e di{oient enfans de la Terre, & non
iífus d'auclIn autre Peuple.
Aurelius ViB:or , & apres lui Fefhls , font venir
Aborigenes
par corruption
d'aberrigmes,
comme qui
diroit
errans
,
vagabonds,
& prétendent que le npm
de
PelaJgiens
qu'on lem a auffi donné
a
la meme ori–
gine , ce mot úgnifiant auffi
errant.
Pau(anias veut qu'ils ayent 'té ainfi appelJés
d71~
~'P'ITI
,
des montapnes qu'ils habitoicnt. Ce qui [em–
ble etre confirme par le lentiment de Virgile, qui
parlant de SaulTne, le Légi/latem de ce Peuple, s'ex–
prime ainú ;
1s genus indoeile, ac diJPerfum montibus aitis
Compof/lit
,
legifque d,dit.
Les Aborigenes étoient oules anciens habitans du
Pays qui yavoient été établis par Janus ,
a
ce que
C{uelques-ups prétendent, 01.1 par Saturne, ou par
Charn ,
















