
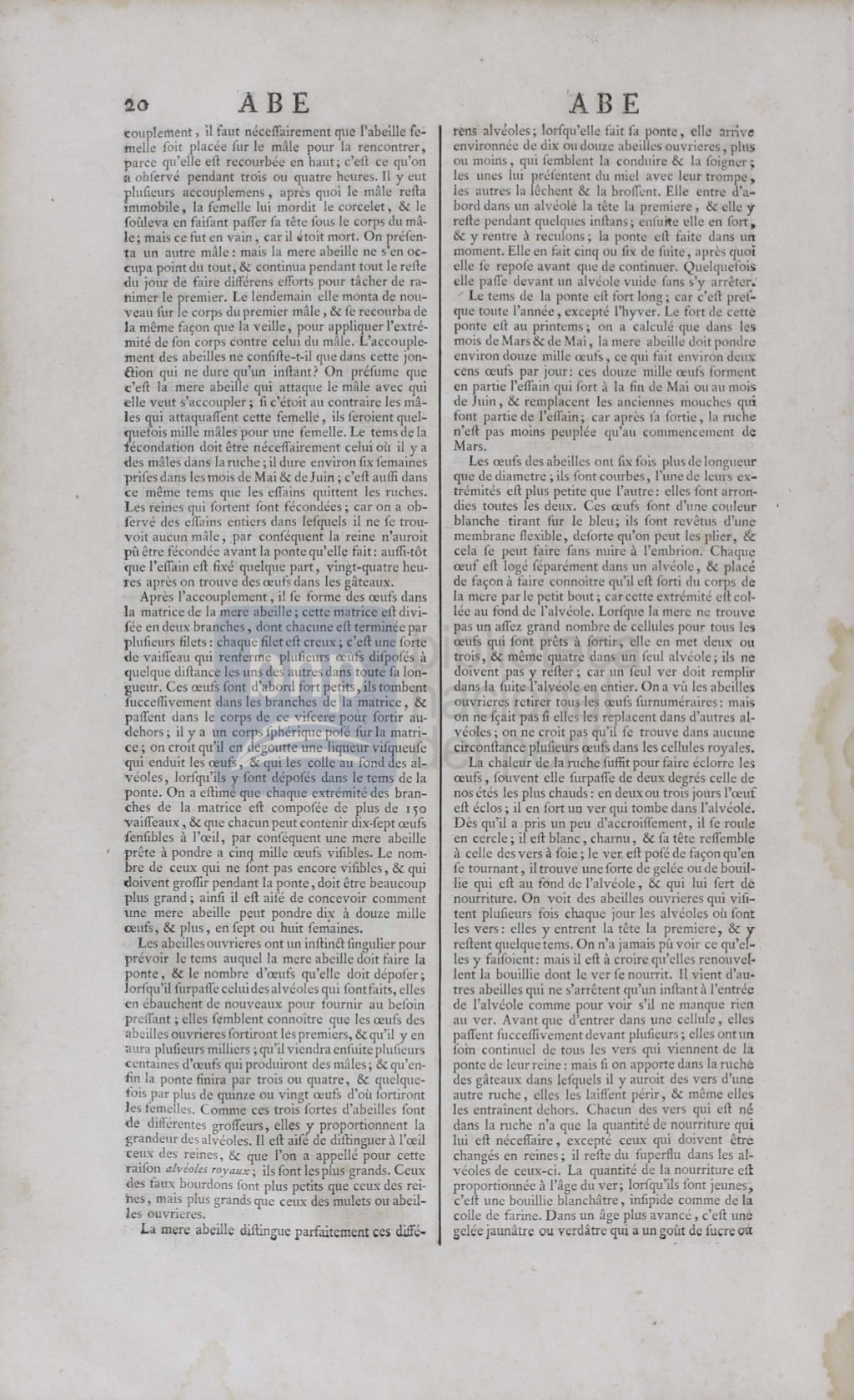
couplement, i1 taut néce/rairement que 1'abeille te–
melle foit placée fm le mate pour la rencontrer,
paree qu'elle eíl recourbée en haut; c'eíl ce qu'on
a obfervé pendant trois ou quatre heures. Il y eut
plu/ieurs accouplemens, apres quoi le
m~le
refia
lmmobile, la femelle lui mordit le corcelet,
&
le
fouleva en fauant paifer fa t&te fous le corps du
m~le; mais ce fut en vain, car il ¡¡toit mort. On préfen–
"fa un autre mate; mais la mere abeille ne s'en oc–
cupa point du tout,
&
continua pendant tout le reíle
¿u jour de faire dilférens efforts pour dkher de ra–
nimer le premier. Le lendemain elle monta de nou–
veau fm le corps du premier male,
&
fe recourba de
la m&me
fa~on
que la veille, pour appliquer l'e;\.'tré–
mité de fon corps contre celui du male. L'accouple–
ment des abeilles ne confúl:e-t-il c¡ue dans cene jon–
<líon qui ne dure qu\m inílant? On préfume c¡ue
<:'e!l: la mere abeiIle qlli artaque le m&le avec c¡ui
elle veut s'accoupler; /i c'étoit au contraire les ma–
les 'lui attaquaifent certe femelle, ils feroient quel–
quefois milIe males pour une femelle. Le tems de la
fécondation doit &tre nécefi"¡úrement celui olt il ya
¿es males dans la ruche; il dure environ íix femaines
prifes dans les mois de Mai
&
de hún; c'eíl auffi dans
ce meme tems que les eifains qlúrtent les ruches.
Les reines c¡ui fortent font fécondées; car on a ob–
fervé des eifains entiers dans lefquels il ne fe tron–
voit aUCltn mMe, ,par conféquent la reine n'amoit
pfletre fécondée avant la ponte qu'elle fait; auili-tot
<[ue l'eifain efi fixé quelque part, vingt-quatre heu–
res apres on trouve des reufs dans les gateaux.
Apres l'accouplement, il fe forme des reufs dans
la matrice de' la mere abeille; certe matrice e!l: divi–
fée en deux branches, dont chacune eíl terminée par
pluíieurs filets ; chaque filet c!l: creux; c'efi une forte
de vaiifeau qtú renferme pll1/ieurs reufs difpofés
a
ql1elque di!l:ance les lms des autres dans toute fa lon–
glleur. Ces reufs font d'abord fort petits, ils tombent
Úlcceffivement dans les branches de la matrice,
&
paifent dans le corps de ce vucere pour forrir au–
dehors; il
Y
a un corps fphériqtle pofé
[¡n'
la matri–
ce; on crolt qu'il en degoutte une liqueur vifql.leufc
<[ui endlút les renfs,
&
qui les colle au fond des al–
véoles, lorfqtl'ils y font dépofés dans le tems de la
ponte. On a efiimé qtle
chaql.leextrémité des bran–
ches de la matrice eíl compofée de plus de
150
vaiifeaux,
&
que chacun peut contenir dix-fept reufs
fen/ibles
a
l'reil, par conféquent une mere abeille
·prete
a
pondre a cinq mille reufs vi/ibles. Le nom–
bre de ceux qui ne font pas encore viftbles,
&
qlÚ
rloivent groffir pendant la ponte, doit etre beaucoup
plus grand; ainíi il eíl aué de concevoir comment
une mere abeille peut pondre
CÜ?'
a
douze mille
ceufs,
&
plus, en fept ou huit femaines.
Les abeillesouvrieres ont un in!l:iné.l: fmgulier pour
prévoir le tems auquel la mere abeilIe doit faire la
ponte,
&
le nombre d'reufs qu'elle doit dépofer;
lor{qu'il (urpalI'e celuidesalvéoles qui fontfaits, elles
en ébauchent de nouvealL'( pour foumir au befoin
preifant ; elles
f~mblent
connoltre qtle les oeufs des
abeilles ouvrieres (ortiront lespremiers,
&
qtl'il Yen
aura pluíieurs milliers ; qtl'il viendra enflúte plu/ieurs
centaines d'reufs C
(l.liproduiront des maJes;
&
qu'en–
nn la ponte finira par trois OH qtlatre,
&
C(uelqtle–
fois par plus de qtúnze ou vingt reufs d'o\¡ /orriront
les femelles. COntn1e ces trois fortes d'abeilles font
de dilférentes gro/[eurs, elles
I
proporrionnent la
grandeur desalvéoles. Il eíl aife de dillinguera l'reil
ce~Lx
des
~eines ,
&
qtle I'on a appeUé pour cette
rauon
aLveoLts royaux;
i1s (ont les plus grands. Ceux
des faux, bourdons [ont plus petits que ceux des rei–
nes, mals plus grands que ceux des mulets ou abeil–
les onvri res.
La
mere abeille dillingue pa¡faitement ces
diffé-
ABE
rens alvéoles; lorfqtl'elle fait fa ponte, ell\!
an~ve
environnée de dix ou douze abeillcs ouvrieres , p!tlS
ou moins,
qui
femblent la conduire
&
la foigner;
les unes lui pré{entent du miel avec leur trompe
~
les autres la H!chent
&
la brolI'ent. Elle entre d'a–
bord dans un alvéole la tete la premiel'e,
&
elle
y
reíle pendant quelqlles infians; enfuite elle en fort.
&
Yrentre
a
reculons; la ponte eíl faite dans un
momento Elle en fait cinc¡ ou fLX de (uite, apres C(uoi
elle fe repo(e avanr qtle de continuer. Quelqucfois
elle palI'e devant un alvéole Vlúde fans s'y arn!ter.'
;' Le tems de la ponte e!l: fort long; car
c'ea
preC.
qtle route l'année, excepté I'hyver. Le fort de cerre
ponte eíl an printems; on a calculé que dans les
1l10is de Mars
&
de Mai, la mere abeille doit pondre
environ douze mille a::ufs, ce qui fait environ deux
cens reufs par jour; ces dome mille reufs forment
en partie I'e/fain qui fort
a
la fin de Mai ou au mois
de Jtún,
&
remplacent les ancienncs mouches qui
font partie de l'elI'ain; car apres fa {ortie, la ruche
n'eíl pas moins peuplée qtl'au commcncement de
Mars.
Les reufs des abeilles ont (¡x fois plus de longlleur
que de diametre ; ils font courbes, I'une de leurs ex–
trémités eíl plus petite qtle l'autre; elles font arron–
dies tontes les deux. Ces reufs (ont d'une couleur
blanche tirant fur
le
bleu; ils (ont revetus d'une
mcmbrane flexible, deforte qu'on peut les plicr, IX
cela {e peut faire fans nllire
a
l'embrion. Chaqtle
ceuf eíllogé (éparément dans un alvéole,
&
placé
de
fa~on
11 faire connoitre qu'il efi {orri du corps de
la mere par le petit bout; car cette extrémité e!l: col–
lée au fond de I'alvéole. L01{que la mere ne trouve
pas un aifez grand nombre de cellules pour tous les
reufs qttÍ font prets
a
{ortir, elle en met deux on
trois,
&
meme quatre dans un feul alvéole; ils ne
doivent pas y refrer; car un (euI ver doit remplir
dans la fuite l'alvéole en entier. On a
vCi.
les abeilles
ouvricres retirer tous les reufs {urnuméraires; mais
on ne
f~ait
pas (¡ elles les replacent dans d'autres al–
véoles; on ne croit pas qtl'il {e trouve dans aucune
circon!l:ance plu/ieurs reufs dans les cellules royales.
La chaleur de la ruche fuffit pour faire éclorre les
reufs, fouvent elle (urpa{fe de deux degrés celle de
nos étés les plus chauds; en deuxou trois joursl'reuf
e!l: édos; il en {ort un ver qui tombe dans I'alvéole.
Des qu'il a pris un peu d'accroifiement, il fe roule
en cercle; il e!l: blanc , charnu,
&
{a tete re/femble
a
celle des vers
a
foie; le ver e!l: po(é de fas:on qu'en
fe tournant, il trouve une {orte de gelée ou de bouil–
lie qtlÍ .eíl au fond de l'alvéole,
&
qtlÍ lui fert de
nomriture. On voit des abeilles ollvrieres qlú viíi–
tent plu/ieurs fois e/laque jour les alvéoles oll font
les vers; elles y entrent la tete la premiere,
&
l
reílent quelque tems. On n'a jamais po. voir ce qu'e -
les y faifoient; mais il efi
a
croire qu'elles renouveI·
lent la bOlúllie dont le ver fe nourrit.
11
vient d'au–
tres abeilIes qui ne s'arretent qu'un in!l:ant
a
l'entrée
de l'alvéole comme pour voir s'il ne manqtle rien
au ver. Avant que d'entrer dans une cellule, elles
paifent fucceilivement devant pluíieurs; elles ontun
fom continuel de tous les vers qttÍ viennent de la
ponte de leurreine; mais
{¡
on apporte dans la ruche
des gateaux dans le(qtlels il yauroit des vers d'ttne
autre ruche, elles les lailI'ent périr,
&
meme elles
les entralnent dehors. Chacun des vers qui eíl
Dé
dans la ruche n'a que la quantité de nourriture
c¡ui
lui eíl néce/faire, excepté ceux c¡ui doivent etre
changés en reines; il reíle du {uperflu dans lcs al–
véoles de ceux-ci. La quantité de la nOllrriture eíl
proportiollnée
a
l'age du ver; lorfqu'ils font jeunes,
c'efi une bouiUie blanchatre, infipide comme de la
colle de farine. D ans un age plus avancé , c'eíl une
gelée jaunatre ou verdatre quí a nn gOilt de fuere
oa
















