
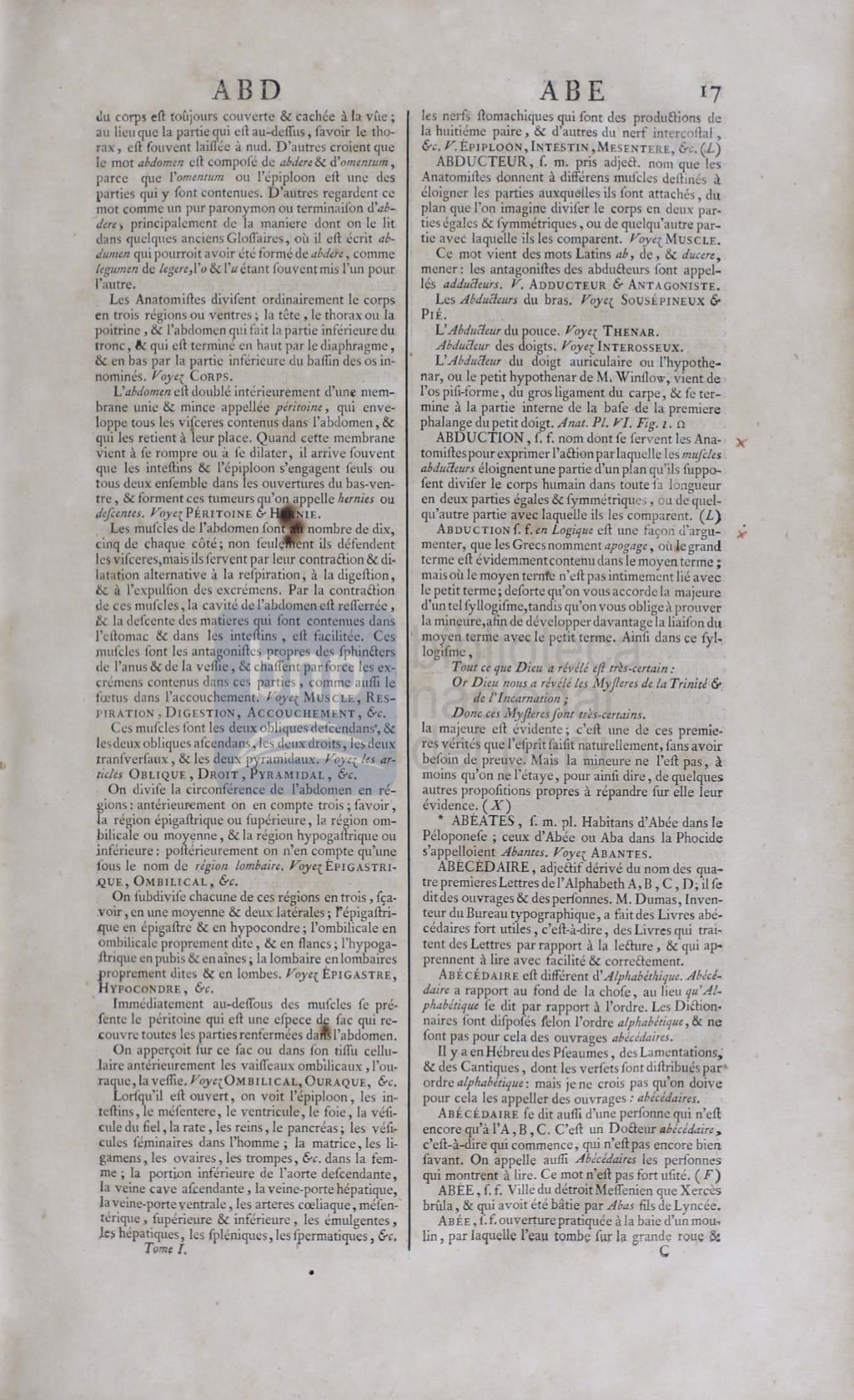
ABD
ou
corps eO: tolljours couverte
&
caehée
a
la vlle ;
au lieu que la partie qui eO: au-deífus, favoir le 1ho–
rax, eO: fouvent
lai1f~e
a
nudo D'aurres croient que
le mot
abdomm
eO: compofé de
tÚJdert& d'ommtum,
parce que
l'ommmm
ou I'épiploon eO: une des
parties qui y font contenues. D'aurres regardent ce
mot comme un pur paronyrnon ou terminaifon
d'ab–
dere,
prineipalement de la maniere dont on le lit
daos quelques aneicns Clollaires, Oll il cO: éerit
ab–
Jumen
qui pourroit avoir été formé de
abdtrt
,
eomme
''{pullen
de
Legue,l'o
&
l'u
étant fouventmis l'un pO\1r
¡'autre.
Les Anatomiíl:es divifent ordioairement le eorps
en trois régioos ou ventres; la tete, le thorax ou la
poitrine,
&
l'abdomen 9lti fait la partie irtférieure du
trone,
&
qui eO: termine en haut par le diaphragme,
&
en bas par la partic inférieure du baffin des os in–
nominés.
Vo)'e{
CORPS.
L'
abdomm
cíl: doublé intériemement d'une mem–
brane unie
&
mince appeUée
p/ritoine,
qui enve–
loppe tous les vifceres contenus dans l'abdomen,
&
qui les retient
a
leltr place. Quand cette membrane
vient
a
fe rompre ou
a
fe dilater, il arrive fouvent
que les inteíl:ins
&
I'épiploon s'engagent fenls ou
tous deux enfemble dans les ouverrures du bas-ven–
tre,
&
forment ees ntmeurs qu'on appelle
lurnies
ou
difcentes. Voyt{
PÉRITOINE
&
NIE.
Les mufcles de I'abdomen fon
nombre de dix,
cinq de chaque coté; non feul<; ent ils défendent
les vifceres,mais ils fervent par lem contraéEon
&
di–
latation alternative a la refpiration,
a
la digeíl:ion,
&
a l'expul/ion des excrémens. Par la contraaion
de ces mufcles, la caviré de I'abdomen eíl: reíferrée,
&
la defcente des marieres qui font contenues dans
l'cO:ol11ac
&
dans les inteíl:ins , eíl: facilitée. Ces
mufcles lont les antagoniO:cs propres des fphinaers
de l'anus
&
de la veflie,
&
chaífent par force les ex–
crémens contenus dans ces parties, cOl11l11e aufIi le
fcetus dans l'accouchel11ent.
Vo)'t{
MUSCLE, RES–
PIRATION , DIGESTION, ACCOUCHEMENT,
&e.
es mufcles font les deux obliql.les defeendans·,
&
le deux obliql.les afcendans, les dcux droits, les deux
tranfverfaux,
&
les deux pyramidaux.
Vo)'e{ Les ar–
(le/es
OnLlQuE, DROIT, PYRAMIDAL,
&e.
On divife la circonférence de I'abdomen en ré–
gions : antérieurcl11ent on en compte trois; favoir ,
la région épigafuíque ou fupérieure, la région om–
bilicale ou
moy~nne,
&
la région hypogaílrique ou
inférieure: poHérieurel11ent on n'en compte qu'une
10us
le nom de
rigiOl1 lombaire.
Voyt{ÉPIGASTRI–
.QUE, OMnlLICAL,
&¡;.
On fubdivifc chacune de ces régions en troís,
f~a
voir, en une moyenne
&
deux latérales; t'épiga/l:ri–
que en epiga/l:re
&
en hypocondre; l'ombilicale en
ombilicale proprement dite,
&
en f1ancs; I'hypoga–
fuique en pubis
&
enalnes; la lombaire en lombaires
proprement dites
&
en lombes.
Vo)'e{
ÉPIGASTRE,
Hypoco 'ORE,
&~.
Immédiatement au-deífous d s mufcles fe pré–
fente le péritoine
qui
eíl: une efpece de fac qui re–
couvre tolltes les paTries renfermées da I'abdomen.
On
apper~oit
(ur ce fac ou dans fon tiífu ceUu–
Jaire antérieurement les vaUfeaux omblJicaux, I'ou–
ra<j11e, la veffie.
Yoye\.
OMn
1
LI CAL, OURAQUE,
&e.
Lor/qu'il eO: ouvert, on voit l'épiploon, les in–
teHins, le méfentere, le venrricule, le foie, la véft–
cltle du
fiel,
la rate , les reins , le pancréas; les véf¡..
cules féminaires dans I'homme; la matrice, les li–
gamens, les ovaires, les trompes,
&c.
dans la fem–
me ; la portian irtférieure de I'aorte defcendante,
la veine cave a[cendante, la veine-porte hépauque,
la veine-porteventral , les arteres creliaque, méfen–
tcri<j11e, lupérieure
&
inférieure, les émulgentes ,
.l.e~
hépatiques, les fpléruqu s, les Jpermatiques
,&c.
Tome l.
ABE
les nerfs fl:omachiques qui font des produilion de
la huitié01e paire,
&
d'autres du nerf intt:rv)lral ,
&c.
V.ÉPIPLOON,I 'TESTIN ,MESENTERE,
&•.
eL)
ABDUCTEUR, f. m. pris adjetl:. nom que les
Anatomiíl:es donnent
a
différens mufcles deíbn s
a
éloigner les paTries alLx<j11eile ils font attachés, du
plan que l'on imagine divifer le corps en delLx par–
ties égales
&
fymmétriques , ou de quelqu'autre par–
tie avec la<j1leUe ils les comparent.
Voye{
MUSCLE.
Ce mot vient des mots Latíns
ab,
de,
&
duea"
mener: les antagonilles des abduaeurs font appel–
lés
adduéleurs.
V.
ADDUCTEUR
&
ANTAGONISTE.
Les
Abduélmrs
dll bras.
Vo)'e{
SOUSÉPINEUX
6-
PIÉ.
L'Ahduéleur
du pouce.
Voyt{
THENAR.
Abduéleur
des doigts.
Voye{
INTERossEux.
L'Abduéleur
du doigt auriculaire ou I'hypothe-
nar, ou le petit hypothenar de M. \Vin/low, vient de
I'os pi/i-forme, du gros ligament du carpe,
&
fe ter–
mine
a
la partie interne de la bafe de la premiere
phalange du petitdoigt.
Allal.
PL. l/l.
Fig.1.
n
ABDUCTION,
f.
f. nom dont fe fervent les Ana–
tomi/l:espour exprimer l'ailion par lac¡uelle les
mlifcüs
abduéleurs
éloignentune partie d'un plan qu'ils fuppo–
fent divifer le corps humain daos tonte fa 10ngueuT
en deux parties égales
&
fymmétrique) , ou de C¡llel–
qu'autre partie avec laqueUe ils les comparent.
eL)
AnDUCTION f.
f.
en Logique
el!: une
fa~on
u'argu–
menter, que les
Crecs
nomment
apogage,
ol,legrand
terme el!: évidemmentcontenudans le moyen terme;
mais
011
le moyen ternfe n'eO: pas intimement lié avec
le petit terme; deforte qu'on vous accorde la majeure
d'un tel fyllogifme,tandis qu'on vous oblige
¡\
prouver
la mineure,afin de développerdavantage la liaUon dl!
moyen terme avec le petit terme, Ain/i dans ce fyl•.
logifme,
Tout
ce
que Dieu a
révélé
11
tr~s-eertain:
Or Dieu nOltS
a rév/¡¿
tes M)'jieres dt La Trinité
&,
de t'Ineamation;
DOlle ees Myjitres
10m
tres-etrlains.
la majeure eO: evidente; c'eft une de ces premie.
res vérités <j1le I'efpritfailit nanlrellement, fans avoir
befoin de preuve. Mais la mineure ne l'eíl: pas,
a
moins qu'on ne I'étaye, pour ain/i dire, de <j11elques
autres propo/itions propres
a
répandre fltr elle ¡eur
évidence.
e
X)
.. ABÉATES,
f.
m. pI. Habitans d'Abée dans le
Péloponefe ; cellX d'Abée ou Aba dans la Phocide
s'appe!loient
Aba/ltes. Yoye{
A13ANTES.
ABECÉDAIRE, adjeilif dérivé du nom des qua–
tre premieresLettres del'A1phabeth A, B, C, D; il fe
dit des ouvrages
&
des perfonoes. M. Dumas, Inven–
teur du BltreaU typographique, a fait des Livres abé·
cédaires fort utiles, c'eíl:-a-clire, des Livres <¡tti trai·
tent des Lettres par rapport a la leaure,
&
quí ap–
prennent
a
lire avec facilité
&
corrcaement.
AnÉ CÉDAIRE eíl: différent d'
ALpltabithiqut. AbJcé.
daire
a rapport au fond de la chofe, au ¡ieu
qu'Al–
phabétique
fe dit par rapport
a
I'ordre. Les Diaion.
naires font difpofés Celon I'ordre
alphabétique,
&
ne
font pas pour cela des ouvrages
tÚJéeédaires.
II ya enHébreu des Pfeaumes, desLamentations;
&
des Cantiques, dont les verfets font difiribués par
ordre
aLphtÚJétique:
mais je ne erois pas <j11'on doive
pour cela les appeUer des ouvrages :
abécédaires.
AnÉcÉDAIRE fe dit auffi d'une perfonne
~
l.Iin'eí!:
encore qu'a l'A, B , C. C'eO: un D oaeur
abecédaire:–
c'eíl:-a-dire <j1ti commence,
qui
n'eO: pas encore bien
favant. On appelle auf1i
Ab¿eédaim
les perfonnes
qui montrent
a
lire. Ce mot n'efl: pas fort u/ité.
e
F)
ABÉE, f. f. Ville du dérroit Me[eruen que Xerd:s
briUa,
&
<I:,i avoit été bíltie par
Abas
/ils de Lyncée.
AnÉE, Lf.ouverrure prati<j11ée
a
la baie d'un mou•
Jin, par laqueUe l'eau tombe
(U!
lit
grande roUf;
&
e
















