
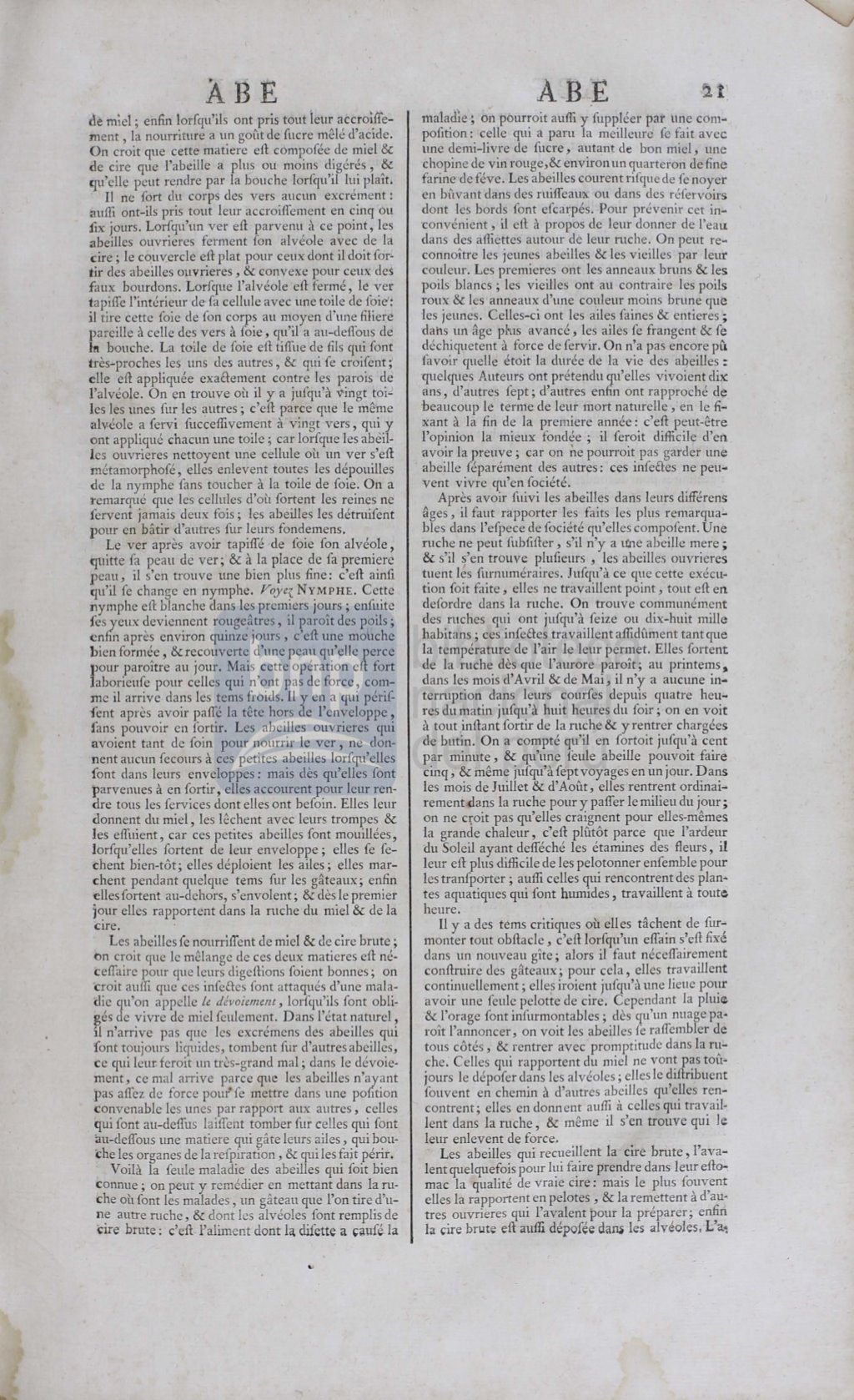
ABE
de miel; enfin lorfqu'ils ont pris tout leur accroiífe–
ment , la nourriture a un gOllt de fucre m&lé d'acide.
On croit que cette matiere eíl compofée de miel &
de cire que l'abeille a plus ou moins digérés, &
qu'elle pcut rendre par la bouche lorfqu'il lui pla'it.
II ne Cort du corps des vers allcun excrément:
auffi ont-ils pris tout leur accroilfement en cinq ou
[¡x jours. Lorfqu'un ver eíl parvenu a ce point, les
abeilles ouvrieres ferment fon alvéole avec de la
cire; le couvercle eíl plat pour ceux dont il doit Cor–
tir des abeilles ouvrieres, & convexe pour ceux deS
faux bourdons. LorCque l'alvéole eíl fermé, le ver
tapiíre l'intérieur de fa cellule avec une toile de Coie:
il tire cette Coie de
Con
corps au moyen d'une filiere
pareille a celle des vers a foie, qu'il a au-deífous de
}ft
bouche. La toile de foie eíl tiffue de fils qui
Cont
tres-proches les uns des autres, & qui fe croifent;
elle eíl appliquée exaélement contre les parois de
l'alvéole. On en trouve 011 il Y a jufqu'a
~"ingt
toi–
les les unes fur les autres; c'eíl parce que le meme
aJ-"éole a (ervi (uccefl'ivement
a
vingt vers , qui y
ont appli'lué chacun une toile ; car lor(que les abeil–
les ouvrieres nettoyent une cellule Ol! un ver s'eíl
métamorphoCé, elles enlevent toures les dépouilles
de la nymphe fans toucher a la toile de foie. On a
remarqué que les cellules d'oll fortent les reines ne
fervent jamais deux fois; les abeille les détmi(ent
IJour en batir d'alltres (ur leurs fondemens.
Le ver apres avoir tapi/fé de (oie
Con
alvéole,
quitte
[.1.
peau de ver; & a la place de Ca premíere
peau, il
~'en
trouve une bien plus fine : c'eíl ainfi
qu'il Ce change en nymphe.
Voye{
NYMPHE.
Cette
nymphe eíl: blanche dans les premiers jours ; enCuite
fes yeux deviennent rougeatres, il parolt des poils ;
enfin apres environ quinze jours, c'eíl: une mouche
bien formée, &recouverte d'une peau qu'elle perce
110UT paroltre au jour. Mais cette opération eíl: fort
laborieuCe pour celles 'luí n'ont pas de force, com–
me il arrive dans les tems froids. Il yen a qui périC–
{ent apres avoir paífé la tete hors de l'enveloppe,
fans pouvoir en Cortir. Les abeilles ouvrieres (fUi
avoient tant de
Coin
pour nourrir le ver, ne don–
nent aucun Cecollrs a ces petites abeilles 10rCqu'elles
font dans leurs enveloppes: mais des qu'elles
Cont
parvenues a en Cortir, elles accourent pOllr leur ren–
dre tous les (ervices dont elles ont be(oin. Elles leur
donnent du miel, les lechent avec leurs trompes &
les eífuient , car ces petites abeilles (ont mouillées,
lorfqu'elles Cortent de leur enveloppe; elles (e (e–
chent bien-tot; elles déploient les ailes; elles mar–
chent pendant CJ1lelque tems Cur les gateaux; enfin
elles (ortent all-dehors, s'envolent; & des le premier
jour elles rapponent dans la ruche du núel & de la
cire.
Les abeilles
Ce
nourriífent de miel & de cire brute;
on croit 'lue le melange de
ces
deux matieres eíl: né–
ceífaire pour que leurs digeílions Coient bonnes; on
croit auffi que ces in(eéles (ont attaqués d'une mala–
die qll'on appelle
le
d,Jyoiemeru,
lorf'lu'ils [ont obü–
gés de vivre de miel Ceulement. Dans I'état naturel,
íl
n'arrive pas que les excrémens des aheilles CJ1ti
font toujours liCJ1lÍdes, tombent [ur d'autresabeilles,
ce CJ1li leur feroit un tres-grand mal; dans le dévoie–
ment, ce mal arrive paree CJ1le les abeilles n'ayant
'¡las affez de force pour' [e mettre dans une pofition
convenable les unes par rapport allX autres, celles
qui (ont au-de{flls laiífent tomber (ur eelles CJ1li [ont
au-dc{fous une matiere qui
~ate
leurs ailes, quibOll–
che les organes de la reCpiratlOn, & c¡uilesfait périr.
Voila la Ceule maladie des abeilles 'lui (oit bien
connue; on peut y remécüer en mettant dans la m–
che Ol! ront les malades , un gateau CJ1le l'on tire d'u–
n~
autre ruche, & dont les alvéoles (ont remplis de
clre brute: c'eíl: I'aliment dont la. difette a
~au(é
la
A
B
E
5.1
maladie; on pomroit auffi y "rllPpléer par une com–
pofition : celle CJ1li a paru la meillenre (e fait avec
une demi-livre de (ucre, alltant de hon miel, une
chopine de vin rouge,& environun quarteron de fine
farin; de féve. Les
ab~illes
courent rifque de Ce noyer
en huvant dans des rui/feaux Ol! dans des ré[ervoirs
dont les bords (ont efcarpés. Pour prévenir cet in–
convélúent, il eíl
a
propos de leur donner de l'eau
dans des affiertes autour de leur mche. On peut re–
connoitre les jeunes abeilles & les vieilles par leur
couleur. Les premieres ont les anneaux bruns & les
lJoils blancs ; les vieilles ont au contraire les poils
roux & les anneaux d'une couleur moins brune que
les jeunes. Celles-ci ont les ailes (aines & entieres ;
dahs un age pl'us avancé, les ailes (e frangent & (e
déchiquetent a force de (ervir. On n'a pas encore Pl¡
(avoir quelle étoit la durée de la vie des aqeilles :
quelques Auteurs ont prétendu CJ11'elles vivoient dix
ans, d'autres Cept; d'autres enfin Ont rapproché de
beaucoup le terme de leur mort naturelle, en le fi–
xant a la fin de la premiere année: c'eíl peut-etre
l'opinion la mieux fondée; il [eroit difficile d'en
avoir la preuve; car on ne pourroit pas garder une
abeille [éparément des autres; ces infeéles ne peu–
vent: vivre cllI'en (ociété.
Apres avoir Cuivi les abeilles dans leurs clifférens
ilges, il faut rapporter les faits les plus remare¡ua–
bIes dans I'e(pece de Cociété 'lu'elles compo(ent. Une
ruche ne peut Cubfiíler, s'i! n'y a une abeille mere ;
&
s'il s'en trouve plufiems , les abeilles ouvrieres
tuent les (urnuméraires. Ju{qu'a ce que cette exécu–
tion Coit faite, elles ne travaillent point, tour eíl en
de(ordre dans la ruche. On trouve communément
des mches 'lui ont juCCJ1I'a Ceize OH dix-huit mille
habitans ; ces infeéles travaillentaffidltment tantque
la température de l'air le leur permet. Elles [ortent
de la ruche des CJ1le l'aurore parolt; au printems
~
dans les mois d'Avril & de Mai, il n'y a aucune in–
termption dans leurs cour(es depuis quatre heu–
res du matin juCqu'a huit heures du (oir; on en voit
a tout inílant [ortir de la ruche &
y
rentrer chargées
de butin. On a compté qu'il en fortoit juCCJ1I'a cent
par minute,
&
qu'une {eule abeille pouvoit faire
cine¡, & meme jU(CJ1I'a Ceptvoyages en un jour. Dans
les mois de Juillet & d'Aollt, elles rentrent ordinai–
rement dans la ruche pour y paífer le milieu du jour;
011 ne qoit pas CJ11'elles craignent pour elles-memes
la grande chaleur, c'eíl pllttot paree que I'ardeur
du Soleil ayant deíféché les étamines des fleurs, iI
leur eíl plus difficile de les pelotonner en(emble pour
les tranfporter ; auffi celles qtÚ rencontrent des pian–
tes aqllati'lues qui
Cont
humides, travaillent a toute
heure.
II y a des tems critiques otl elles tachent de [ur–
monter tout obílacIe, c'eft 10r[CJ1I'un eífain s'eíllixé
dans un nouveau glte; alors il faut néceírairement
coníl:ruire des gateaux; pour cela, elles travaillent
continuellement; elles iroient jufCJ1l'a une lieue ponr
avoir une Ceule pelotte de cire. Cependant la pluie
&
l'orage [ont inCurmontahles; des qu'un nllage pa–
rOlt I'annoncer, on voit les abeilles [e ra{fembler de
tous cotés , & rentrer avec promptitude dans la ru–
che. Celles 'lui rapportent du miel ne
von~
pas tOll–
jours le dépo(er dans les alvéoles; elles le dillribuent
(ouvent en chemin a d'alltres abeilles qu'elles ren–
contrent; elles en donnent auffi
11
celles 'lui travail–
lent dans la ruche, & meme il s'en trollve qui le
leur enlevent de force.
Les abeilles CJ1li recueillent la cire brute, l'ava–
lent c¡uelquefois pour lui faire prendre dans leur eílo–
mac la qualité de vraie cire: mais le plus Couvent
elles la rapportent en pelotes, & la remettent
a
d'au–
tres ouvrieres qui l'avalent pour la préparer; enfin
la cire bl1Jte eíl allffi dépofée
dans
les alvéoles.
L'a~
















