
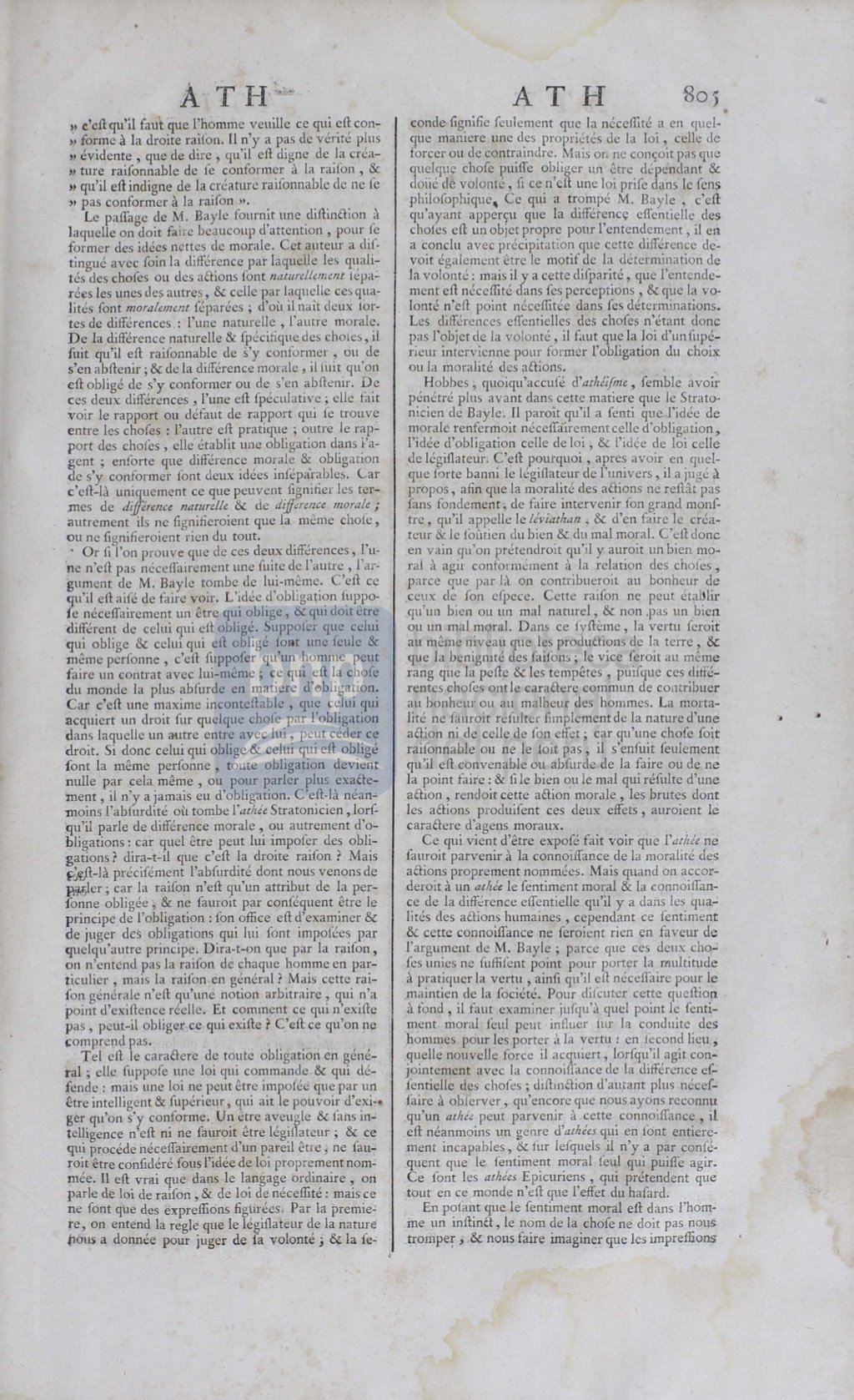
)/ e'eíl:qu'il faut que l'homme veuille ce qui eíl:con–
" forme a la droite raiCon. Il n'y a pas de vérité plus
" évidente , que de dire , qu'il eíl: digne de la créa–
"ture raifonnable de fe confonner a la rai(on,
&
)/ qu'il eíl: indigne de la créature raifonnable de ne (e
" pas conformer
a
la raifon ...
Le paífage de M. Bayle fournit une .diíl:inaion a
laquelle on doit faire beaucoup d'attentlon , pour fe
former des idées nettes de morale. Cet auteur a dif·
tingué avec foin la différence par laquelle les quali–
tés des chofes ou des aaions font
nawreLlement
tépa:
rées les unes des atttres,
&
celle par laquelle cesqua–
lités font
moralelllen!
féparées ; d'ol! il nalt deux
101'–
tes de différences .: I'une natmelle ,I'autre mOl·ale.
De
la
différence natttrelle
&
fpécifique des choles, il
fuit qu'il eíl: raifonnable de s'y conformer , ou de
s'en abíl:enir ;
&
de la diffé1'ence mOl'ale, ílli.tít qu'on
eíl: obligé de s'y conformer ou de s'en abfl:enir. De
ces deux différences , I'une eíl: fpéculative; elle fait
voir le rapport ou défaut de rapport 'luí fe rrouve
entre les chofes : l'autre efl: pratique ; outre le rap–
port des chofes, elle établit une obligation dans
1'a–
gent ; enforte que différence morale
&
obligatíon
de s'y confOl'mer (ont deux idées infeparables. Car
c'efr-Ia uniquement ce que peuvent figniner les ter–
.mes de
dijférence natllreLle
&
de
difforence morale;
autrement il ne fignifieroient que la meme chole,
ou ne fignifieroient rien du tout.
. 01' fi I'on prouve que de ces deux diff¿rences, l'u–
'ne n'efr pas néceífai1'ement une fuite de l'autre , l'a1'–
gument de M. Bayle tombe de lui-meme. C'eíl: ce
qu'il efl: aifé de faire voir. L'idée d'obligation fuppo–
fe néceífairement un ctre qui oblige,
&
qui doit etre
diffé1'ent de celui quí
dI:
obligé. SuppoCer que celuí
qui oblige
&
celui qui eíl: obligé fOBt une feule
&
meme perfonne, c'eíl: fuppofer qu'un homme peut
faire un conU'at avec lui-meme; ce qui efl: la chofe
du monde la plus abfurde en matiere d't!Jbligation.
Cal' c'efl: une maxime inconteíl:able , que ceJui qui
acquiert un droit fur quelque chofe par l'obligation
dans laquelle un a·utre entre avec lui, peut céde1' ce
deoit. Si donc celui qui oblige
&
celui qui efr obligé
font la meme perfonne, tonte obligation devienr
nulle par cela meme , ou pour parler plus exaae–
ment, il n'y a jamais eu d'obligarion. C'efr-Ia néan–
moins l'abfurdité Olt tombe
l'athée
Stratonicien, Ion–
.<fu'il parle de différence morale , ou autrement d'o–
bligations: cal' quel etre peut lui impofer des obli–
gations? dira-t-il que c'eíl: la droite raifon? Mais
~vr-Ja
précifément l'abfurdité dont nous venons de
~er
; car la rai(on n'efl: qu'un attribut de la per–
fonne obligée,
&
ne fauroit par conféquent Stre le
príncipe de l'obligation : fon oRice eíl: d'examiner
&
de juger des obligations qui lui font impofées par
quelqu'autre principe. Dira-t-on que par la raifon,
on n'entend pas la raifon de chaque homme en par–
riculier , mais la raifon en général
?
Mais cette rai–
fon générale n'efl: qu'une notion arbitraire, qui n'a
point d'exifl:ence réelle. Et comment ce qui n'exifre
pas, peut-il obliger ce qui exiíl:e
?
C'eíl: ce qu'on ne
comp1'end pas.
TeI
efl: le caraaere de toute obligation en géné–
ral ; elle fuppofe une loi 'luí commande
&
qui dé–
fende : mais une loi ne peut etre impo(ée que par un
Stre intelligent
&
fupérieur, 'luí ait le pOitvoir d'exi-.
ger qu'on s'r conforme. Un erre aveugle
&
fahs in":
telligence n efl: ni ne (auroit etre légiflateur;
&
ce
I11ti procéde néceífairement d'un pareil erre, 11e fau–
roit etre confidéré fous l'idée de loi proprement nom–
mée.
n
efl: vrai I11te dans le langage ordinaire, on
parle de loi de raifon
,&
de loi de néceffité: mais ce
ne font que des expreffions figurées. Par la premie–
re, on entend la regle que le
lé~i{latieltr
de la nature
Mus
a donnée pour juger de la volonté
j
&
la fe-
ATH
-80)
conde fig.nifie feulement que la néceffité a en quel–
que mal11ere une des propriétés de la loi, celle de
forcer ou de contraindre. Mais oro ne conlfoitpas que
quelque chofe puiífe obliger un Stre dépendant
&
doiié de volonté, fi ce n'efl: une loi pri(e dans le fens
philofophique, Ce qui a trompé M. Bayle , c'efr
CJlI'ayant appe1'lfll que la dífférencc; e/fentielle des
chofes eíl: un objet propre pour l'entendement , il en
a conclu avec précipitarion que cette différence de–
voit également Stre le morif de la détermination de
la volonté: mais il ya cette difparité, que I'entende–
ment eíl: nécefIité dans fes perceptions ,
&
que la vo–
lonté
n'ea
point néceílitée dans fes déterminations.
Les différences e/fentielles des chofes n'étant done
pas I'objet de la volonté , il faut que la loi d'unfupé–
rieur intervienne pour former l'obligation du choix
ou la moralité des aEtions.
Hobbes, quoiqu'accufe
d'atlziifme,
femble 3voi1'
pénétré plus avant dans cette matiere que le Strato–
nicien de Bayle'.
11
paro1t qu'il a fenti que l'idée de
morale renfermoit néce/f¡jirementcelle d'obJigation,
l'idée d'obligarion celle deloi,
&
l'iMe de loi celle
de légif1ateur. C'efl: poutquoi , apres avoír en quel–
que forte banni le légif1ateur de I'univers , il a juaé
a
propos, afin que la moralíté des aaions ne refrar"pas
[.1ns fondement, de faire intervenir fon grand monf–
tre, qll'il appelle le
léviat/uw
;
&
d'en faire le créa–
tem
&
le íOlttien dll bien
&
du mal moral. C'eíl:done
en vain qu'on prétendroit qu'il y auroit un bien mo–
ral a agil conformement
a
la relation des choCes ,
parce que par la on contribueroit au bonheur de
,ceux de fon efpece. Cette ratfon ne peut étal!lir
qu'un bien ou un mal naturel,
&
non .pas un bien
ou un mal moral. Dans ee fyfl:eme, la vertu feroit
au meme niveau que les produEtions de la tCITe,
&
que la benigl11té des faifons; le vice (eroit au meme
rang que la peíl:e
&
les tempetes ,
puifql.leces diffé–
rentes chofes ontle ,araaere commun de CO,ltrihuer
au bonhelU' ou au malhettr des hommes. La morta–
lité ne fauroit réfulter fimplement de la nature d'une
ailion ni de celle de fon effet; car qu'une chofe foit
raifonnable ou ne le foit pas, il s'en(uit feulement
qu 'il eíl: convenable ou abfurde de la faire ou de ne
la point faire :
&
fi
le bien ou le mal qui réfulte d'une
ailion, rendoit ceHe ailion morale, les brutes dont
les aaions produifent ces delllc effets, auroient
le
caraaere d'agens moraux.
Ce qui vient d'Stre expofé fait voir I11te l'
atkée
ne
fauroit parvenir
a
la connoi/fance de la moralité des
aaions proprement nommées. Mais quand on accor–
deroit
a
un
at/!é,
le fenrimenr moral
&
la connoiífan–
ce de la
diff~rence
eífentielle qu'il y a dails les qua–
lités des aEtions humaines , cependant ce fentiment
&
cette connoiífance ne feroient rien en faveur de
l'argument de M. Bay[e ; parce que ces deux cho–
fes unies ne fuRifenr point pour porter [a rnulcitude
a
pratiquer la vertu , ainli qu'il efr néceífai1'e pour le
maintien de la fociété. Pour difcuter cette queilion
a fond , i[ faut examiner jufqu'a quel point le fenti–
.ment moral feul peut ínfluer
fi.trla conduite des
hommes pour les porter
a
la verttt : en fecond lieu ,
quelle nouvelle force il acquiert, lor(qu'il agit con–
jointement avec la connoiífance de In différence ef–
fentielle des chofes ; diíl:tnilion d'autant plus nécef–
faire a obferver, qu'encore que nous ayOns reconnu
,qu'un
athée
peut parvenir 11 cette connoiífance, il
el!: néanmoins un genre
d'athées
qui en {ont entiere–
ment incapables,
&
fi.u- lefquels
il
n'ya par confé.
I11tent que le {entiment moral feul qui puiffe aair.
Ce font les
athées
Epicuriens , qui prétendent que
tour en ce monde n'efr que I'effet du hafard.
En poümt que le fenriment moral efr dans l'hon¡–
me un inilina, le
nbm
de la chofe ne doit pas nous
trompe~
,
&
nons faire imaginer (llte les imp1'effionS'
















