
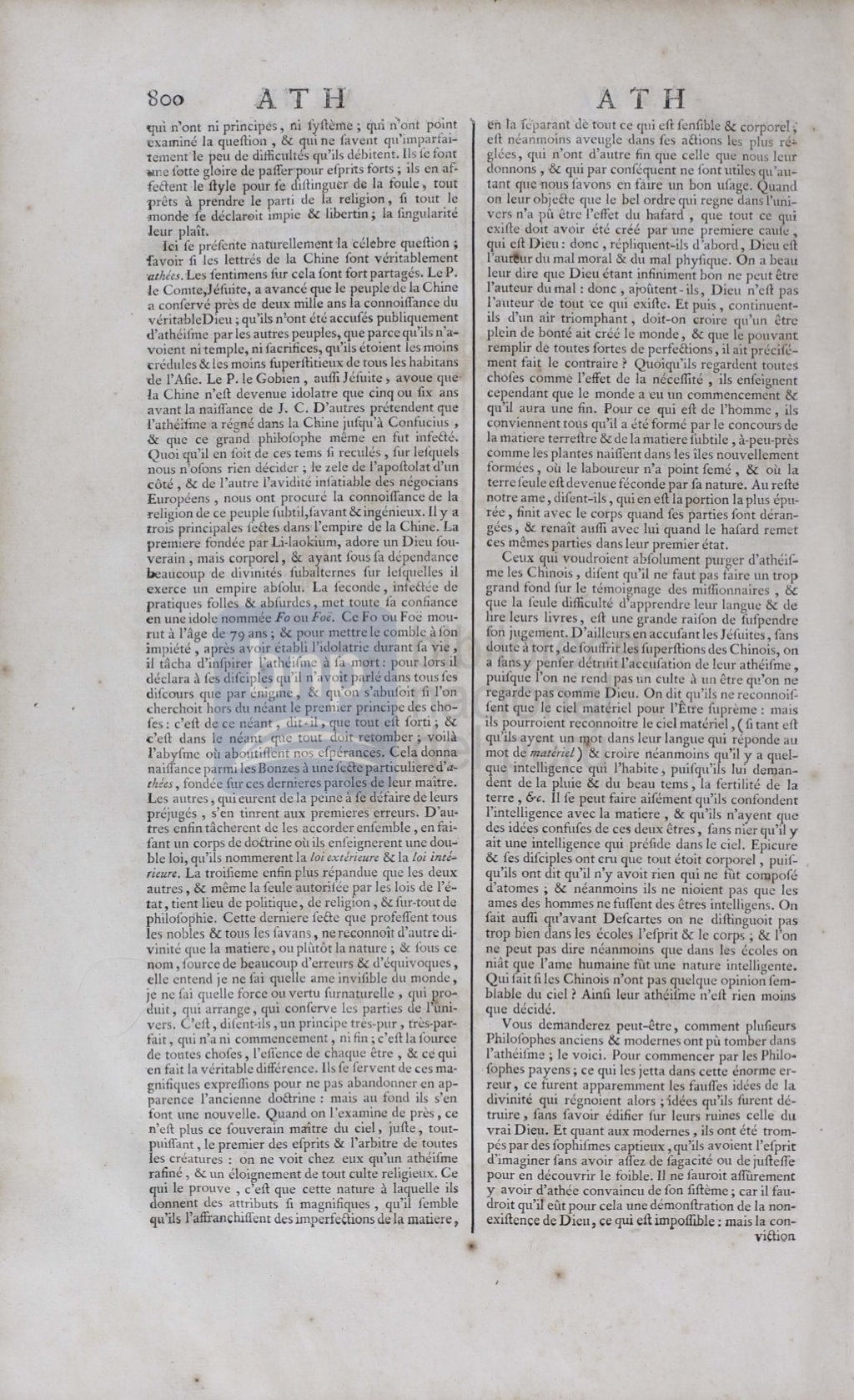
800
ATH
qUl n'ont ni principes, ni fyf1:erne; qlli n'?nt
poi~t
'examiné la queíl:ion , & qlli ne favent qU'lmparfal–
tement le pen de difficultés c¡u'ils
~ébitent.
I.lsfe font
tlne (otte gl@ire de
paffer·~o~tr
efpríts forts; lIs en
~f
feaen't le f1:yle pour fe dlilingu r
~e.
la foule) tout
Frets
a
prendre le part! de 1<1: reh.glOn,
{¡
tout.1~
-monde fe
déclar~it
imple & líbertm; 103 f1!lgulante
.leur plalt.
,.
lei fe préfente
naturelleme~t
la ce!eb;e. quef1:lOn ;
favoir ú les lettrés de la Chille font ventablement
·atl'¡es.
Les (entimens fm cela font fort pal1agés. LeP.
le Comte,Jéfuite, a
avanc~
que le peuple
d~ I~
Chine
a confervé pTes de deux mille ans la connOlífance du
véritableDieu· qu'ils n'ont été accufés publiquement
d'athéifme par¡es autres peuples, que parce qu'ils n'a–
voiem ni temple, ni
facrific~s?
qll'ils étoient les
~oins
'Crédules
&
les moins fil¡rerilitJeux de tous les habltans
-de l'Aúe. Le P. le Gobien, auili Jéfuite) avoue que
la
Chine n'eíl: devenlle idolatre que cinq ou
ÚX
ans
avant la naiffance de J.
C.
D'autres pretendent que
l'athéifme a récrné dans la Chine julqu'a Confucius ,
&
que ce
gra~d
philofophe meme en fut infeaé.
Quoi qn'il en {oít de ces tems
1i
reculés , fur lefqllels
nous n'ofons rien décider; le zele de I'apoíl:olat d'un
coté & de l'autre l'avidité infatiable des négocians
Européens , nouS ont
pr~curé
la
co~no,in:ance
de
la
i"eligion de ce peuple fubtil,favant.&
1I1gerueu~.
II
y a
trois principales feaes .dans·
~'emplTe
de la
C~e.
La
premiere fundée parLI-Iaok1Um, adore un Dleu fou–
verain , mais corporel,
&
ayant fous fa dépendam:.e
beaucoup de divinités fubalternes fur
l~fquel!es
¡[
exerce tm empire abfolu. La feconde, mfeat:e de
pratiques folles
&
abfurdes , met toute {a confiance
en une idole nommée
Fo
ou
Foi.
Ce Fo ou Foe mOtl–
mt
a
l'age de
79
ans; & pou:
mett~e
le comble a (on
impiété , apres avoir établi l'ldolatne durant fa V1e.,
il
dicha d'infpirer l'athéifme a fa mort: pour lors il
déclara
a
fes difciples qu'il n'avolt parlé dans tous fes
difcours que par énigme,
&
qu'on s'abufoit ú I'on
cherchoit hors du néant le premier principe des cho–
{es: c'ef1: de ce néant, dit-il, que tout ef1: {orti; &
c'ef1: dans le néant que tout doit retomber ; voila
l'abyfme ol! aboutiffent nos e{pérances.
~el~ don~a
naiffance parmi lesBonzes
a
une feae partlculiere d
a–
eMes,
fondée fm ces dernieres paroles de leur maltre.
Les autres, quiement de la peine a fe défaire de leurs
préjugés , s'en tinrent aux premieres errel1rs. D'au–
tres enfin tachercnt de les accorder enfemble , en fai–
fant un corps de doélrine Oll ils enfeignerent une dou–
ble loi, qu'ils nommenmt la
lo; ex térieure
& la
lo; ind–
,ieure.
La troiúeme enfin plus répandl1e que les deux
3utres, & m&me la [eule autorilee par les lois de I'é–
tat, tient líeu de politique, de religion , & {ur-tout de
philofophie. Cette derniere feél:e que profeffcnt tous
les nobles & tous les favans, ne reconnoit d'autre di–
vinité que la matiere, ou pllltot la nature ;
&
fous ce
nom, fource de beaucoup d'erreurs & d'équivoques,
elle entend je ne fai ql1elle ame inviíible du m?nde,
je ne {ai queHe force
~u
vertu furnarurell.e , qll1
?r~auit, qui arrange,.CfW
conf~rv.e
les partles
d~
lum–
verso C'ef1:, difent-Ils, un pnnclpe tres-pur , tres-par–
fait qui
n~a
ni commeneement, ni fin; c'ef1: la fouTee
de
t~l1tes
chofes , l'effence de chaque etre ,
&
ce qui
en fait la véritable différence. lis fe {ervent de ces ma–
gnifiques exprellions pOllr ne pas ab:ll1donner en ap–
parence l'ancienne dofuine : mais au fond ils s'en
font une nouvelle. Quand on I'examine de pres, ce
n'en plus ce fouverain maltre du ciel, juf1:e, tout–
puiJrant, le premier des efprits
&
l'arbitre de tontes
les créanlres : on De voit chez eux C[u'un athéifme
rafiné, & un éloicrnemeBt de tout culte religieux. Ce
qui le prouve , lef1: que cette namre
a
laquelle ils
donnent des attributs
{¡
magnifiques, qu'il femble
'lu'ils l'affranchíffent des unperfeaíons de la mariere,
ATH
en la fé·parant de tout ce 'luí efe {enftblc & corporel;
ef1: néanmoins aveugle dans fes aél:ions les plus re...
glées, qui n'om d'autre fin que ceHe que nous Icur
donnons ,
&
qui par conféquent ne font 'miles qu 'au–
tant que 110US favons en faire un bon ufage. Quand
on leur objeae que le bel ordre qui regne dans l'lmi–
vcrs n'a pll etre l'eHet du
hafard ,
que tout ce qui
exif1:e doít avoir été créé par une premiere catlle •
qui ef1: Dieu: donc, répliquent-ils d'abord, Dicu cn
l'aureur du mal moral
&
du mal phYÚque. On a beau
leur dire que Dieu étant infiniment bon ne peut etre
l'auteur dumal : done, afolltent- ils, Dieu n'ef1: pas
I'auteur 'de tout 'ce qui exif1:e. Et puis , continuent–
ils d'un a'ir triomphant, doit-on croire qu'un etre
plein de bonté ait créé le monde, & que le pouvant
remplir de toutes Cortes de perfeélions, il ait précifé–
ment fait le contraire
~
Quoic¡u'íls regardent tomes
cho{es commé l'effet de la nécellité , ils enfeignent
cependant que le monde a eu un commcncement &
ql1'il aura une fin. Pour ce qui ef1: de l'homme, ils
conviennent tolts qu'il a ¿té formé par le concours de
la matiere terref1:re & dela matiere {bbtile , a-peu-pres
Comme les plantes naiffent dans les lles nouvellement
formées, Oll le laboureur n'a point femé, & OLl la
terre feule eíl:devenue féconde par fa nature. Au ref1:e
norre ame, difent-ils, qui en ef1: la portion la plus épu–
rée, finit avec le corps quand {es parties font déran–
gées,
&
renalt aulli avec lui quand le ha{ard remet
ces memes parties dans lem premier état.
Ceux qui voudroient abfolument purcrer d'athéif–
me les Chinois , difent c¡u'il ne faut pas ¡"aire un trop
grand fond {ur le témoignage des millionnaires , &
que la feule difficulté d'apprendre leur langue & de
lire leurs livres, ef1: une grande raifon de {ufpendre
fon jugement. D'ailleurs en acclúam les
J
éfuites, f.'ms
doute
a
tort, de fouffrir les {uperíl:ions des Chinois, on
a fans y penfer détruit l'accufatión de lcm athéifme,
puifque l'on ne rend pas un culte
a
un etJ·e ql!'On ne
regarde pas comme Dieu. On dit C¡l1'ils ne reconnoif–
{ent que le cie! matériel pour l'Etre fupreme : mais
ils pourroient reconnoltre le ciel matériel ,( fi tant
ell:
qu'ils ayent un l110t dans leur langue c¡ui réponde au
mot de
matériet)
&
croire néanmoins qu'il y a quel–
que intelligence c¡ui l'habite, pui{qu'ils luí deman–
dent de la pluie & du beau tems, la fertilité de la
terre ,
&c.
Il
{e peut faire aifément qu'ils confondent
l'inteHigence avec la matiere ,
&
ql1'ils n'ayent que
des idées confufes de ces deux erres, fans nier qu'il
y
ait une intelligence qui préíide dans le cielo Epicure
& {es difciples ont
CTU
que tout étoit corpore!, puif–
qu'ils ont dit qu'il n'y avoit rien quí ne ñit compofé
d'atomes ; & néanmoins ils ne nioient pas que les
ames des hommes ne fiúrent des etres intelligens. On
{ait aulli qu'avant De{cartes on ne diilinguoit pas
trop bien dans les écoles l'e{prit & le corps ; & l'on
ne peut pas dire néanmoins que dans les écoles on
niat que l'ame hl1maine fflt une nature intelligente.
Qlli fait ú les Chinois n'ont pas quelque opiníon {em–
blable dll eie!
?
Ainfi leur athéifine n'ef1: ríen moins
que décidé.
Vous demanderez peut-etre, eomment pluúeurs
Philo{ophes anciens & modernes ont pu tomber dans
l'athéifme ; le voici. Pour commencer par les Philo–
fophes payens ; ce qui les jetta dans cette énorme er–
reur, ce furent apparemment les fauffes idées de la
divinité qui régnoient alors ; idées qu'ils {urent dé–
truire, fans {avoir édifier fur leurs ruines celle du
vrai Dieu. Et quant aux modernes, ils ont été trom–
pés par des fophifmes captieux, qu'ils avoiem l'efprit
d'imaginer fans avoir aífez de fagacité ou de juf1:eífe
pour en décol1vrir le foíble.
Il
ne fauroit a1T'urement
y avoir d'athée convaincu de fon fif1:eme; car il fau–
droit qu'il ef¡t pour cela une démonílration de la non–
exiaence de D ieu, ce quí ea impoíIible ; mais la con-
viétiQI1
















