
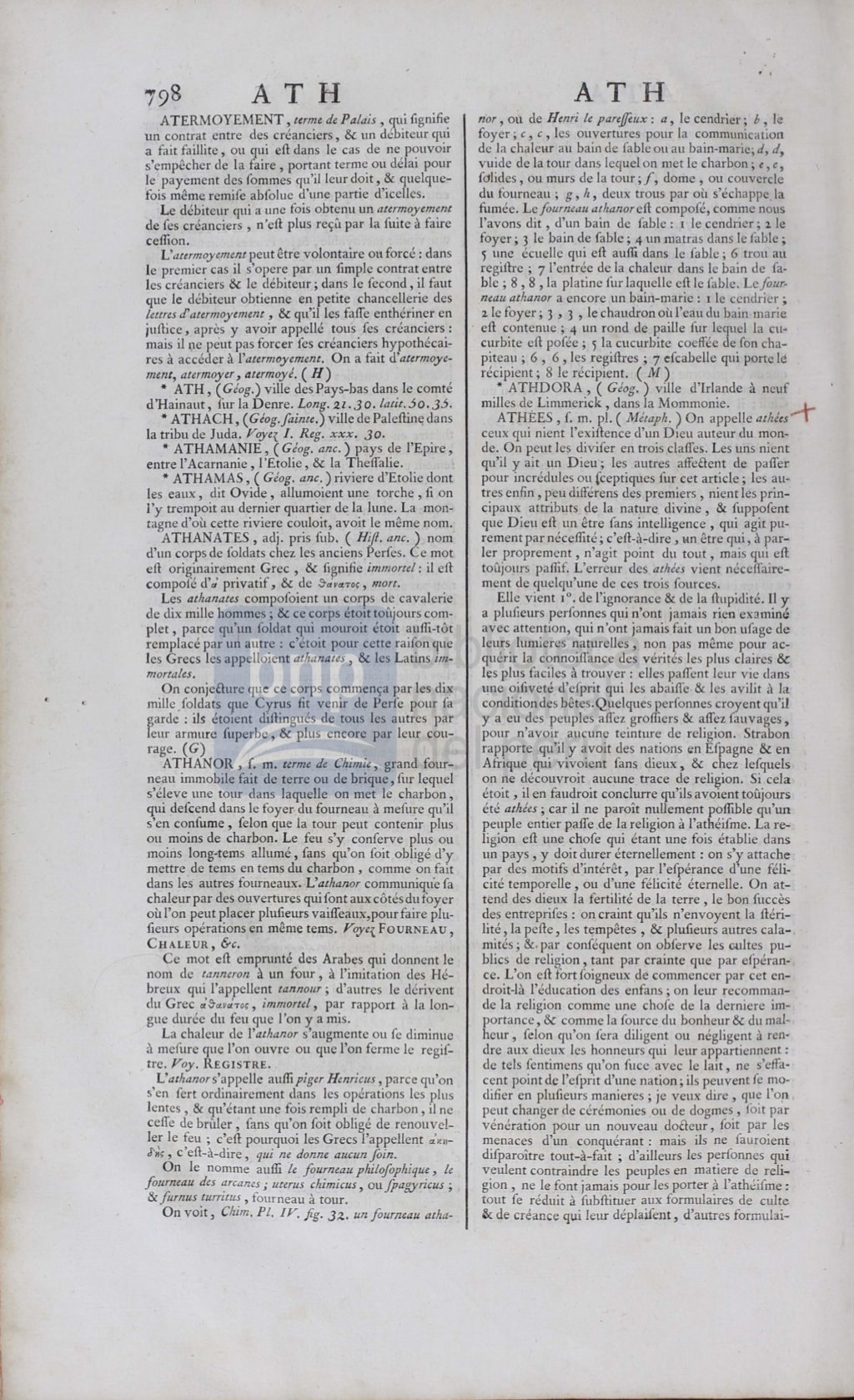
ATH
ATERMOYEMENT,
terme de Palais
,
~i
/ignifie
'-m contrat entre des créanciers,
&
un debiteur qui
a fait faillite, ou qui eO: dans le cas de ne pouvoir
s'empecher de la faire , portant terme ou délai pour
le payement des fommes qu'illeur doit,
&
quelque–
fois meme remife abfolue d'une partie d'icelles.
Le débiteur qui a une fois obtenu un
atermoyement
de fes créanciers , n'eO: plus re<;lI par la fuite a faire
ceilion.
L'
atermoy~ment
peut etre volontaire 01' forcé: dans
le premier cas il s'opere par un funple contrat entre
les créanciers
&
le débiteur; dans le (econd, il faut
que le débiteur obtienne en petite chancellerie des
lutres
ti'
atermoyemem
,
&
qll'illes falTe enthériner en
juíl:ice, apres y avoir appellé tous fes créanciers:
mais il ne peut pas forcer fes créanciers hypothécai–
res a accéder a
l'atermoyement.
On a faít
d'atermoye–
mmt, atermoyer, aurmoyé.
(
H)
*
ATH,
(Géog.)
ville des Pays-bas dans le comté
d'Hainaut, Útr la Denre.
Long. 2l.30. latit..50.3.5.
*
ATHACH,
(Géog.fainte.)
villede Paleíl:inlldans
la tribu de Juda.
Voye{
J.
Reg. xxx. 30.
*
ATHAMANIE,
(Géog. anc.)
pays de l'Epire,
entre l'Acarnanie, I'Etolie,
&
la Theíralie.
*
ATHAMAS , (
Géog. anc.
)
riviere d'Etolie dont
les eaux, dit Ovide, allumoient une torche, Ji on
I'y trempoit au demier quartier de la lune. La mon–
lagne d'ou cette riviere couloit, avoit le meme nomo
ATHANATES, adj. pris fub. (
Hiji. anc.
)
nom
d'nn corps de foldats chez.les anciens Perfes. Ce mot
eO: originairement Grec,
&
/ipnifie
immonel:
il eíl:
compofé d''; privatif,
&
de
~"V":TO~,
mon.
Les
athanates
compoCoient
1m
corps de cavalerie
de clix mille hommes ;
&
ce corps étoit tOtljours com–
plet, parce qu'un Coldat qui mouroit étoit auffi-tot
remplacé par un autre : c'étoit pour cette raifon que
les Grecs les appelloient
athanates
~
&
les Latins
im–
mortales.
On conjefrure que ce corps commen<;a par les
d~
rnilleJoldats que Cyrus fit venir de Perfe pom fa
garde : ils étoient diíl:ingués de tous les autres par
1eur armme fuperbe,
&
plus encore par lem cou–
rage.
CG)
ATHAN'OR,
f.
m.
tume de Chimie,
grand fom–
neau immobile fait de terre ou de brique, filr lequel
s'éleve une tour dans laquelle on met le charbon,
qui defcend dans le foyer du fourneau a mefure qu'il
s'en conCume, Celon que la tour peut contenir plus
ou moins de charbon. Le feu s'y conferve plus ou
moins long-tems allumé, fans qu'on foit obligé d'y
mettre de tems en tems du charbon, comme on falt
dans les autres fourneaux.
L'athanor
communiqlle
Ca
chaleurpar des ouvertures
qui
Cont
aux cotésdufoyer
ou I'on peut placer pluJieurs vaiíreaux,pourfaire plu–
fieurs opérations en meme tems.
Voye{
FOURNEAU,
CHALEUR,
&c.
Ce mot eO: empnmté des Arabes qui donnent le
nom de
tanneron
a un four, a I'imitanon des Hé–
breux qui l'appellent
tannour;
d'autres le dérivent
du Grec
d&<t.vd70~,
immortel,
par rapport a la lon–
gue durée du feu que 1'0n ya mis.
La chaleltr de
I'athanor
s'augmente ou fe diminue
a mefure que I'on ouvre ou que 1'0n ferme le regiC–
treo
Voy.
REGISTRE.
L'athanors'appelle auili
piger Hmricus
,
parce qu'on
s'en fert ordinairement dans les opérations les plus
lentes,
&
qu'étant une fois rempli de charbon , il ne
ceíre de brüler, Cans qu'on foit obligé de renouvel–
ler le feu ; c'eO: pourquoi les Grecs I'appellent
d.n–
J'~~,
c'eO:-a-dire,
qui ne donne aucun loin.
On le nomrne auffi
le foumeau philofophique, le
foumeau des
~rcanes;
Ulerus c!,imicus,
ou
fpagyricus ;
&fumus tUrT/tus,
fourneau a tour.
On voit,
Chim. Pl. IV. fig.
32.
un foumeau at!za-
ATH
nor,
OlL de
Hmri le pare.ffiux: a,
[e cendrier;
b,
[e
foyer;
e, e,
les ouvertures pour la communicauon
de la chaleHr au bain de (able ou au bain-marie;
d, d,
vuide de la tour dans lequel on met le charbon ;
e,
e,
fólides, ou mLlrs de la tour;
¡,
dome, ou couvercle
du fourneau;
g ,
Iz,
dellx trous par oh s'échappe la
f1l1l1ée.
Lefourn~au
athanoreO:
compofé, comme
DOUS
I'avons dit , d'un bain de fable:
1
le cendrier ; 2 le
foyer;
3
le bain de fable ;
4
un matras dans le (able ;
5
une écuelle qui eO: auffi dans le fable;
6
rrou au
regiftre ; 7 l'entrée de la chaleur dans le bain de fa–
ble;
8 , 8
,la platine Cur laquelle eO: le Cable.
Lefour–
neau atILanor
a encore un bain-marie :
1
le cendrier ;
2le foyer;
3 , 3 ,
le ehaudron olll'eau du bain marie
eO: contenue;
4
un rond de paille fur lequel la cu–
curbite eO: pofée;
5
la cucurbite coefFée de fon cha–
piteau ; 6 , 6, les regifues ; 7 efcabelle qui porte le
récipient;
8
le récipient.
(M)
*
ATHDORA, (
Géog.
)
ville d'Irlande
a
neuf
milles de Limmerick , dans la Mommonie.
--1-
ATHÉES, f. m. pI. (
Métaph.
)
On appelle
atl,ées"--l
ceux c¡ui nient l'exiíl:ence d'un Dleu auteur du mon-
de. On peut les divifer en rrois clalTes. Les uns nient
qu'il yait un Dieu; les autres afFeétent de paífer
pOlU' incrédules ou (ceptiques (ur cet article ; les au-
tres enfin , peu difFérens des premiers , nient les prin–
cipaux attriburs de la nature divine,
&
fuppoCent
que Dieu eO: un etre fans intelligence , qui agit pu–
rement par néceffité; c'eO:-a-dire , Mn erre qui, a par-
ler proprement, n'agit point du tour, mais qui eft
toujours pailif. L'erreur des
atlzées
vient néceíraire–
ment de quelqu'une de ces trois (ources.
Elle vient
l°.
de l'ignorance
&
de la íl:upidité.
Il
y
a p[uJieurs perConnes qui n'ont jamais rien examiné
avec attention, qui n'ont jamais fait un hon uCage de
leurs lumieres naturelles, non
~as
meme pour ac–
quérir la connoilTance des vérites les plus claires
&
les plus faciles
a
trouver: elles palfent leur vie dans
une oi/iveté d'e(prit qui les abaifi"e
&
les avilit a la
conditiondes betes.Quelques per(onnes croyent qu'i!
y a eu des peuples aírez. groffiers
&
aíTez fauvages,
pour n'avoir aucune teinrme de religion. Strabon
rapporte qu'il y avoit des nations en Efpagne
&
en
Afriquequi vivoient Cans dieux,
&
ehez lefquels
on ne découvroit aucune trace de religion. Si cela
étoit, il en faudroit conclurre qu'ils avoient toujours
été
arMes;
car il ne paroit nuUement poffible qu'un
peuple entier
paíre.dela religion
a
I'athéifme. La re–
ligion eíl: une choCe qui étant une fois établie dans
un pays , y doit durer éterneUement : on s'y atrache
par des motifs d'intéret, par l'e(pérance d'une féli–
cité temporeUe , ou d'une félicite éternelle. On at–
tend des dieux la fertilité de la terre , le bon Cueces
des entteprifes : on craint qu'ils n'envoyent la O:éri–
lité, la peO:e , les tempetes ,
&
plufieurs autres cala–
mités;
& .
par conféquent on obferve les cultes pu–
blics de religion, tant par crainte cfue par e(péran–
ce. L'on eíl: fort Coigneux de comrnencer par cet en–
droit-la l'éducation des enfans; on leur recom1l1an–
de la religion cornme une chofe de la derniere im–
portance,
&
comme la fource du bonheur
&
du mal–
heur, fclon qu'on fera diligent ou négligent
a
ren–
dre aux dieux les honneurs qui leur appartiennent :
de tels Centirnens qu'on fuce avec le lait, ne s'efFa–
cent point
de
l'efprit d'une nation; ils peuvent fe mo–
difier en plufiettrs manieres; je veux dire, que I'on
peut changer de cérémonies on de dogmes, {oit par
vénération pour un nouveau doéteur, (oit par les
menaces d'nn conquérallt: mais ils ne (auroient
diCparoitre tout-a-fait ; d'aillems les perfonnes
qui
veulent contraindre les peuples en matiere de reli–
gion , ne le font ja1l1ais pour les porter
a
l'ath~iCme
:
tout Ce réduit a (ubftinter aux formulaires de culte
&
de créance qui leltr déplaifent, d'autres formulai-
















