
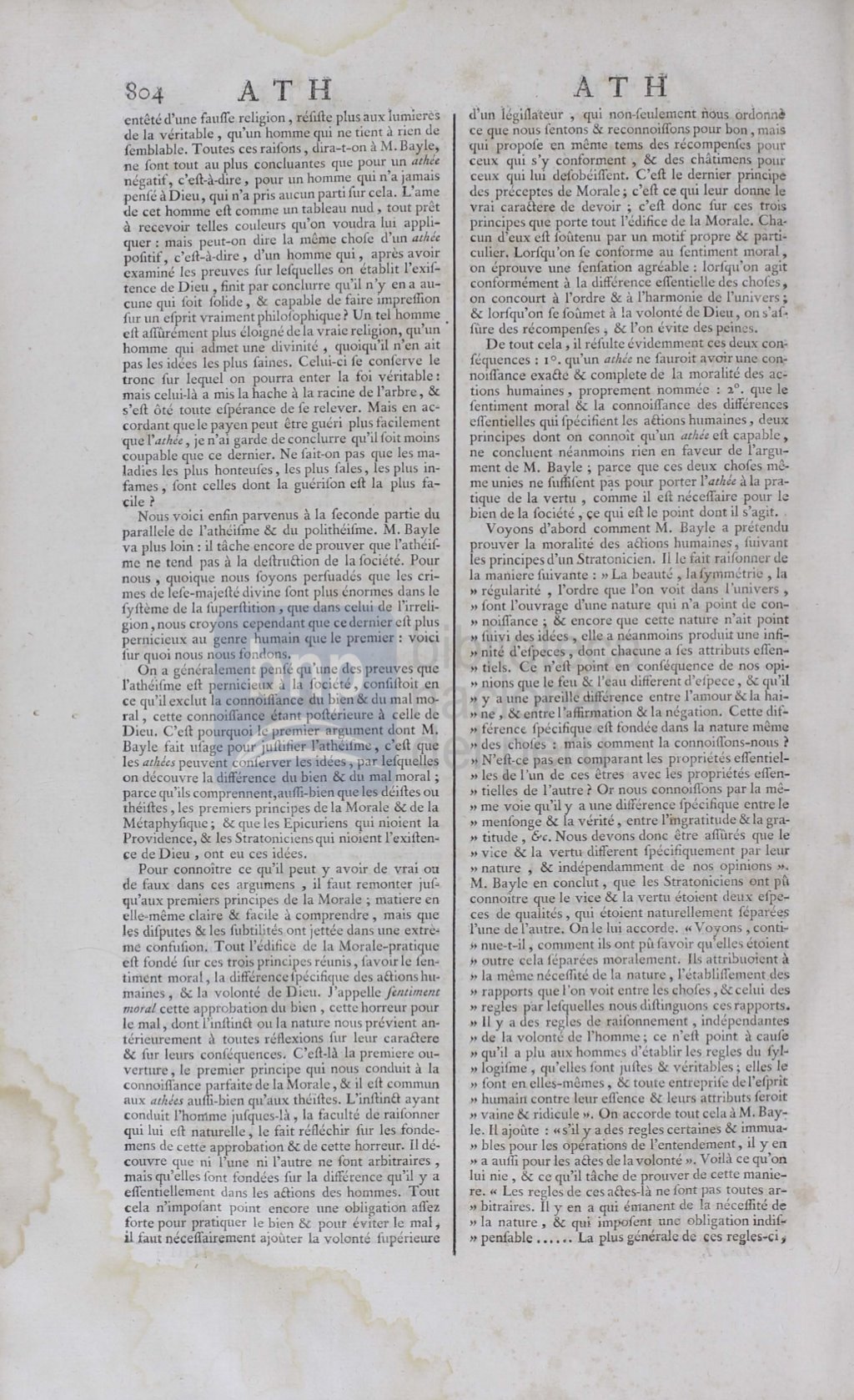
ATIt
enteté d'une fauífe religion , réfúl:e plus aux lumíeres
de la véritable, qu'un homme qui ne cient
a
rien de
femblable. Toutes ces raifons, dira-t-on
a
M.Bayle,
'fle font tout au plus concluantes que pour un
ntMe
négatif, c'-eft-a-dire, pour un
hom~e
qui n'a jamais
penfé
a
Dieu, qui n'a pris aucun partl fur cela.
L'a~e
-de cet homme eft comme un tableau nud, tout pret
~
recevoir telles couleurs qu'on voudra lui appli–
quer : mais peut-on dire la meme chofe d'un
neMe
pofitif, c'eil:-a-dire, d'un homme qui"
apr.es~v~ir
examiné les preuves fur lefquelles on etablIt 1eXlf–
tence de Dieu , finit par conclllrre qu'il n'yen a au–
cune qui foit folide, & capable de faire impreffion
fur un efprit vraiment philofophique? Un te! homme .
eft afItlfément plus éloigné de la vraie re!igion, qu'un
homme qui admet une divinité
j
quoiqu'iln'en ait
pas les idées les plus faines. Ce!ui-ci fe conferve le
tronc fur leque! on pourra enter la foi véritable:
mais ce!ui·la a mis la hache a la racine de I'arbre, &
s'eft oté tonte efpérance de fe relever. Mais en ac–
cordant quele payen peut erre guéri plus facilement
que l'
ntlzée,
je n'ai garde de conclurre qu'il foit moins
coupable que ce dernier. Ne fait-on pas que les ma–
Iadies les plus honteufes, les plus fales, les plus in–
fames, [ont celles dont la guéri[on eft la plus fa–
'CÍle?
Nous vojci enfin parvenus a la [econde parcie du
paralle1e de I'athéifme
&
du polithéiúne. M. Bayle
va plus lojn :
iI
tache encore de prouver que l'athéif–
me ne tend pas a la defuuétion de la [ociété. POllf
nous , quoique nous foyons per[uadés que les cri–
mes de le[e-majefté divine [ont plus énormes dans le
fyfteme de la [uperftition , que dans ce!ui de l'irre!i–
gion, nous croyons cependant que ce dernier eft plus
pernicieux au genre humain que le premier : voici
fur quoi nous nous fondons.
0l!
a généralement penfé qu'une des preuves que
l'athéifme eft pernicieux
a
la [ociété, confiftoit en
ce qu'il exclut la connoilfance du bien & du mal mo–
ral, cette connoilfance étant pofrérieure a celle de
Dieu. C'eft pourquoi le premier
ar~ument
dont M.
Bayle fait ufage pour jullifier l'atheifme, c'eft que
les
ntlzées
peuvent conferver les idées , par le[c¡uelles
on découvre la différence du bien
&
du mal moral;
parce qu'ils comprennent,au/fr-bien que les déiftes ou
théiftes, les premiers principes de la Morale
&
de la
Métaphyfique;
&
que les Epicuriens quj nioient la
Providence, & les Stratoniciensqui nioient I'exiften"
ce de Dieu , ont eu ces idées.
Pour connoltre ce Cfu'ü pent y avoir de vrai oa
de fame dans ces argumens , ji faut remonter juro
llll'aux premiers principes de la Morale ; matiere en
elle'meme claire & facile
a
comprendre, mais que
les difputes & les fubcilités ont jettée dans une extre–
me
confufion. Tout l'édifice de la Morale-pratique
eft fondé fur ces trojs principes réunis, [avoir le fen–
timent moral, la différence (pécifique des aétions hu–
maines,
&
la volonté de Dieu. J'appelle
jelltimellt
moral
cette approbation du bien, cette horreur pour
le mal, dont l'inftinét ou la nature nous prévient an–
térieurement
a
toutes réflexions fur leur caraétere
&
[ur lel1fs con[équences. C'eft-Ia la premiere ou–
verture, le premier principe c¡ui nous conduit
a
la
connoiífance parfaite de la MOTale, & il
ea
commun
aux
atlzJes
auffi-bjen Cfu'aux thélftes. L'inftinét ayant
concluit I'hOll1me jufques-la, la faculté de rai(onner
'lui lui eft naturetle, le fait réfléchir [m les fonde–
mens de cette approbation
&
de cette horreur.
It
dé–
couvre que ni l'une ni l'autre ne font arbitraires ,
maís qtl'etles [ont fondées [ur la différence qu'i1 y a
eífentletlement dans les aB:ions des hommes. Tout
cela n'impo[an.t point encore une obligation a/fez
forte pour prat.lCluer le bien
&
pour éviter le mal,
il
faut néceífairement ajouter la volonté [upérieure
ATH
d\m Iégillateur , qui non-feulement ñóus ordonne
ce que nous [entons
&
reconnoi/fons pour bon , mais
qui propofe -en meme terns des récompenfes pour
ceux qui s'y conforment ,
&
des chatimens pour
ceux qui luí de[obéiífent. Ceft le dernier principe
des préceptes de Morale; c'eft ce qui leur donne le
vrai caraétere de devoir ; c'eft donc [ur ces trois
principes que porte tout I'édifice de la Morale. Chao
cun d'eux eft foutenu par un motif propre
&
parti–
culier. Lor[qu 'on [e conforme au [entiment moral,
on éprouve une [en[acion agréable : lorfqu'on agit
conformément
a
la différence e/fentieUe des cho[es,
on concourt a l'ordre &
a
I'harmonie de l'univers;
&
lorfqu'on fe [ollll1et
a
la volonté de Dieu, on s'a[–
rure des récompenfes ,
&
l'on évite des peines.
De tout cela, il réfulte évidemment ces deux con–
[équences :
10.
c¡u'un
atMe
ne [auroit avoÍr une con–
noi/fance exaéte
&
complete de la moralité des ac–
cions humaines, proprement nommée :
2°.
que le
fentiment moral
&
la connoiífance des différences
eífentieUes qtu fpécifient les afrions humaines, deux
principes dont on connoit qtl'lIn
atlzée
eft capable ,
ne concluent néanmoins rien en faveur de I'argu–
ment de M. Bayle ; parce que ces deux chofes me–
me unies ne fuffifent
p~s
pour porter l'
atlzée
a
la pra–
tique de la vertu , comme
iI
eft néceífaire pour le
bien de la fociété , ce qui eft le point dont il s'agit.
Voyons d'abord comment M. Rayle a prétendu
proD.ver la moralicé des afrions humaines, fluvant
les principes d'un Stratonicien. Ille fait rai[onner de
la maniere fuivante : "La
beatlt~
, la [ymmétrie , la
" régularité , I'ordre que 1'0n voit dans l'univers ,
" [ont l'ouvrage d'une nature qui n'a point de con–
" noiífance ;
&
encore que cette nature n'ait point
,>
fuivi des idées , elle a néanmoins produit une infi–
" nicé d'efpeces, dont chacune a fes attributs eífen–
"tiels. Ce n'eft point en con[équence de nos opi–
" nions que le feu
&
I'eal! differem d'e[pece,
&
Cju'il
" y a une pareille différence entre I'amour
&
la hai–
»
ne ,
&
entre 1 'affirmation & la négation. Cette dif–
" férence fpécifiqtle eft fondée dans la nature m&me
"des chofes : mais comment la connoi/fons-nous ?
,/ N'eft-ce pas en comparant les propriétés elfentiel–
" les de l'un de ces etres avec les propriétés e/fen–
" tieUes de l'autre? Or nous connoiífons par la me–
" me voie qu'il y a une djffi'rence fpécifiqtle entre le
" menfonge
&
la v.!rité, entre l'ingratitude &la gra–
" titude ,
&c.
Nous devons donc etre afffirés que le
»
vice
&
la vertu different fpécifiqtlement par leur
»
nature ,
&
indépendamment de nos opinions
».
M. Bayle en conclut, que les Stratoniciens ont pu
connoitre que le vice
&
la vertu étoient cleux efp -
ces de Cfualités , c¡ui éteient naturetlement [éparées
I'une de I'auu·e. On le lui accorde. "Volons , conti-
1,
nue-t-il , comment
üs
ont pll favoir qu elles étoient
1>
outre cela féparées moralement. I1s attribuoient
a
), la meme néceffité de la natme , l'étabü{fement des
" rapports que ¡'on voit entre les chofes
,&
celui des
" regles par le[quetles nOlÍs dillinguons ces rapports.
" lt
Y a des rellles de raifonnement , indépendantes
»
de la volonte de I'homme; ce n'eft point
a
caufe
>1
qu'il a plu aux hommes d'établir les regles du [yl–
" logi[me , c¡u'eltes font juftes
&
véritables; elles le
" font en
ell~-memes,
&
toute entreprife de I'efprit
»
hlunain contre leur eífence
&
leurs attributs feroit
"vaine
&
ridicule
>l.
On accorde tout cela
a
M.
Bay~
le. Il ajoute : "s'ill a des regles certaines
&
immua–
" bIes pour les operacions de l'entendement, il yen
" a 3uffi pour les aétes de la volonté
>l.
Voila ce qu'on
lui nie ,
&
ce qu'il tache de prouver de cette manie–
re. " Les regles de ces aétes-la ne font pas toutes ar–
" bitraires.
It
y en a qtu émanent de la néceffité de
"la nahlre,
&
qlli impofent uno obligation indi[.
" penfable ••..•. La plus générale de ces regles-ci,
















