
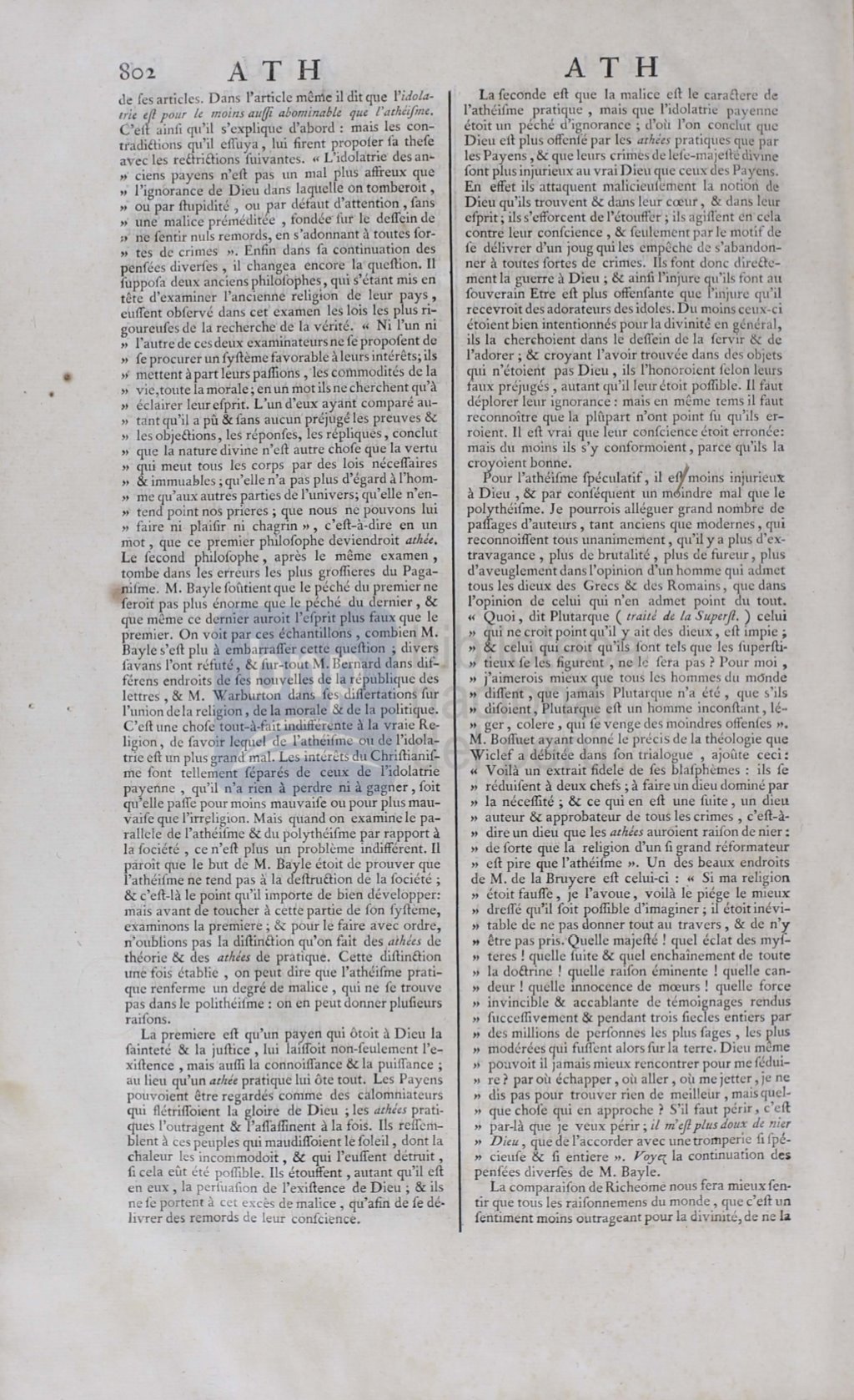
802
ATH
de fes artides. Dans l'artide men'le
il
dit que
l'ido/a–
lfie e(l pour
le
moins au{fi abominable que l'aehéijine.
'ea ¡¡inft qu'il s'explique d'abord: mais les con–
tradifrions qu
il
eff'u)'a, lui firent propoCer fa thefe
avec les reélrifrions fuivantes. "L'idolatrie des an–
" ciens payens n'efl: pas un mal plus weux q;ue
" l'ignorance de Dieu dans laquelle on tomberOlt ,
>1
ou par íhlpidité , ou par défaut d'attentiOn , fans
>1
une malice préméditée , fondée fur le deJIein de
:>
ne fentir nuls remords, en s'adonnant a toutes for–
>1
tes de crimes
>l.
EnJID daos fa continuation des
penfées diverfes , il changea encore la quefl:ion. 11
fuppo(a denx anciens philofophes, qui s'étant mis en
tere d'examiner I'ancienne religion de leur pays,
euff'ent obfervé dans cet examen les lois les plus
ri~
goureufes de la recherche de la vérité.
1(
Ni l'un
ni
>1
l'autre de cesdeux examinateursne fe propofent de
>1
fe procurer un{yfieme favorable a leurs intérets;
ils
" mettent apart leurs pa1Iions , les commodités de la
" vie,toute lamorale; en un mot
ils
necherchent qu'a
" éclairer leurefprit. L'tm d'eux ayant comparé au–
" tant Cfu'il a pu
&
fans aucun préjugé les preuves
&
" les objefrioos, les réponfes, les répliques, conclut
" que la nature divine n'efi autre chofe que la vertu
" quí meut tous les corps par des lois néceff'aires
" &
immuables; qu'elle n'a pas plus d'égard
a
I'hom–
" me Cju'aux alltres parties de l'uruvers; qu'elle n'en–
" tend point nos prieres ; que nous ne pouvons lui
" faire ni plaiíir ni chagrin", c'eft-a-dire en un
mot, que ce premier philofophe deviendroit
atlLée.
Le fecond philofophe, apres le
me
me examen,
tombe dans les erreurs les plus groffieres du Paga–
ni{me. M. Bayle fOlltientque le péché du premierne
{eroi! pas plus énorme que le péché du derruer,
&
que meme ce dernier auroit l'efprit plus faux que le
premier. On voit par ces échantillons, combien M.
Bayle s'efi plu a embarraJIer cette quellion ; divers
favans l'ont réfuté,
&
fur-tout M. Bernard dans dif–
férens endroits de {es nouve11es de la républi'Iue des
lettres
,&
M. Warburton dans fes diff'ertations fur
l'uniondela religion, de la morale
&
de la politiqueo
C'efi une chofe tout-a·fait indifférente a la vraie Re–
ligion, de favoir lequel de l'athéifme ou de l'idola–
trie efi un plus grand mal. Les intérets du Chrifl:ianif–
me [ont tellement féparés de ceux de l'idolame
payenne , 'Iu'il n'a rien a perdre ni a gagner , foit
qu'elle paff'e ponr moins mauvaife ou pour plus mau–
vai(e que
l'irr~ligion.
Mais quand on examine le pa–
rallele de l'athéifine
&
du polythéi{me par rapport a
la fociété , ce n'eft plus un probleme indifférent. 11
paroit que le but de M. Bayle étoit de prouver que
!'athéifme ne tend pas
a
la deftrufrion de la fociété ;
&
c'efi-Ia le point 'Iu'il importe de bien développer:
mais avant de toucher a cette parrie de {on fyfieme,
examinons la premiere ;
&
pour le faire avec ordre,
n'oublions pas la diilinélion qu'on fait des
alhées
de
théorie
&
des
aehées
de pratique. Cette dillinfrion
une fois établie ,
00
peut dire que l'athéifme prati–
que renferme un degré de matice, qui ne {e trouve
pas dans le polirhéifme : on en peut donner pluíieurs
rai{ons.
La premiere efi 'Ill'un payen qui otoit a Dieu la
fainteté
&
la jufl:ice , lui laiJIoit non-[eulement I'e–
xillence , mais auíIi la connoi1fance
&
la puiff'ance ;
au líeu qu'un
athl.e
pratique lui ote tout. Les Payens
pouvoient
etre
regardés comme des calomniateurs
qui f1étriJIoient la gloire de Dieu ; les
dtMes
prati–
ques l'outragent
&
l'afiaJI'tnent a la fois. Ils reJIem–
blent a ces peuples qtú maudiJIoient le foleil , dont la
chaleur les incommodoit ,
&
qui
l'euíI'ent détruit,
fi
cela eut été poJItble. lis étouffent , amant
qtl'il
efi
en eux, la perfuaúon de I'exifience de Dieu ;
&
iIs
nc fe portent a cet exces de malice , qu'afin de fe dé·
livrer des remords de leur confcience.
ATH
La feconde efl: que la malice cfi le caraélcre de
l'athéi{me pratique, mais que l'idolatrie pavenne
étoit un péché d'ignorance ; d'Ol! ron concl(¡t que
Dieu efi plus offenle par le
terhées
pratiques que par
les Payens
,&
que Icurs crimes de lefc-majefic divme
{ont plus injurieux au vrai Dieu que ceux des Payens.
En effet ils attaquent malicieulemem la notion de
Dieu qtl'ils trouvent
&
dans leur cceur,
&
dans leur
efprit; ils s'efforcent de l'étouffcr ; ils agifient en cela
contre leur confcience ,
&
feulement par le motif de
[e délivrer d'un joug q\Ú les empeche de s'abandon–
ner
a
toútes fortes de crimes. Ils font done direélc–
ment la guerre a Dieu ;
&
ainfi l'injure qu'ils font au
fouverain Erre efi plus offenfante que l'injurc '[u'il
recevroit des adorateurs des id,oles. Du moinsceux-ci
étoient bien intentionnés pour la divinité en
~énéral,
ils
la chen;:hoient dans le deff'ein de la fervlr
&
de
I'adorer;
&
croyant l'avoir trouvée dans des obJcts
qtIÍ n'étoient pas Dieu , ils l'honoroient (elon leurs
faux préjugés , autant qu'illeur étOit poffible. 11 faut
déplorer leur ignoraoce : mais en meme tems il faut
reconnoltre que la pltlpart n'ont point fu qu'ils er–
roienr. Il efl: vrai que lem con[cience étoit erronée:
mais du moins ils s'y conformoient, paree qu'ils la
croyoient bonne.
Pour l'athéi[me fpéculatif, il en/moins injurieu1C
a
Dieu ,
&
par conféqtlent un mlindre mal qtle le
polythéifme. Je pourrois alléguer grand nombre de
paJIages d'auteurs , tant anciens que modernes , c¡ui
reconnoiíI'ent tous unanimement , qll'il Ya plus d'ex–
travagance , plus de brutalité, plus de fureur, plus
d'aveuglement dans I'opinion d'un homme qui admet
tous les dieux des Grecs
&
des Romains, que dans
l'opinion de celtú qtIÍ n'en admet point du tout.
H
QlIoi, dit Plutarque (
traité
de
la Saperfl.
)
celui
" c¡ui ne croit point qu'il y ait des dieux, efi impie •
" &
celui qtli croit qu'ils {ont tels que les fuperili–
" tieux fe les figurent , ne le fera pas ? Pour moi ,
" j'aimerois mieux que tous les hommes dll mOnde
" diJIent, que jamais Plutarque n'a été, que s'ils
" di[oient, Plutargue efi un homme inconfiant, lé–
" ger, colere, qUI fe venge des moindres offen{es
>l.
M. BoíI'uet ayant donné le précis de la théologie que
Wiclef a débltée dans {on trialogue , ajoÍlte ceci:
H
Voila un extrait fidele de fes bla{phemes: ils fe
" réduifent a deLL"'{ chefs ; a faire un dieu dominé par
" la néceffité ;
&
ce qui en efi une fuite, un dieu
" auteur
&
approbateur de tous les crimes , c'efi-a–
" dire un dieu que les
mMes
auroient raifon de nier:
" de forte que la religion d'un fi grand réformateur
" efi pire que l'athéi{me ". Un des beaux endroits
de M. de la Bnlyere efi celtú·ci :
.H
Si ma religion
" étoit fauJIe, ¡e l'avoue, voila le piége le mieux
" dreff'é qu'il {oit poffible d'imaginer ;
il
étoit inévi–
" table de ne pas donner tout au travers,
&
de n'y
" erre pas pris:Quelle majefié ! qtlel éclat des myf–
" teres! qucHe fuite
&
qtlel enchamement de tome
" la doarine ! que11e raifon éminente
!
quelle can–
" deur! qtlelle innocence de mceurs
!
c¡uelle force
" invincible
&
accablante de témoignages rendus
" fucceffivement
&
pendant trois fiecles entiers par
" des millions de perfonnes les plus fages , les
~lus
" modérées 'fui fuifent alors fur la terreo Dieu meme
,1
pouvoit il ¡amais mieux rencontrer pour me fédui–
" re? par oll échapper , Olt a11er ,
011
me jetter ,je ne
" dis pas pom trouver rien de meilleur, mais
que!–
" que chole qtIÍ en approche
?
S'il faut périr, c'eH:
»
par-la que je vellx périr ;
il
¡n'
ejl
plus doux tle nier
"
Dieu,
que de l'accorder avec une tromperie fi (pé–
>1
cieufe
&
fi
entiere
».
Y'cry't{
la continuaríon dei
penfées diverfes de M. Bayle.
La comparaifon de Richeome nous fera mieux feo–
tir que tous les rai{onnemens du monde, que c'efi un
{entirnent moins outrageant pour la diviruté, de ne
la
















