
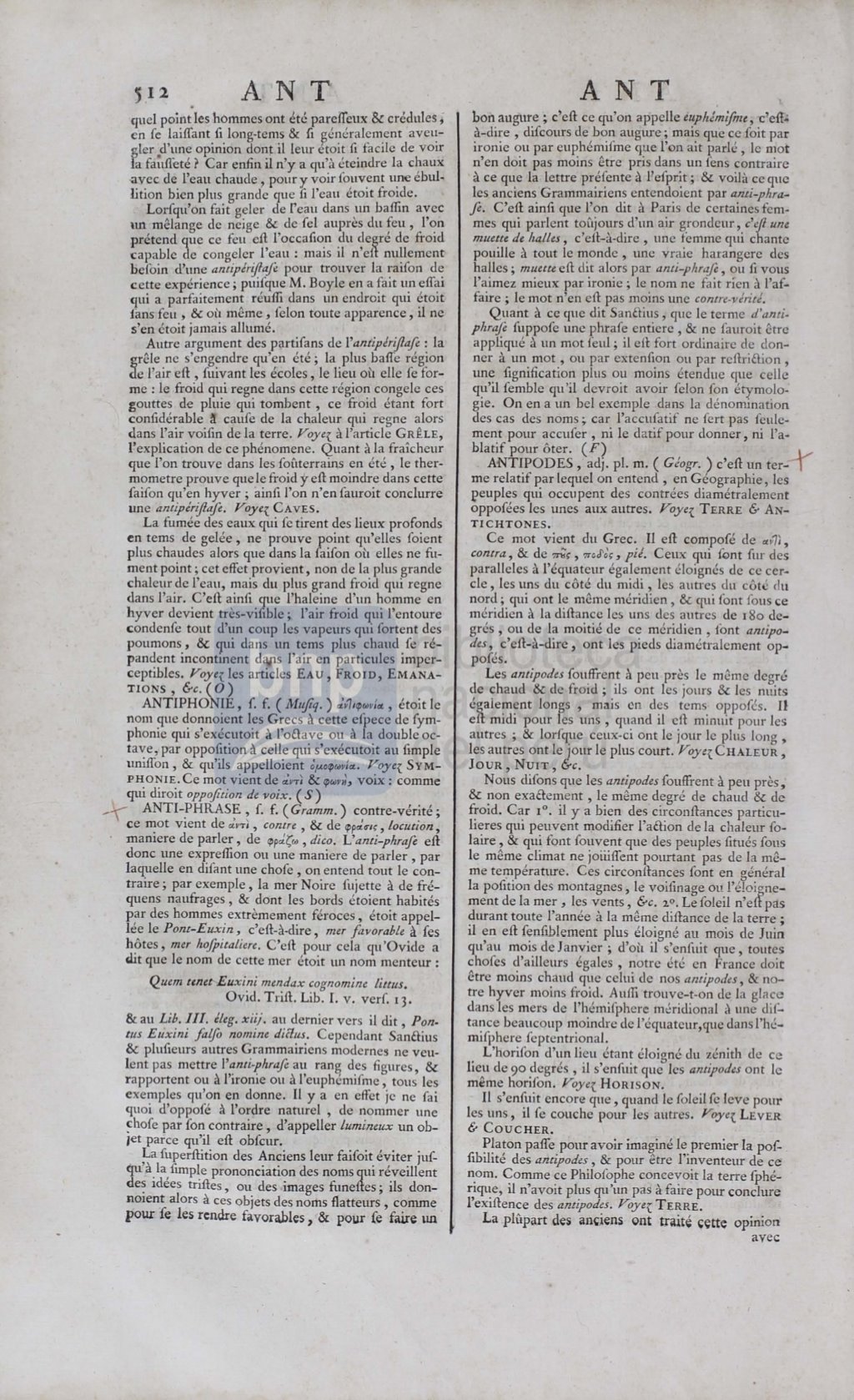
ANT
quel pOlnt'!eshommes ont été pareiTeux
&
créd111es;
en fe laiífant fi long-tems
&
ú
~énéralement avel~gler d'une opinion dont il leur etoit ú facile de VOlr
la
fa~líleté?
Car enfin il n'y a qu'a éteindre la chaux
-avee de l'ean chaude, pouryvoir
fouv~nt
u.neébul–
lition bien plus grande que ú l'eau ét01t fr01de.
L01{qu'on fait geler de reau dans un baffin avec
\ID
melange de neige
&
de fel aupres du feu, I'<?n
pIétend que ce feu eft l'oecaúon du degré de frold
capable de congeler l'eau ; mais il n'eíl nullemenr
befoin d'une
antipérif!aft
ponr trouver la
~'aifon d~
cette expérience; ptllrque
M.
Boyle en a !a¡t u.n
;íf~l
qui a parfaitement reuffi dans un endr01t qm et01t
fans fen ,
&
Oll meme, felon toute apparence, il ne
s'en
étoit jamais
allumé.
Autre argument des partifans de l'
antipérijlafe
;
la
grele ne s'engendre qu'en été; la plus baífe région
de I'air eíl , fuivant les écoles , le lieu ou elle fe for–
me ; le froid qui regne dans cette région congele ces
gouttes de pluie qui tombent, ce froid étant fort
confidérable
~
caufe de la chaleur qui regne alors
dans I'air voiún de la terreo
Voye{
a l'article GRhE,
l'explication de ce phénomene. Quant
a
la fraicheur
que I'on trouve dans les foflterrains en été , le ther–
mometre prouve que le froid
y
eíl moindre dans cette
faifon qu'en hyver ; ainú I'on n'en fanroit conclurre
une
antipérijlafe. Voye{
CAVES.
La fumée des eaux qui fe tirent des [jeux profonds
en tems de gelée, ne prouve point qu'elles foient
plus chaudes alors que dans la faifon oh elles ne nl–
ment point; cet effet provient, non de la plus grande
chaleur de l'eau, mais du plus grand froid qui regne
dans l'air. C'eft ainfi que l'haleine d'un homme en
hyver devient tres-viúble; l'air froid ql.1i l'entouTe
condenfe tout d'un coup les vapeurs qui fortent des
poumons,
&
c¡ui dans lID tems plus chaud fe ré–
pandent incontment da¡¡s l'air en particules imper–
ceptibles.
Voye{
les articles EAU, FROID, EMANA–
TIONS ,
&c.
(
O )
ANTIPHONIE, f. f.
(M¡ifiq.
)
d.11~",vf<t,
étoit le
nom que donnoient les Grecs a cette efpece de fym–
phonie qui s'exécutoit a I'oélave ou a la double oc–
tave, par oppofition a celle qui s'exécutoit au limpIe
lInillon,
&
qu'ils appelloient
o¡.<.o'P",.f<t.
Voye{
SYM–
PHONIE. Ce mot vient de
dVT)
&
~"'VI;,
voix; comme
qui diroit
oppoftion de voix.
(S)
_~
ANTI-PHRASE, f. f. (
Gramm.)
contre-vérité;
ce mot vient de
d.7)
,
contre
,
&
de
IPp.l.l1'l~
,
locudon,
. maniere de parler, de
IPp.l.?;",
,
dico.
L'
anti-phrafe
eíl
done une exprefIion ou une maniere de parler , par
laquelle en difant une chofe, on entend tout le con–
traire; par exemple, la mer Noire fujette a de fré–
quens nanfrages,
&
dont les bords éroient habités
par des hommes extremement féroces, étoit appel–
lée le
Pont-Euxin,
c'eíl-a·dire,
mer favorable
a fes
h?tes,
mer ho./pitaliere.
C'eíl pour cela qn'Ovide a
dit que le nom de cette mer étoit lID nom menteur ;
Quem ttnet-Euxini mendax cognomine littus.
Ovid. Trill. Lib.
r.
V.
verf.
!J.
&
au
Li~.
!II.
éleg. xiij-
al~
dernier vers il dit ,
Pon.
tus EUXWl
folfo
nonune dlallS.
Cependant Sanél:ius
&
plnfienrs autres Grammairiens modernes ne veu–
lent pas mettre
I'anti-phrafe
au rang des figures
&
rapportent ou a I'ironie ou a l'euphémifme, tou; les
exemples qu'on en donne.
II
y
a en effet je ne fai
quoi
d'oppofé
a
I'ordre naturel , de nommer une
~hofe
par fon contraire, d'appeller
lumineux
un ob–
jet parce qu'il eíl: obfcur.
La fuperftition des Anciens leur faifoit éviter juf–
qu
'a.la,íimple prononciation des noms qui réveillent
de~
Idees trilles, ou des images nmeíl:es; ils don–
nOlent alors
a
ees objets des noms flatteurs , conune
pOUI
fe
les rendre favorables,
&
pOllr
Ce
faire
un
ANT
bon aughre ; c'eíl: ce qu'on appelle
euphémifme,
-c'eff..:
a-dire , difcours de bon augLU'e;
mais
que ce foit par
ironie ou par euphémifme que l'on ait parlé, le mot
n'en doit pas moins etre
pris
dans un fens contraire
a ce que la lettre préfente a
I'efprit;
&
voila ce que
les anciens Grammairiens entendoient par
anti-phra–
fe.
C'eíl: ainfi que 1'0n dit a Paris de
certaines
fem·
mes qui parlent tOlljOurS d'un air grondenr,
c'eji une
muette de halles,
c'eft-a-dire, une femme qui chante
pouille a tout le monde , une vraie harangere des
halles;
muette
eíl: dit alors par
anti--phr<ife,
ou fi vous
I'aimez
mieux par ironie; le nom ne fait ríen
a
I'af–
faire; le mot n'en eíl: pas moins une
contre·vérité.
Quant
a
ce que dit Sanél:ius , que le temle
d'ami–
phrafe
fuppofe une phrafe entiere ,
&
ne fauroit etre
appliqué
a
un mot feul; il eíl: fort ordinaire de don–
ner a un mot , ou par extenfion on par reíl:riél:ion ,
une fignification plus ou moins étendue (Iue celle
qu'il femble qu 'il devroit avoir felon fon étymolo–
gie. On en a un be! exemple dans la dénomination
des cas des noms; car l'accufatif ne fert pas feule.
ment pour accufer , ni le datif pour donner, ni l'a-
blatif pour otero
(F)
Y
ANTIPODES, adj. pI. m. (
Géogr.
)
c'eíl: un ter-- '
me re1atif par lequel on erltend , en Géographie, les
peuples qui occupent des contrées diamétralement
oppofées les unes aux autres.
Voye{
TERRE
&
AN–
TICHTONES.
Ce mot vient du Grec.
11
eíl: compoCé de
"v1l,
contra,
&
de
m~, 7r.J'~~,
pié.
Ceux qui font fuI' des
paralle1es a I'équatenr également éloignés de ce cer–
ele, les uns du coté du midi , les aun-es du coté du
nord; qui ont le meme méridien,
&
qui font fous ce
méridien
a
la diíl:ance les uns des antres de
180
de–
grés , ou de la moitié de ce méridien , font
antipo–
des,
c'eíl:-a-dire, ont les pieds diamétralement op–
pofés.
Les
antipodes
fouflTent
a
peu pres le meme degré
de chaud
&
de froid ; ils ont les jours
&
les múts
également longs ,
mais
en
des tems oppofés.
n
eíl: midi ponr les uns , quand il eft minuit pour les
autres ;
&
lonque ceux-ci ont le jour le plus long,
les autres ont le jonr le plus court.
Voye{
CHALEUR,
JOUR, NUIT ,
&c.
NOllS difons que les
antipodes
fouffi-ent
a
pen pres,
&
non exaélement , le meme degré de chaud
&
de
froid. Car
l°.
il
Y
a bien des circoníl:ances particu–
lieres qui peuvent Il)odifier l'aétion de la chalem fo–
Iaire ,
&
qui font fonvent que des peuples fitués fons
le meme
c1imat
ne joiüífent ponrtant pas de la me–
me tel!Jpératnre. Ces circoníl:ances font en général
la pofition des montagnes, le voifinage ou l'é!oi,¡¡ne–
ment de la mer , les vents,
&c.
2°.
Le foleil n'ett pas
dnrant toute I'année a la meme diftance de la terre ;
il en eíl: feníiblement plus éloigné au mois de Juin
qu'au mois de Janvier ; d'ol!
il
s'enfitÍt que, toutes
chofes d'ailleurs égales , notre été en France doit
etre moins chaud que celui de nos
antipodes,
&
no–
tre hyver moins froid. Auffi trouve-t-on de la glace
dans les mers de l'hémifphere méridional
¡\
une dif–
tance beaucoup moindre de I'équateur,que dansl'hé–
mifphere feptentrional.
L'horifon d'un lieu étant éloioné du zénith de ce
lieu de 90 degrés , il s'enúút queOles
antipodes
ont le
meme horifon.
Voye{
HORISON.
II
s'enfuit encore que, quand le foleilfe leve pour
les uns, il fe couche pour les autres.
Voye{
LEVER
&
COUCHER.
Platon paífe pour avoir imaginé le premier la pof–
fibilité des
antipodes
,
&
pour etre l'inventenr de ce
nomo Comme ce Philofophe coneevoit la terre fphé–
rique,
il
n'avoit plus qu'un pas
a
faire pour conclure
l'exiftence des
antipodes. Voye{
TERRE.
La plflpart des an,.iens
ont
¡¡aité
,ette
opinion
avec
















