
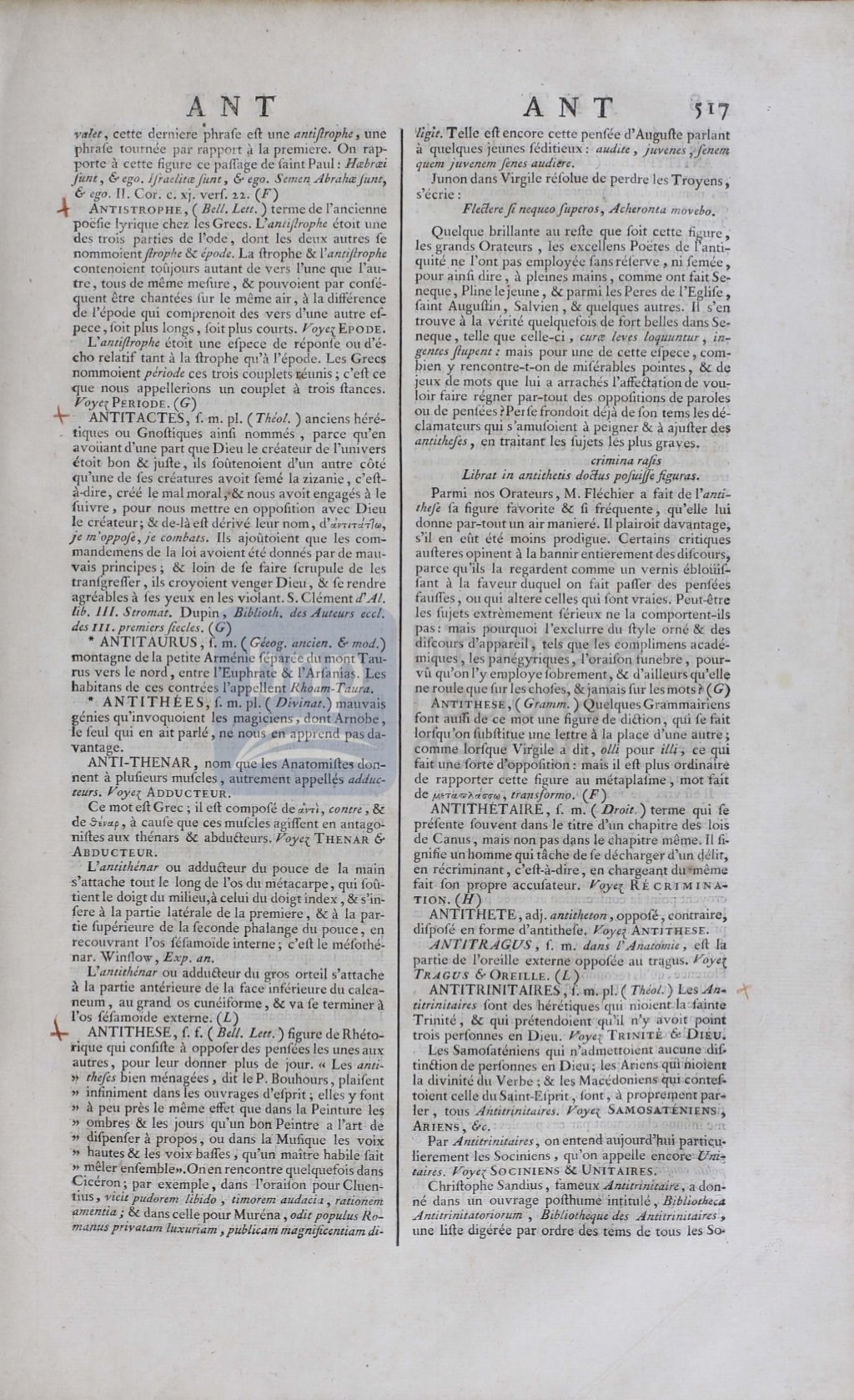
ANT
lIfllet,
cette dernicre phrafe e11: une
antijlrophe,
une
phraCe tOllrnée par rappoJt
a
la premiere. On Tap–
porte
a
cette figure ce paffage de {aint Paul:
Habrcl!Í
jimt,
&
ego. lJi"adillEjunt,
&
ego. Semen,. Abrahajimt,
&
ego.
n.
Coro
C.
xj. ver{.
22.
(F)
.t
ANTISTROPHE,
(Beli. Lea.
)
terme de I'ancienne
poe{ie Iyrique chez les Grecs. L'
antijlroplte
étoit une
des trois parties de l'ode, dont les deux autrcs fe
nommoientftroplte
&
épod~.
La 11:rophe
&
l'
antijlroplze
contenoiem totljoms autant de vers I'une que l'au–
tre, tOllS de meme meCure,
&
pouvoient par confé–
quent etre chantées fUT le meme air , a la différence
de l'épode 'luí comprenoít des vers d'lUle autre
eC–
pece, foit plus longs, foit plus COurts.
Yoye{
EpODE.
L'antijlroplte
étoit une efpcce de Téponfe ou d'é–
eho relatif tant
a
la fuophe qu'a I'épode. Les Grecs
nommoient
période
ces trois cOllplets J:éunis ; c'e11: ce
>CJUe nous appellerions un couplet
a
troís íl:ances.
Yoye{PERlODE. (G)
-\- ANTlTACTES, f. m. pI.
(Tlziol.
)
anciens héré–
tiques ou Gnofriques ainli nommés, parce qu'en
avoiiant d'une part que D ieu le créateur de l'univers
étoit bon
&
ju11:e, ils fOl1tenoient d un autre coté
qu'une de fes créatures avoit femé la zizanie, c'eíl:–
a.rure, créé le mal moral
,&
nous avoit engagés a le
fuivre, pour nous mettre en oppolition avec Dieu
le créa,tellr;
&
de-la e11: dérivé lem nom, d'
d"rlTdT1""
je m'oppofl,je combats.
Ils ajol1toient que les com–
mandemens de la loi avoient été donnés par de mau–
vais príncipes;
&
loin de fe faire fcmpule de les
tranfgreffer, ils croyoient venger Dieu,
&
fe rendre
agréables
a
fes yeux en les violant, S. Clément
d'AI.
lib.
1/1.
Stromat.
Dupin,
Bibliotlz. des Auteurs ecel.
des
llI.
premiersjiecles. (G)
*
ANTlTAURUS,
L
m.
(Gieog. anden.
&
mod.)
montagne de la petite Armél1le Céparée du montTau–
rus vers le nord, entre l'Euphratc
&
l'Arfanias. Les
habitans de ces contrées l'appeUent
Rlzoam-Taura.
*
ANTITHÉES, f. m. pI.
e
Divinal.)
mauvais
génies qu'invoquoient les )11agiciens, dont Arnobe,
le feul quí en ait parlé, ne nous en apprend pas da–
vantage.
ANTI-THENAR, nom que les Anatomiíl:es don–
nent
a
plulieurs mufcles , autremem appellés
adduc–
teurs. Yoye{
ADDUCTEUR.
Ce mot e11: Grec ; il e11: compoCé de
dVT),
contre,
&
de
~:Vct.p,
a
caufe que ces mufcles agiffent en antago–
niíl:es aux thénars
&
abduéteurs.
Yoye{
THENAR
&
ABDUCTEUR.
L'antitlzénar
ou adduéteur du pouce de la main
s'attache tout
le
long de l'os du métacarpe, qui fOll–
tient le doigt du milieu,a celui du doigt index ,
&
s'in–
fere a la partie latérale de la premiere,
&
a
la par–
tie fupérieure de la feconde phalange du pouce, en
recouvrant I'os féfamolde interne; c'eíl: le méfothé:
nar. Win(low,
Exp. ano
L'anútlzénar
ou adduéteur du gros orteil s'attache
a
la partie antérieure de la face inférielue du calca–
neum, au grand os clméiforme ,
&
va fe terminer
a
\ 1'05
féfamo"ide externe.
eL)
+-
ANTITHESE, f. f.
(Bell. Let!.
)
figure de Rhéto–
rique qui confiíl:e
a
oppofer des penfées les unes aux
autres, pour lenr donner plus de jour.
«
Les
anti–
" thefes
bien ménagées, dit le P. BouhoLUS, plaiCent
" infiniment dans les ouvrages d'efprit; elles y font
" a
peu pres le meme e!fet que dans la Peinulre les
" ombres
&
les jOLUS qu'un bon Peintre a I'art de
" difpen[er
a
propos, ou dans la Mufique les voix
" hautes
&
les voix baffes , qu'un maltre habüe rait
"
~eler
enfemble".On en rencontre quelquefois dans
~lcéro~?
par exemple, dans I'orailon pour Cluen–
tLUS,
~tCLt
pudorem libido, tÍmorem audacia, rationem
fLTlltnua;
.&
dans celle pour Muréna,
odie populus Ro–
maflUS prl'l'alam luxuriam, pubücam magnijicemiam di-
Iligz't.
Telle e11:encore cette penfée d'Auguíl:e parlant
a quelques jeunes féditieux;
audite, juyenes ,flnem
<¡ILem juvenem fines audiere.
Junon dans Virgile réfolue de perdre les Troyens,–
s'écrie;
Fleélere ji nequeo jitperos, Acheronta movebo.
Qllelque brillante an reíl:e que foit cette figure,
les grands Oratems , les excellens POeteS de I'anti–
quité.neI'ont pas employée fans rélerve , ni remée,
pour ainli dire, a pleines mains, comme ont fait Se–
neque, Pline le jeune,
&
parmi les Peres de I'Eglife ,
faint Augufrin, Salvien,
&
quelques autres. 11 s'ell
trouve a la vérité Cfllelquefois de fort belIes dans Se–
neque, telle que ceUe-ci,
cune
(~ves
l0'luunrur, in.,.
gentes ftupent:
mais pour une de cette eCpece, com–
bien y rencontre-t-on de miférables pointes,
&
de
jeux de mots que lui a arrachés l'afFefration de vou–
loir faire régner par-tout des oppolitions de paroles
ou de penl"ées
?
Perfe frondoit déja de Con tems les dé–
clamateurs qui s'amuCoient a peigner
&
a ajuíl:er des
antitltefes,
en traitant les fujets les plus graves.
crimina rafis
Librat in antithetis doélus pofuiffo
figur~.
Parmí nos Orateurs,
M.
Fléchier a fait de
l'anti–
tltefe
fa figure favorite
&
li fréCfuente, qu'elle lui
donne par-toutun air manieré.
11
plairoit davantage,
s'il en eút été moins prodigue. Certaíns critiques
aufieres opinent
a
la bannir entierement des difcours,
parce qu'ils la regardent comme un vernis ébloiiif–
fant a la faveur dUCfllel on fait paffer des penfées
fauffes, ou qui altere celles Cflli fónt vraies. Pellt-etre
les fujets extremement férieux ne la comportent-üs
pas: mais pourquoi l'exclurre du fiyle omé
&
des
diCcours d'appareil, tels que les complimens acadé–
miCflles, les panégyriCflles, I'oraifon funebre, POLU–
vú Cfll'on I'y employe {obrement,
&
d'aiUeLUs qu'eUe
ne roule que (m les chofes,
&
jamais fllT les mots?¡
(G)
ANTITHESE,
(Gramm.)
QuelquesGrammairiens
font aulú de ce mot une figure de diétion, qtii fe fuit
lorfqu 'on fubíl:itue une le.ttre a la place d'une autre;
comme lorfqtle Vir"gile
a
dit,
ollí
pOlU
illi,
ce
c¡ui
fait une forte d'oppolition: mais il eíl: plus ordinalf(¡:
de rapporter cette figure au métaplaline, mot faít
de
P.'TeI.,.,A..:.....'"
,trallsjormo. (F)
ANTlTHÉT
AIRE,
f.
m. (
Droit.)
terme qui fe
préfente fouvent dans le titre d'un chapitre des loís
de Canus, mais non pas dans le chapitre ml\me.
11
li.
gnifie un homme qui tache de fe décharger d'un c!élit,
en récriminant, c'eíl:-a-dire, en chargeant du 'meme
fait fon propre acclúateur.
Yoye{
RÉ CR
1M 1N
A.
TION.
eH)
. -
ANTITHETE, adj.
antitqeton,
oppofé ?aontraire,
difpofé en forme d'antithefe.
Yoye{
ANTl"fHESE.
ANTITRAC,PS,
f.
m.
dans l'Anatomie,
efi la
partie de l'oreille externe oppofée au m¡gus.
Yoye{
TRAGUS
&
OREILLE.
eL)
-
.
~T!TRrNITA1R~S,'
.r.
m.
1'1.
.~ T.h~ol.
)
Les
-,!,n~
ttmmtatres
font des heretiques
CJ.111
11l01ent.l~~f~t~
Trinité,
&
qui prétendoient qu'il n'y
aVOl~
pomt
trois perConnes en Dieu.
Voyet
TRINITE"
t;,.'UIEU.
Les Samofaténiens qui
n'admettoi~nt au~~e :diG
tinilion de perfonnes en Dieu; les Aplens
<1m
molent
la divinité du Verbe ;
&
les
M
acédoniens qt¡.Í cónte[–
toient celle du Saint-El"prit_
L
(ont,
a.
propr~r¡~ent par~
ler, tous
Antitrinitaires.
Yoy.etSAMosAinENIENS ,
ARIENS,
Cre.
-
. Par
Antilrinitaires,
on entend
at1jourd'~ui
partic;.u.
lierement les Sociniens , qu'on appelle enaore
'lhti
1
taires. Yoye{
SOCINIENS
&
UNITAIRES.
Chrifiophe Sandius, fameux
Antitrinitaire,
a d0n–
né dans un ouvrage po11:hume "intimlé,
Bibliot1t:eca
AntitrinÍtatoriorum
,
Bibliotlze'lue des
Antitrinitair.es,
lme li11:e digérée par ordre des tems de tous les SO'
















