
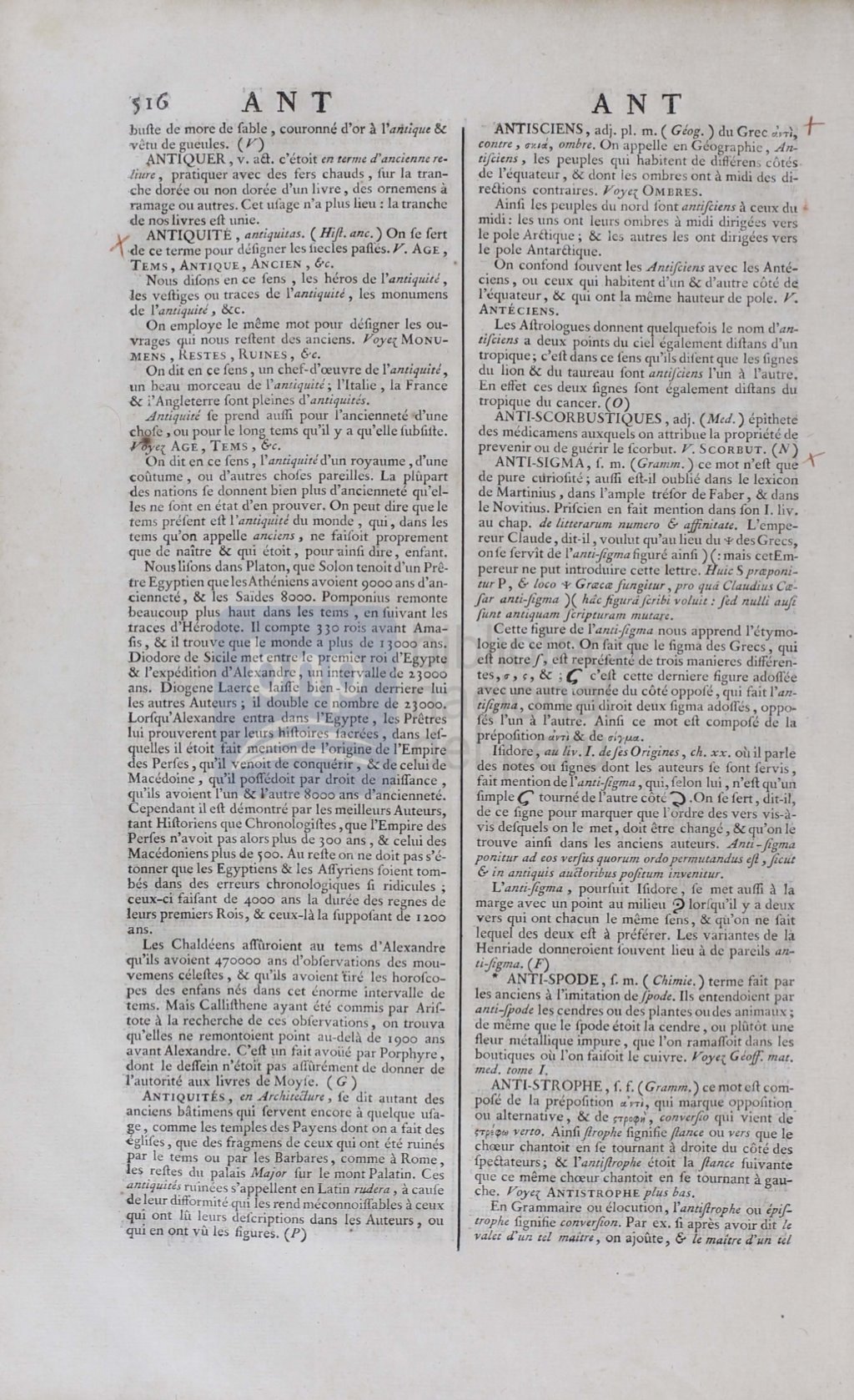
ANT
buae
de more de fable, couronné d'or:a
l'afitique
&
'Vetu
de gueuJes.
(V)
.ANTIQUER, v. atl. c'étoit
en
terme d'ancienne re–
Jiure,
pratiquer avec ,des,fers.chauds , fur la
tran~
che dorée ou non doree d un hvre, des ornemens a
ramage ou autres. Cet ufage n'a plus líeu ; la tranche
de nos livres ea unie.
ANTIQUITÉ,
antiquitas. (Hift. anc)
On fe fert
A
·de ce terme pour défigner les Ílecles paíles.
V.
AGE ,
TEMS, ANTIQVE, ANClEN,
&c',
,.. ,
Nous difons en ce fens , les heros de 1
anllqmle ,
les veiliges on traces de l'
antiquilé,
les monumens
.de
l'antiquid,
&c.
On employe le meme mot
p~ur
défigner les ou–
vrages CJui nous reíl:ent des anClens.
Voye{
MONV-
MENS , RESTES, RUINES,
&c;
,. .,
On dit en ce fens , un chef-d oeuvre de 1
anllquue,
un beau morceau de l'
antiquité;
1Italíe , la France
&
i'Angleterre font pleines
d'anti'luités.
Antiquité
fe prend auffi pour J'ancienneté d'une
chofe , ou ponr le long tems qu'il y a qu'elle fubfute.
J-1'ye{
AGE, T EMS ,
I?c,.
. "
,
On dit en ce fens , 1
antu¡lllte
d un royaume ,d une
coutume ou d'autres chofes pareilles. La plupart
des
natio~s
fe donnent bien plus d'ancienneté qu'el–
les ne font en état d'en prouver. On peut clire que le
tems préfent
ea l'antiquité
du monde , qui, dans les
tems qu'on appelle
anciens,
ne faifoit proprement
que de naitre
&
qui étoit, pour ainfi clire, enfant.
Nouslifons dans Platon, que Solon tenoitd'un Pre–
tre Egyptien quelesAthéniens avoient
9000
ans d'an–
cienneté,
&
les Saldes
8000.
Pomponius remonte
beaucoup plus haut dans les tems , en fuivant les
traces d'Hérodote. 11 compte
330
rois avant Ama–
fis ,
&
il trouve que le monde a plus de
13000
ans.
Diodore de Sicile met entre le premier roi el'Egypte
&
l'expédition d'Alexandre, un intervalle de
23000
ans. Diogene Laerce lai{[e bien -loin elerriere lLú
les autres Auteurs ; il double ce nombre de
23000.
Lorfqu'AJexandre entra dans l'Egypte, les Pretres
h,i prouverent par leurs hifl:oires facrées, dans lef–
quelles il étoit fait mention de l'origine de l'Empire
¿es Perfes ,qu'il venoit de conquérir,
&
de cehú ele
Macédoine
J
qu'il poífédoit par droit ele naiífance ,
qll'ils avoient l'un
&
I'autre
8000
ans d'ancienneté.
Cependant il eíl: démontré par les meilleurs Auteurs,
tant Hiíl:oriens que Chronologifl:es, que l'Empire des
Perfes n'avoit pas alors plus de
300
ans,
&
celui des
Macédoniens plus de
500.
Au reíl:e on ne doit pas s'é–
tonner que les Egyptiens
&
les A{[yriens foient tom–
bés dans des erreurs chronologiqlles fi ridicules ;
ceux-cí faifant de
4000
ans la durée eles regnes de
leurs premiers Rois,
&
ceux-la la fuppofant de
1200
ans.
Les Chaldéens aíftlroient al! tems d'Alexandre
qu'ils avoient
470000
ans d'obfervations des mou–
vemens céleaes ,
&
qu'ils avoient tiré les horofco–
pes des enfans nés dans cet énorme íntervalle de
tems. Mais Callillhene ayant été commis par Arif–
tote a la recherche de ces obfervations, on trouva
qu'elles ne remontoient point au-dela de
1900
ans
avant Alexandre.
C'ea
un fait
avoi.iépar Porphyre ,
dont le de{[ein n'étoit pas a{[llrément de donner de
'l'autoríté aux livres de Moyfe.
(G)
ANTIQUITÉS,
en
Architeélure,
fe dit autant des
anciens M.timens qtú fervent encore
a
quelque ufa–
ge, comme les temples des Payens dont on a fait des
-églifes, que des fragmens de ceux qui ont été ruinés
par le tems ou par les Barbares , comme aRome,
-les refl:es du palais
Major
fur le mont Palatino Ces
antiquilé~
ruinées s'appellent en Latin
rudera,
a
caufe
de leLLr difformité qui les rend méconnoiífables a ceux
qui ont lfl leurs defcriptiono dans les Auteurs, ou
qui en ont vu les figures.
(P)
•
ANT
'ANTISCIENS, adj. pI. m. (
Glog.
)
dn Grec
d'Tl,
+–
contre,
"",,1,
ombre.
On appelle en Géographic,
Ano
tiftiens,
les peuples qllÍ habitent de difl'érens cotés
de l'équatem,
&
dont les ombres ont a midi des di–
reaions contraires.
Voye{
OMERES.
Ainfi les peuples du nonl font
antiftiens
a
cenx du
midi : les uns
0111
lenrs ombres
a
rnidi clirigées vcrs
le pole Artlique;
&
les autres les ont dirigées vers
le pole Antaraique.
On confond {ouvent les
Antiftiens
avee les Anté–
ciens, on ceux qui habitent d'un
&
d'autre coté de
l'équatcur,
&
'luí ont la meme hauteur de poleo
V.
ANTÉCIENS.
~es
Afuologues donnent quelquefois le nom
d'an–
ti[mns
a deux points du ciel également diíl:ans d'un
tropique;
c'ea
dans ce fens qtl'ilsditent que les fignes
du hon
&
dn taureau [Ont
antifciens
l'un
a
l'auu·e.
En effet ces deux fignes font également dillans du
tropique du cancer.
(O)
ANTI-SCORBUSTIQUES, adj.
(Med.)
épithete
des médicamens auxqtlels on attribue la propriété de
prevenir OLl de guérir le fcorbu
t.
V.
SCOREUT.
(N)
.v-
ANTI-SIGMA, f. m.
(Gramm.)
ce mot
n'ea
qtle .,
de pure curiofité ; auffi ea-il oublié dans le lexicon
de Martinius, dans l'ample tréfor de Faber,
&
dans
le Novitius. Prucien en fait mention dans fon 1.1iv.
au chapo
de Liueramm numero
&
affinil4le.
L'empe–
rem Claude, dit-il, voulut qu'au lien du
'i'
des Grecs,
onfe fervlt ae
l'antifigmaliguré
ainfi) (;mais cetEm–
pereur ne put inu'oduire cette lettre.
H uic
S
pr{2poni-
lur
P,
&
loco
..¡..
Gr{2c{2 fungitur ,pro qua Claudius C(J!-
far anti-jigma
)(
hacfigurafcribi voluit
:
fed nulli azifi
fitnl antiquam j"cripluram mUlare.
Cette figure de
l'antifigma
nous apprend l'étymo–
logie de ce moto On fait <fue le tigma des Grecs, qttÍ
eíl: notre
j",
eíl: repréfente de trois manieres différen–
tes, '"
~,
& ;
e
e'eíl: cette derniere figure adoífée
avec une autre lomnée du coté oppofé , qui fait l'
an–
lifigma,
comme qui diroit deux figma adolfés , oppo–
fés l'un a l'autre. Ainfi ce mot
ea
compofé de la
prépofition
el'TI
&
de
,,1)'fUL.
lfidore,
41t liv.
l.
dejes Origines
,
ch.
xx.
oll il parle
des notes ou fignes dont les auteurs fe [ont fervis,
fait mention de
l'antifigma,
qtlÍ, felon lui , n'eíl: qu'lIn
funple
e
tourné de l'aurre coté:) .On fe fert, dit-il,
de ce figne pour marquer qtle l'orill'e des vers vis-a–
vis defquels on le met, doit erre changé,
&
qu'on le
trouve ainfi dans les anciens auteurs.
Anti-figma
poniwr ad eos veryits quorum ordopermulandus
ifl
,ficla
&
in antiquis aItaoribus pojitum inyenitur.
L'antifigma,
pourfuit Ifidore, fe met allffi a la
marge avec un point an milíell
~
lorfqu'il y a deux
vers qui ont chacun le meme fens,
&
qu'on ne fait
lequel des deux
ea
a préférer. Les variantes de la
Henriade donneroient fOLlvent lieu
a
de pareils
an–
tifigma.
(F)
.. ANTI-SPODE, f. m. (
Chimie.
)
terme fait par
les anciens a I'imitation
dejpode.
Ils entendoient par
anti-JPode
les cendres ou des plantes oudes animaux;
de meme que le fpode étoit la cendre, ou plllrot une
fleur métallique impure, que l'on rama{[oit dans les
boutiques olll'on faifoit le cuivre.
Voye{ Géoff. mato
medolome
I.
ANTI-STROPHE, f. f.
(Gramm.)
cemotea com–
pofé de la prépoútion ...
"T),
qui marque oppofition.
OL! aJternative,
&
de
~TpOtp.' ,
conYepo
qui vient de
~Tp:~'"
VerlO.
Ainfi
Jlrophe
fignifie
flance
ou
vers
qtle le
ChreLLr chantoit en fe tournant a droite du coté des
fpetlateurs;
&
l'antijlrop/le
étoit la
Jlance
fuivante
qtle ce meme choeur chantoit en fe tournant a gau–
che.
Voye{
ANTISTROPHE
plus baso
En Grammaire ou élocution,
l'antiftrophe
on
'Pi!–
lrophe
fignifie
convepon.
Par ex. fi apres avoir dit
le
valel ¿'un
lel
mRitre,
on ajollte,
&
le
malere
d'un lel
















