
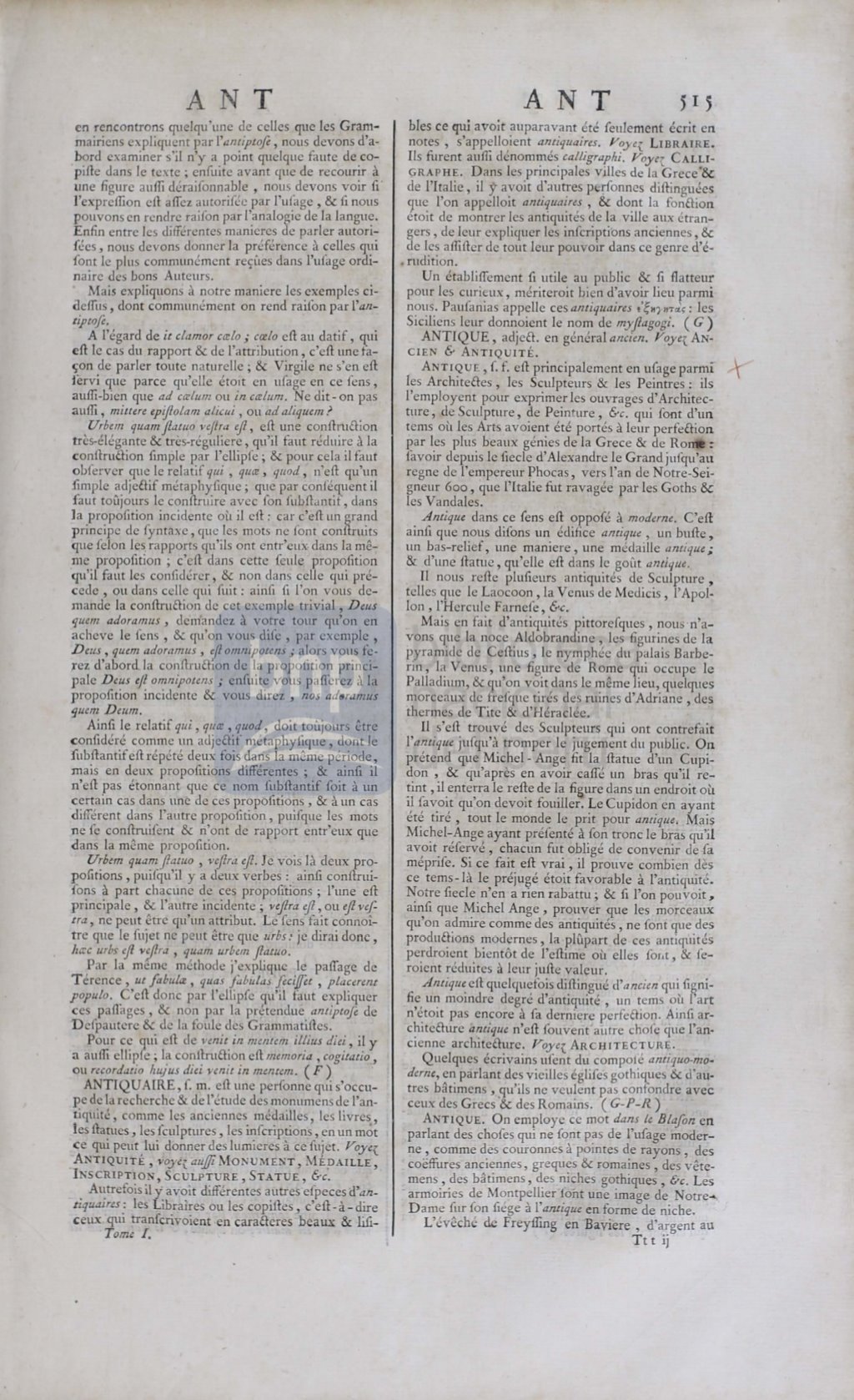
ANT
en rcncontrons quelqu'une de celles que les Gram–
mairiens expliquent par
l'an/plofo,
nOlls devons d'a–
bord examlner s'il n'y a point quelque faute de co–
pille dans le texte ; enfulte avant que de recourir a
une figure aulIi déraifonnable , nous devons voir fi
l'expreffion e/l: aírez 3utorifée par l'u(age ,
&
fi nous
pouvonsen rendre rai(on par l'analogie de la langue.
Enfin entre les ditTérentes manieres de parler alltori–
fées, nous devons donner la préférence a celles qni
fOnt le plus comnmnément re<;lles daos l'u[age ordi–
naire des bons Auteurs.
Mais
expliquoos
a
notre maniere les exemples ci–
aeífus, dont commllnément on rend raifon par
I'an–
Ii¡Jlofo·
A l'égard de
il clamor e1210; crelo
e/l: au datif, qui
efi le cas du Tapport
&
de I'attribution , c'efr une
fa–
c;on de parler toute nanlrelle ;
&
Virgile ne s'en
dI:
Jervi que paree qu'elle érolt en ufage en ce fens ,
aulIi-bien que
ad ca!lum
ou
in cl2lum.
Ne dlt-on pas
auffi ,
miaue epijlolam aLicui
,
ou
ad atiquem?
Urbem quamjlawo veJlra tjl,
efi une confrruaion
trcs-élégante
&
tres-réguliere, qu'il faut rédllire
a
la
coníl:rnüion flmple par l'ellipfe;
&
pour cela il faut
obfervcr (lne le relatif
qui
,
q/ll2, quad,
n'eil: qu'un
fimple adjeaif métaphyfique; que par conféC[llent il
faut toÍljOllTS le confuuire avec (on fubfl:antif, dans
]a propofition incidente oil
il
dI::
car c'ea un grand
principe de fyntaxe, que les mots ne lont confrrllits
que felon les rapports qu'ils ont entr'ellx·dans la me–
me propofiúon ; c'eil: dans cette (eule propofition
qu'il faut les confidérer,
&
non dans celle qui pré–
cede, ou dans celle qui fuit: ainfi fi l'on vous de–
mande la confrrnaion de cet exemple trivial,
Dws
que", adoraflllls,
derriandez
a
votre tour qn'on en
acheve le fens ,
&
qu'on vous dife , par exemple ,
Dtlts, qllem adoramus, ejlamrzipottns;
alors vous fe·
;rez d'aborclla confuuilion de la propofition princi–
pale
Deus eft omnipalens
;
enfuite vous paíferez
a
la
propofition incidente
&
vous direz,
nos ad"ramlls
'jlltmDeTlm.
Ainú le relatif
q/li
,
q/ll2
,
quad,
doit tOLljours etre
confidéré comme un adjeaif métaphyfique, dont le
fubil:antifefr répété deux fois dans la meme période,
mals en deux propofitions différentes;
&
alnfi il
n'eíl: pas étonnant que ce 110m fubfl:antif foit
a
un
cerrain cas dans uné de ces propoútions ,
&
a un cas
différent dans l'autre propoGtion, puifqlle les mots
ne [e conil:rulíi:nt
&
n'ont de rapport entr'eux que
dans la meme propofition.
Urbem 'luam jlamo
,
vejlra tjl.
Je vois
la
deux pro–
poútions, pui(qn'il y a deux veTbes: ainfi coníl:nú–
(ons
a
part chacune de ces propofitions ; l'une efr
principale,
&
l'autre incidente;
vtjlra
11,
ou
tjlvef
tra,
ne peut etre <¡u'un attribut. Le [ens fait connol–
tre que le fujet ne peut etre que
urbs:
je diral donc ,
ha:c
IIrbs tjlll1"a, quam urbem jlatllo.
Par la meme méthode j'expüque le paJfage de
Térence,
ut fobula, quas fabulas ftcif{et
,
plac~rent
populo.
C'eíl: donc par I'ellipfe qu'il faut expliquer
ces pallages,
&
non par la prétendue
antiplOj¿
de
De(pautere
&
de
la
foule des Grammatifies.
Pour ce qui eil: de
venil in menlem illius diei
,
il
Y
a auffi ellipfe ; la con1l:.métion efr
memoria, cogitalio
J
on
recordatio
Il/Ljus
diei venil in mentem.
(F)
ANTIQUAfRE,f. m. efiune perfonnequis'occu–
pe de la recherche
&
de I'émde des monllmens de 1'an–
riquiré, corome les ancienncs médailles, les livres,
le~
fl:ames, les fculptures , les infcriptions , en un mor
ce qni peut lui donner des lumieres
a
ce fuieL
Voye{
ANTlQUITÉ
1'oye{
aJtjJi
Mo UMENT, MEDAILLE,
1
'SCRIPTION, CULPTURE,STATUE,
&c.
Autrefois il
y
avoit différentes autres e(peces
d'an–
tiquairLf.:
les Libraires ou les copifres
J
c'eil: -
a-
clire
e
ux qtu tranfcriyoient en caraaeres
b
aux
&
lili–
Tome
I.
ANT
515
bIes ce
qul
avoit auparavant été feulement écrit en
notes, s'appelloient
antiq/laires. Vaye{
LIBRAIRE.
Ils nlrent aulIi dénommés
caltigraphi. Voye{
CALLI–
GRAPHE. Dans
les
principales villes de la Grece'&
de l'ltalie, il yavoit d'autres péponnes difl:inguées
911e l'on appelloit
antiquoires,
& dont la fonilion
etoit de montrer les antiquités de la ville ame étran–
gers, de leur expliquer
les
in[criptibns anciennes, &
de les affifrer de tout leur pouvoir dans ce genre d'é–
mdition.
Un établiífement ú utile au public
&
fi flatteur
pour les curieux, mériteroit bien d'avoir ¡¡eu p3lmi
nous. Pau{Í1nias appelle ces
antiquaires
'~W)
" ...
d~:
les
Siciliens leur donnoient le nom de
myjlagagi.
(G)
ANTIQUE, adjea. en général
anden. Voye{
AN–
ClEN
&
ANTIQU1TÉ.
ANTIQUE,
f.
f. eíl: principalement en u(age parmi
~
les Arcruteües, les Snúpteurs
&
les Peintres: ils
l'employent pour exprimer les ouvrages d'Arcrutee–
ture, de SClllpnlre, de Peinture ,
&c.
qui (ont d'un
tems
011
les Arts ayoient été portés
a
leur perfeétion
par
les
plus beal1x génies de la Grece
&
de Romt ;
[¡¡yoir depuis
le
fieele d'Alexandre le Grand jufql1'au
regne de I'empereur Phocas, vers l'an de Notre-Sei–
gneur 600, que l'halle fut ravagée par les Goths &
les Vandales.
Antique
dans ce fens efr oppofé
a
modeme.
C'eft
ainfi que nous di[ons un édifiee
anti'lue,
un bufre ,
un bas-relief, une maniere, une médaille
antiqlle;
&
d'une frattle, qu'elle eíl: dans
le
goCtt
antique.
Il
nous reil:e plllfieurs antiquités de Sculpmre ,
telles que le Laoeoon , la Venus de Mewcis, l'Apol–
Ion, l'Hercule Farnefe,
&.c.
Mais en fait d'antiqult¿s pittorefques, nou ·n'a–
vons que
la
noce Aldobranwne, les figurines de la
pyramide de Cefrius, le nymphée du palais Barbe–
rin, la Venus, une figure de Rome qui occupe le
Palladium,
&
qu'on voit dans le meme lieu, qllelques
morceaux de freícllle tirés des mines d'Aclriane , des
thermes de Tite
&
d'Héraclée.
Il
s'eíl: trollvé des Sculptellrs qui ont contrefait
l'
antiqlle
jufqn'a tromper le jugement du publico On
prétend que Michel- Ange fit la íl:anle d'un Cupi–
don,
&
qu'apres en avoir caífé un bras qu'il re–
tint , il enterra le refie de la figure dans un enclroit Ol!
il
[avoit qu'on devoit fouiller. Le Cupidon en ayant
été tiré, tout le monde le prit pour
antiqlle,
Mais
Michel-Ange ayant pré[enté a (on tronc le bIas ([u'il
avoit réfervé, chacun fut obligé de convenir de fa
méprife. Si ce fait eil: vral, il prouve combien
des
ce tems-Ja le
préju~é
étoit favorable a I'antiquité.
Norre uecle n'en a nen rabattu; & fi l'on p0uvoit,
ainfi que Michel Ange , pTouvér que les morceal1X
qu'on admire comme des antiquités, ne font que des
prodllaions roodernes, la plÍlpart de ces antiquités
pel-clroient bientot de l'eíl:ime Ol! elles [or.t,
&
[e–
roient réduites a leUT juí1:e valeur.
An/ique
efr ql1elqllefois difiingué d'
anden
qul
fi¡¡ni–
fie un moinclre degré d'antiquité , un teros Ol!
1
art
n'étoit pas encore a fa derniere perfeaion. Ain1i ar–
chiteaure
antique
n'eil: fOLlvent autre chofe que l'an–
cienne architeB:ure.
Voye{
ARCHITECTURJ;:.
Quelques écrivains ufent dll compoté
anti'lllo-mo–
deme,
en parlant des vieilles églifes gorhiques
&
d'au–
tres batimens, qu'ils ne veulent pas confondre avec
ceux des Grecs
.&
des Romains.
(G-P-R)
ANTIQUE. On employe ce mor
dans
Le
BlaJon
en
parlant des cho(es qui ne (ont pas de l'ufage moder–
De , comme des couronnes
a
poiotes de rayons, des
coeífures anciennes, greques
&
Fomaines , des vete–
mens, des batimens , des niches gotruques ,
&c.
Les
armoiries de Montpellier lont une image de Notre–
D ame fur fon íiége al'
anúqtLt
en
forme de niche.
L'éveché
de
Freyffing en Baviere , d'argent atl
Tttij
















