
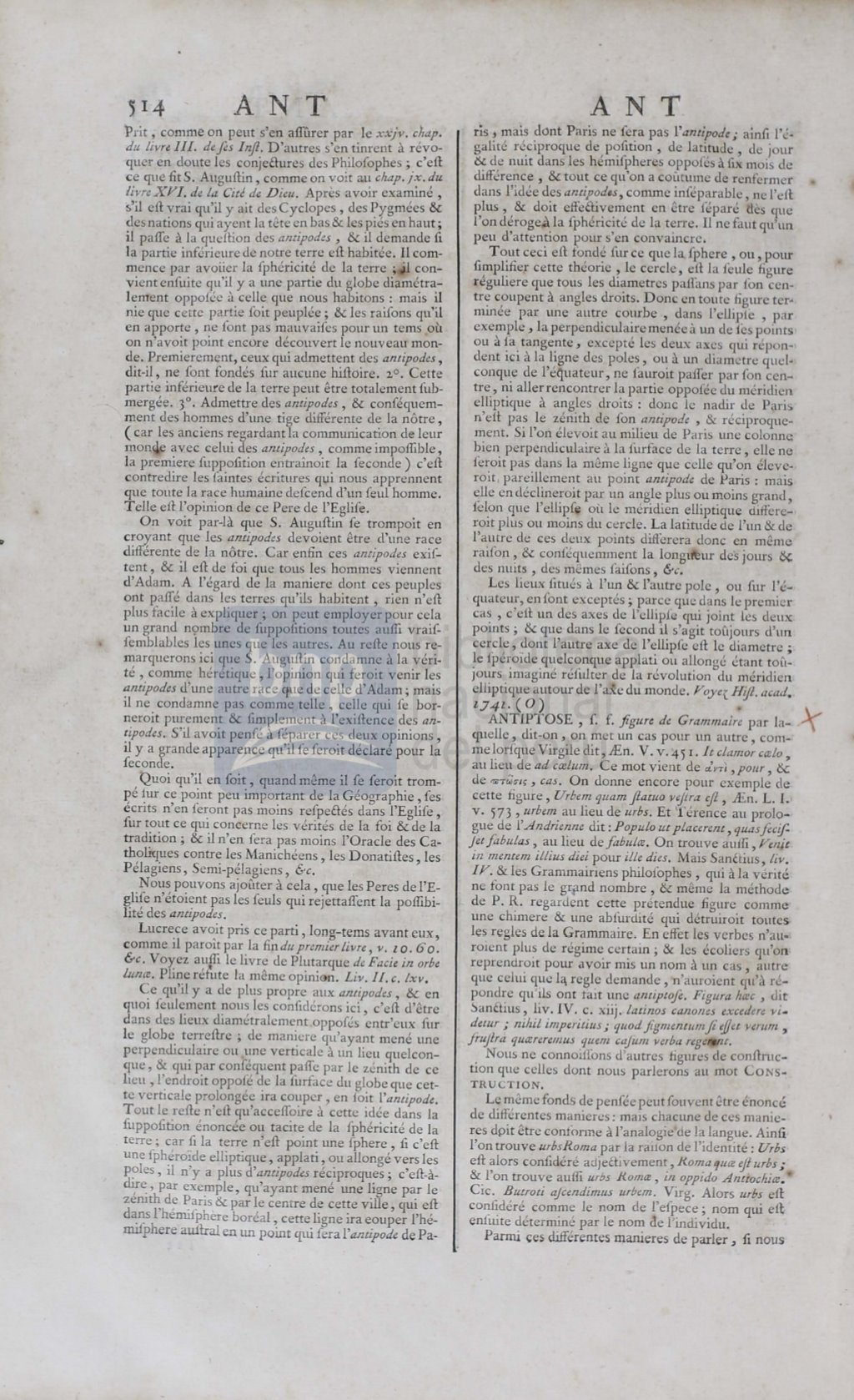
ANT
Prit, comme on peut s'en affilrer par le
xx/v. chapo
drt
livn
IIJ. defts Infl.
D'aurres s'en tinrent a révo–
quer en doute les conjeétures des Plúlofopbes ; c'eíl:
ce que fitS. Auguilin, comme on voit au
cluzp.
jx.
du
livre XPI.
d~
la Cité
de
Dielt.
Apres avoir examiné,
s'il eíl: vrai qu'il y ait des Cyelopes , des Pygmées &
desnations qui ayent la teteen bas& les piés enbaut;
il
paífe a la queíl:ion des
antipodes
,
&
il demande ú
la partie inférieure de nOrre terre eíl: habitée. Il com–
menee par avoiier la fphéricité de la terre
;;1
con–
vientenCuite qu'il y a une partie du globe diamétra–
lement oppofee
a
celle que nous habitons : mais il
nie que cette partie foit peuplée;
&
les raifons qu'i!
en apporte , ne font pas mauvaifcs pour un tems oll
on n'avoit point encore découvert le nouveau mon–
de. Premierement, ceux qui admettent des
antipodes,
dit-il, ne font fondés fur aueune biftoire.
2
0 •
Certe
partie inférieure de la terre peut etre totalement fub–
mergée. 3°. Admettre des
antipodes,
&
conféquem–
ment des hommes d'une tige différente de la notre ,
( car les anciens regardant la commUllÍcation de leur
monde avec celui des
antipodes,
comme impoilible,
la premiere úlppoútion entramoit la feconde) c'eíl:
contredire les (aintes écritures qui nous apprennent
que toute la race humaine defcend d'un {eul homme.
Telle efr l'opinion de ce Pere de l'Eglife.
On voit par-la que S. Auguilin fe trompoit en
croyant que les
antipod,s
devoient erre d'une race
différente de la notre. Car enfin ces
antipod(s
exif–
tent, & il efr de foi que tous les hommes viennent
d'Adam. A l'égard de la maniere dont ces peuples
ont paíTé dans les terres qu'ils habitent, rien n'eíl:
plus facile
a
expliquer ; on peut ernployer pour cela
un grand n,?mbre de fuppoútions tomes auili vraif–
femblables les unes que les autres. Au refre nous re–
marquerons icí 'F-e S. Augufrin condamne a la véri–
té, corume héreti'lue, l'opinion 'lui feroít venir les
antipodes
d'une autre race qtle de celle d'Adam; mais
il
ne condamne pas cornme telle , celle 'lui fe bor–
neroit pUJ"ement
&
úmplement
a
l'exiíl:ence des
an–
tipodes.
S'il avoit penfé a {éparer ces deux opinions ,
íl Ya grande apparence qu'il fe feroit déclaré pour la
feconde.
Quoi qu'il en foit, 'luandmeme il fe feroit trom–
pé
~ur
ce point peu important de la Géographie , fes
écnts n'en feront pas moins refpeétés dans l'Eglife,
{m tollt ce qui concerne les vérités de la foi
&
de la
tradition; & il n'en fera pas moins 1'0racle des Ca–
tholi(Jues contre les Manichéens , les Donatifres les
Pélagiens, Serni-pélagiens,
&c.
'
Nous pouvons ajoíher a cela, que les Peres de l'E–
glife n'étoient pas les feuls
qui
rejettaífent la poffibi–
lité des
antipodes.
Lucre.ceav~it
pris ce parti, long-tems avant eux,
comme il parOltpar la
fin
dltpremierliyre
,
v.
lO.
60.
&c.
Voyez auffi le livre de Plutarque
deFacie in orbe
fume.
Pline réfute la
m~me
opini(}n.
Liv.l1. c. ¡xv.
~e
qu'il y a de plus propre
~llX
antipodes,
&
en
qUOl feulement nous les conúderons ici c'eft d'etre
dans des lieux diamétralement.oppofés 'enrr'eux fm
le globe. terr.efue ; de
man~ere
qu'ayant mené une
perpendicullllre ou une vertlcale
a
lm lieu quelcon–
que , & 'lui par conféquent paífe par le zénitb de ce
lien , l'.endroit
oppo~é ~e
la fmface du gl?be que cet–
te vertlcale prolongee Ira couper, en fOlt
l'antipode.
Tout le refre n'eíl: qu'acceífoire a cette idée dans la
fuppoJition énoncée ou tacite de la fphéricíté de la
terre; car ú la terre n'eíl: point une fphere , ú c'eíl:
une fphérolde elliprique, appIan, ou allongé vers les
P?les, il n'y a plus d'
antipod~
réciproques; c'efr-a–
di;c::,
par exemple, qu ayant mené une ligne par le
'Zeru~
de
~~rís
&
par l,e centre de cette ville, 'lui eíl:
da.nsl hemiiphere boreal, cette ligne ira eouper I'hé–
mifphere auil:ralen
lID
poin! qui feral'antipode de Pa-
ANT
ris, mm dont Paris ne fera pas
I'amipode;
ainii l'é–
galité ré.ciproque de,p<?útion, de lati,tude, de ¡om
&
de ntllr dans les hemifpheres oppofes
a
(¡x mois de
différence , & tout ce qu'on a coürume de renferm r
dans l'idée des
antipodes,
comme inféparabh:, ne I'eíl:
plus, & doit elfeilivement en etre Úlplll·é des que
l'on déroge.a la fphéricité de la terreo II ne faut qll'un
peu d'attention ponr s'en convaíncrc.
Tout ceci eíl: tondé fur ce que la fphere , ou, pom
fimplifier cetre théorie , le ccrcle, efr la fewe figure
réguliere que tous les diametres paJfans par fon cen–
tre coupent a angles droits. Done en toute figlu·e ter–
minée par lme aurre combe, dans I'elliple , par
exemple , la perpendiculaire menéei! un de fes points
ou
a!a.
tange!1te, excepté les deLL'\: axes qui répon–
dent lCl
a
la Itgne des poles,
Ol!
a un diamerre quel–
conque de l'équateuf, ne lauroit paífer par fon cen–
tre, ni aller rencontrer la partie oppofée du méridien
elliptiqlle a angles droits : done le nadir de Pari
n'ele pas le zénitb de fon
antÍpode
,
&
récipro'lue–
mentoSi I'on élevoit au milien de Paris LUle colonne
bien perpendicwaire
a
la íurface de la terre, elle ne
feroit pas dans la meme ligne que celle qu'on éleve–
roir, pareillement au point
antipode
de Paris : mais
elle endéclineroit par un angle plus oumoins granel,
teJon que l'eHipfe
011
le méridien ellipri'lue differe–
roit plus ou moins du cercle. La latitude de l'1m &de
l'autre de ces deux points differera donc en meme
raifon ,
&
conieqllemment la
longu~mr
des jOllrS
&
des nuits , des memes faifons,
&c.
Les lieux fttués
a
l'tm & I'autre pole, ou fur
I'é~
quatellr, enfont exceptés; parce que dans le premier
cas , c'eft un des axes de l'ellipfe qni joint les deux
points;
&
que dans le fecond iI s'agit tOlljours d'un
cerel;,
.~Ont
l'autre axe de
l'~llipfe
eft le diametre ;
le fperOlde quelconc¡ue applau on allonoé étant toll–
joms imaginé réfnlter de la révolution°dll méridien
elliptique antour de l'a: edu monde.
Poye{
Hijl.
acod.
¿.74l.
(O)
.
ANTIPTOSE, f. f.
figure de Grarnrnaire
par la-
~
quelle, dit-on, on met un cas ponr un autre, com–
melorfque Virgile dit, J.E.n. V. v. 451
.Jt clamor ccelo
~
au líen de
ad crelltm.
Ce mot vient de
a.'1'Tl ,
pour
&
de
'WTWt;J~
,cas.
On donne encore pour
exempl~
de
eette figure,
Urbem quarn flamo v1tra
ejl
,
J.E.n.
L.
r.
v. 573,
urbem
au lieu de
urbs.
Et 'férence au prolo-
gue de
l'Andrienne
dit:
Populo ucplacerem, quasftci.f
Jet fobltlas,
au lieu de
fobalce.
On trOtlve auili,
renít
in
mentern itlius diei
pour
i!le dies.
Mais Sanétius,
liv.
Jr.
& les Grammairlens plúlofophes, qui
a
la vérité
nc font pas le gr,ílnd nombre, & meme la méthode
de P. R. regardent cette prétendue figure comme
une cbimere & une abfurdité 'llÚ dérruiroit tomes
les regles de la Grammaire. En effet les verbes n'au–
roient plus de régime certain; & les écoliers qu'on
reprendr?ir pour avoir mis un nom
a
un cas, aUtre
que celtu que la. regle demande, n'auroient qu'a ré–
pondre qu'ils om tan lme
antiptoft. Figltra hcec
,
dit
~anétius,
liv. IV. c. xüj.
latinos canones
exceder~
vi.
deUtr
;
nihil imperitius; quod jigmentlll/l
ji
rffu
yemm ,
frrtflra qUt1!rerelllltS 'lrtem cajum yerba regeNlt.
. Nous ne connollfons d'aurres figures de confrmc–
non que celles dont nous parlerons au mor
ONS–
TRUCTION.
Le memefonds de penfée peutfouvent etre énoncé
de différentes manieres: mal
S
chacune de ces manie–
res dpit etre cOllÍorme
a
l'analogie de la langlle. Ainíi
l'on rrouve
urbsRoma
par la rauon de l'idenrité :
Urbs
eíl: alors conúdéré adjeilivement,
R oma 'lrtce 11urbs;
&
l'on rrouve auili
urbs J(omce, in oppido AntlOc!UfE.
Cíc.
Blttroti aJcmdimus urb(m.
Virgo Alors
urbs
el!:
conúdéré comme le nom de I'efpece ; nom 'llÚ efr
enfuite détennine par le nom de I'individu.
Parmi ces di1férentes manieres de parler, ú nous
















