
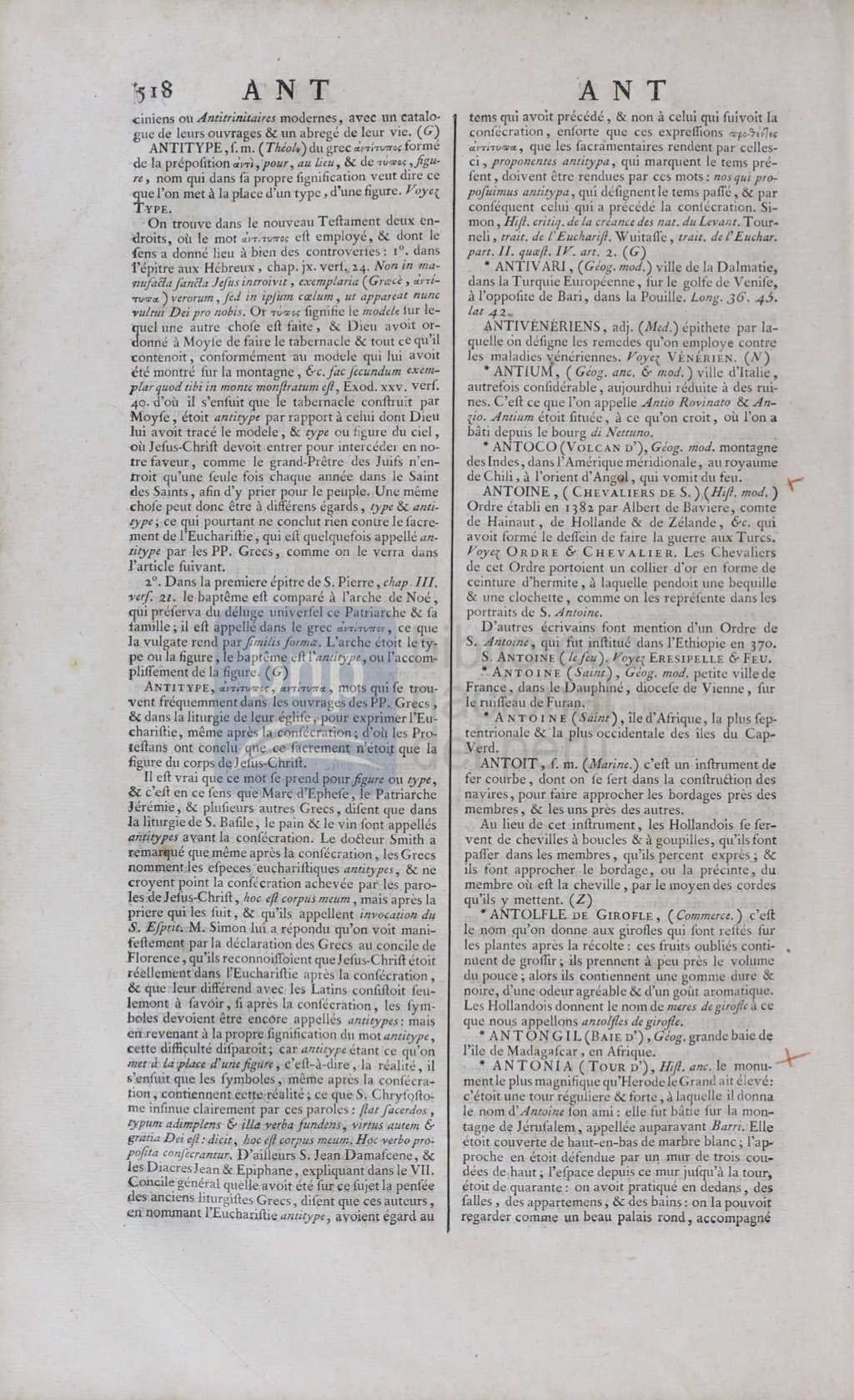
ANT
cinieos ou
Antitrinitaires
modernes, avec
U11
catalo–
gue de leurs ouvrages
&
t,In abregé
de,le~r
vie.
(G~
ANTITYPE
J.
m.
(Théol.)
du grec C<1
'T1TU7TOdor.mede la prépofition dVTl,
pour
,
al/. tieu,
&
de
7J""O~
.'fig u -
re,
nom qui dans fa propre fignificarion veut dire ce
que l'on met a la place d'un 'typc, d'une figure.
Yoye{
T.YPE.
On trOllve dans le nouveau Teftament deux en–
¿roits,
011
le mot
d,.r;",u7To~
ell: employé,
&
dont le
fens a donné lieu
a
bien des controveríes:
1°.
dans
l'épitre aux
Hébrel~x, ch~p.
jx. vere
.24.
Non,in
:"U,,–
'12ufáilafanila Jejits merolvtt
,
(xemplana (G,.a;ee,
«VTl-
7U"""
)
verorom, flJ in ipjinn cadum, !lt appaleat nune
"Vulmi Dei pro nobis.
Or
7J"".~
fignific le
model<
lur le–
quel une autre chofe eft faite,
&
Dieu avolt or–
donné
¡'¡
MoyÚ: de faire le tabcrnacle
&
tout ce
qu'~l
contenoit, conformément atI modele -qui lui aVOlt
été montré fm la montagne ,
&e. fae fleund/lm exe11l–
prarquod tibi in monte monflratum
ejl,
Exod. xxv. verf.
40.
d'oll il s'enfuit que fe tabernacle conftruit par
Moyfe, étoit
antitype
par rapport
¡'¡
celui dont Dieu
ltú
avoit tracé le modele,
&
rype
ou figure du ciel ,
Oll Jefus-Chrift devoit entrer pour intercéder en no–
tre faveur, comme le grand-Pretre des Juifs n'en–
troit qu'une feule fois chaque année dans le Saint
des Saints, afin d'y prier pour le peuple. Une meme
chofe peut done etre
¡'¡
différens égards,
type
&
ami–
D'pe;
ce qui pourtant ne conclut rien contre le facre–
ment de l'Euchariilie, qui eft quclq1.lefois appellé
an–
Litype
par les PP. Grecs, comme on le yerra dans
l'article Cuivant.
2°.
Daos la premiere épitre de S. Pierre,
ehap
ll!.
1'erJ.
21.
le bapteme eft comparé
¡'¡
l'arche de Noé,
qui préferva du délu!7e univerfel ce Patriarche
&
fa
famille; il ell: appelle dans le grec
dl",iw7TOV,
ce que
la v1.llgate rend par
jimilis forma;.
L'arche étoit le ty–
i)e oula figure, le bapteme
eftl'antitype,
oul'accom–
pljJ[ement de la figure.
(G)
ANTITYPE,
';'T:W"'.~,
cLl'.,.!TU7TcL,
mots qui fe trou–
vent fréquemment daos les ouvrages des PP. Grecs,
&
dans la liturgie de leur églife, pour exprimer l'Eu–
chariíl:ie, meme apres la con(écration; d'ollles Pro–
teíl:ans ont condu Cj,lle ce
(acremen~ n'éto~t
que la
figure du corps d¡;Jelus-Chriíl:.
11 eíl: vrai que ce mot (e prend pour
figure
ou
type,
&
c'eft en ce fens CJ1ie Mar<; d'Ephefe,
le
Patriarche
ifér~D1ie.'
&
pluúeurs aurres Grecs, Ment que dans
la
hturgle de S. Balile, le paIn
&
le vin (ont appellés
antitypes
ay.¡¡nt la confécration. Le doél:eur Smith a
Eemarljué
c¡ue.m~me
apres la eon(écration, les Grecs
nom01ent.Ies e(peces euchariíl:ic¡ues
antitypes,
&
ne
croyent poiot la con(ecration achevée par les paro–
les 'deJeflls-Chriíl:,
Izoc efl eorpus mmm,
mais apres la
priere qui les fuit,
&
qu'ils appellent
invoealÍon du
$.
Efprit.
M. Simon lui a répondu ql1'on voir mani–
feíl:emeJ1t par la déclaration des Grecs au concile de
Florence, qu'ils reconnoilroient queJe(l1s-Chrill: étoit
réellemeot'dans l'Euc.harill:ie apres la con(écration
&
qt~e
leu! d1fférend avec les Latins confilloit
fel1~
lemont a (avoir, Ji apres la confécration, les (ym–
boles devoient
~tre
eocore appcllés
antieypes:
mais
eit..reyeoant
a
la propre fignificarion du mot
antitype,
cette djffi¡;ulté difparolt; car
amitype
étant ce qu'on
met d.J.ti.rpket fl'une figtire,
c'eíl:-a-dire , la réalité il
s'.enftútCJ1le les fYJl)boles, meme apres la conféc;a–
tion, comienoent cegeréalité; ce qlle
$.
ChryfQíl:o–
me infinue clairement par ces paroles :
flat faeerdos ,
typum adimplms
&
i!la lIerba fondem, yirtu.s autem &
gracia D ei eJl: dieit, Itoe
efI
¡;orpus meum. Hoe verbopro–
pofta.eonflcrantur.
D'aillel1rs S. JeanDama(cene,
&
les DI.acresJean
&
Epiphane, expliquant dans le VII.
ConciJ~
géné.ral CJ11eUe avoit été [ur
~e
(ujet líI penfée
deS"anclens hrurgiíl:es Grecs, di(ent CJ1le ces al1teurS.
.en
llommant lluchariJhe
amitype,
avoient égard at¡
teros qlli avoit précédé,
&
non
a
celui qui fuivoit la
confécration, enforte que ces expreffions
r.;:p••
'7:1rJ"
dv.,.;"'u""",
que les (acramentaires rendent par celles–
ci,
proponentes antilypa,
qui marquent le tems pré–
[ent, doivent etre rendues par ces mots :
nos 9ui pro–
pofuimus antitypa,
c¡ui déJignent le tems palfé,
&
par
,con(équent cclui qui a précédé la conlécration. Si–
mon ,
Hij!. critiq. de La créallce des nato du Levant.
Tour–
neli,
trait. de L'E/leharifl.
\Vuirall"e,
erail. de L'Euchar.
parto
/l.
qua;fl. IY. arto
2.
(G)
*
ANTIVARI,
(Géog. mod.)
ville de la Dalmatie,
dans la Turquie Européenne, (ur le golfe de Ve11Í(e,
a
l'oppolire de Bari, dans la Pouille.
Long.
36.4.5.
Lal42 .
.ANTIVÉNÉRIENS, adj.
(Med.)
épithete par la–
quelle on défigne les remedes qu'on employe contre
les maladies
,:énérienne~.
Yoye{
VÉNÉRIEN.
(N)
*
ANTIUM,
(Géog. ane.
&
mod.)
ville d'ltalie,
autrefois conlidérable, aujourdhui
1
éduite
11
des rui–
nes. C'eíl: ce que I'on appelle
Antio Rovinato
&
An–
{io. Antium
étoit útuée,
a
ce qu'on croit, Ol! l'on a
bilti depuis le bourg
di Nettuno.
*
ANTOCO (VoLeAN D'),
Géog. modo
montagne
deslndes, dans l'Améric¡ue méridionale, au royaume
de Chili,
a
l'orient d'Angol, qui vomit du feu.
ANTOINE, (CHEVALlERS DE S.)
(Hifl. mod.)
Ordre établi en
1382
par Albert de Baviere, comte
de Hainaut, de Hollande
&
de Zélande,
&c.
qui
avoit formé le delfein de faire la guerre aux Turcs_
I/oye{
ORDRE
&
CHEVALlER. Les Chevalicrs
de cet Ordre portoient un collier d'or en forme de
ceinture d'hermite,
a
laquelle pendoit une bec¡uille
&
une clochette, comme on les repré(ente dans les
portraits de S.
Antoine.
D'aurres écrivains font mention d'un Ordre de
S.
Amoine,
c¡ui fut inilimé dans l'Ethiopie en 370.
S. ANTOINE
(leflu). I/oye{
ERESIPELLE
&
FEU.
*
A
N
TO
1
NE
(Saint)
,
Géog. modo
petite ville de
France, dans le Dauphiné, dioce(e de Vienne, fur
le milfeau de Furan.
*
A
N
T OI NE
(Saim)
,
ile d'Afriqlle, la plus fep–
tentrionale
&
la plus occidentale des iles du Cap–
Verd.
ANTOIT,
f.
m.
(Marine.)
c'eíl: un iníl:rumentde
fer combe, dont on [e [ert dans la coníl:ruél:iofl des
navires, pour faire approcher les bordages pres des
membre~,
&
les uns pres des autres.
Au Jieu de cet inll:mment, les HoUandois (e (er–
vent de chevilles
a
boucles
&
a goupilles, qll'ilsfont
palfer dans les membres, qll'ils percent expres;
&
ils font approcher le bordage, ou la précinte, du
membre Ol! eíl: la cheville, par le moyen des cordes
qu'ils y mettent.
(Z)
*
ANTOLFLE DE GIROFLE,
(Commeree.)
c'ell:
le nom CJ11'on donne aux girofles qui (ont reíl:és (ur
les plantes apres la récolte: ces fruits oubliés conri- •
mlent de groffir; ils prennent
a
peu pres le volume
du pouce ; alors ils contiennent une gomme dure
&
noire, d'une odeur agréable
&
d'un gOLlt aromatique.
Les Hollandois donnent le nom de
meres de girojle
a ce
que nous appeJlQns
antoifles de girojle.
*
AN T O!'f GIL (BAlE D') ,
G¿og.
grande baie de
l'lle de
Madag~(car
, en Afrique.
.--
*
ANTONIA (TOUR D'),
Hifl.
ane.lemonu–
ment le plus magnifique qu'Herode leGrand ait élevé:
c'étoit une tour réguliere
&
forte,
a
lac¡uelle il doona
le nom
d'Antoine
ion ami: elle
fllt
biltie (m la mon–
tagQe de Jémfalem, appellée auparavant
Barri.
Elle
étoit couverte de hatLt-en-bas de marbre blanc; l'ap–
proche en étoit défendue par
UI"!
mur de trois cou–
dées de haut; I'e(pace depuis ce mur jufCJ1l'a la tour,
étoit de quarante: on avoit pratiqué en dedans, des
falles, des appartemens,
&
des bains : on la pouvoit
r~garder
comme un beau palais rond, a"ompagné
















