
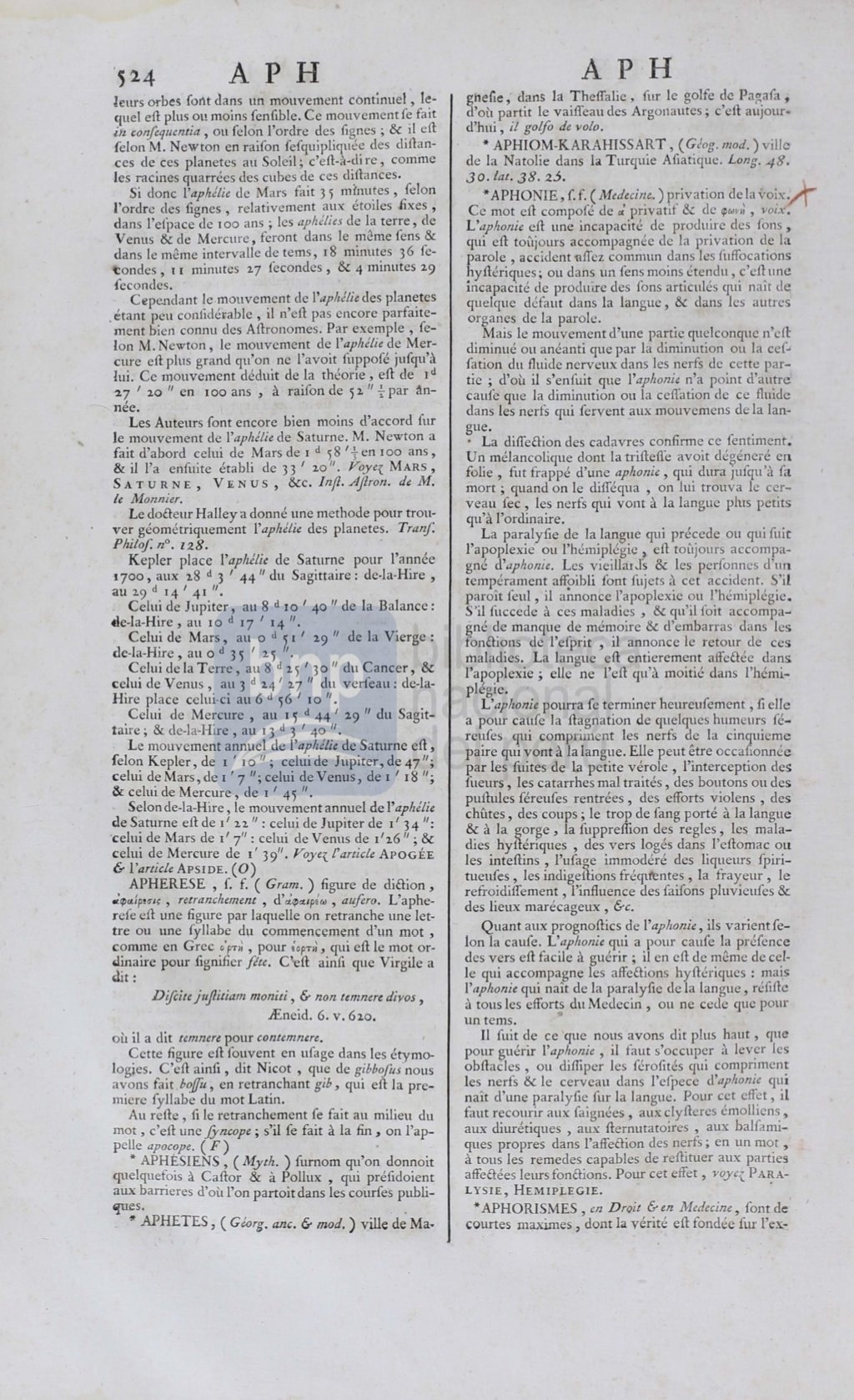
524
A P H
lcurs orbes foltt dans un mouvement continuel ,
l~quel eíl: plus Ol! moins feníible. Ce
mouvementf~
falt
ih
(;olifeqllentia,
ou
felo~
I'ordre
?e~
fig,nes; &
,11
eíl:
{elon M. Newton en ralfon [efqtllphquee des dJíl:an–
ces de ces planetes au Soleil;
c'eíl:-a-~i
re, comme
les racines quarrées des ctlbes d,e ces dl,íl:ances.
Si donc
l'aphélie
de Mars falt
35
m~nu,tes ,
felon
l'ordre des úgnes, relativement
~~IX
etodes fixes,
dans l'e1i)ace de
100
ans ; les
aphd/es
de
~~a
terre, de
Venus & de Mel'Cl1l'e , feront dans le
~eme
fens
&
dans le meme intervalle de tems,
18
m1l1utes
36
fe–
~ondes,
1 I
minutes 27 fecondes, & 4 minutes 29
fecondes.
Cependant le,mouvement de
l'ap!tJlie
des
plan~tes
.étant peu conJidérable , il n'efr pas encore parfalte–
ment bien connu des Aíl:ronomes, Par exemple , [e–
Ion
M.
ewton le mouvement de
I'aphélie
de Mer–
cure eíl: plus
gr~nd
qll:on, ne I'avoit,fuppofé
jll[qu'~
lui. Ce mouvement dedtut de la theone> efr de
1
27
I
20 1/
en
100
ans > a rallon de
52 1/
.¡.
par ftn–
née.
Les Auteurs font encore bien moins d'aecord fur
le mouvement de
l'apMlie
de Saturne, M. Newton a
fait d'abord celui de Mars de
1 d
58 '
f
en
100
ans,
&
il I'a enfuite établi de
33
I
201/.
Voyet
MARS ,
SATURNE, V EN US, &c.
Infl.AJlron. dt M.
le
Monnier.
Le doél:eur Halleya donné une methode pour trou–
ver géométriquement l'
apltélie
des planetes.
Tranj'.
Philoj'. nO.
z28.
Kepler place
I'apltélie
de Satllrne pour I'année
J
700,
aux 28
d
3
I
441/ du Sagittaire: de·la·Hire ,
au 29 d 14
'
41
1/.
Celui de Jupiter, au
8
d 10 ' 40 "
de la Balance:
4le·la-Hire, au
10
d
17 ' 14 ".
Celui de Mars, au o
d
~
1
I
29 1/ de la Vierge :
rle·la-Hire, au o
d
35 ' 25 '.
Celui de la T erre , au
8
d
25'
301/ du Cancer,
&
celui de Venus, au
3
d 24' 27"
du verfeau; de-la–
Hire place celui·ci au
6
d
56
I
10 ".
Celui de Mercure , au
15
d
44' 29 1/ du Sagit–
taire;
&
de-Ia-Hire , au
13 d 3 '
40 ".
Le mouvement annuel de l'
aphélie
de Saturne eíl:,
felon Kepler, de
l' 10";
celuide Jupiter, de
47";
eelui de Mars, de
1 /
7 "; celui de Venus, de
1 '
18
1/;
&
celui de Mercure, de
1
I
45 ".
Selonde-Ia-Hire, le mouvementannuel
del'aplzélie
de Saturne eíl: de
l'
22 1/ ;
celui de Jupiter de
l'
34
1/;
'celui de Mars de
l'
i/;
celui de Venus de
1'26" ;
&
celui de Mercure de
1/3 9'"
Voyet ['anide
ApOGÉE
&
l'anide
ApSIDE.
(O)
,
~PHERESE
,
f.
f. (
Gr~r;z.
)
,figure de
di~ion
>
"'<P'LlP!"I~
,
ruranchement
,
d
a.!fI<
l.IP''''
,
arifero.
L aphe–
refe efr une figure par laquelle on retranche une let–
tre ou une fyllabe du commencement d'un mot >
comme en Grec
o'p'Tll
,
pour
,oP'TI'
>qui eíl: le mot or–
dinaire pour Jignifier
/éte.
Ceíl: ainú qlle Virgile a
dit:
DifCite juJlitiam moníti,
&
non temnere diyos ,
h:neid. 6. v. 620.
011
il a dit
temnere
pour
contemntre.
•
Cette figure eíl: fouvent en ufage dans les étymo–
logies. C'eíl: ainíi , dit Nicot , que de
gibboJlls
nous
avons fait
boj[u,
en retranchant
gib>
qui eíl: la pre–
miere fylIabe du mot Latin.
Au reíl:e , Ji le retranchement fe fait au milieu du
mot, c'eíl: une
hncope ;
s'il fe fait a la fin, on I'ap–
pelle
apo(;ope.
(F)
.. APHÉ.SIENS ,
(Mytlt.
)
furnom qu'on donnoit
quelquefois
a
Caíl:or &
a
Pollux , qui préúdoient
aux barrieres d'ou l'on partoitdans les courfes publi-
'1TI
es .
.
.. APHETES, (
Géor~.
anc.
&
modo
)
ville de Ma.
APH
ghe/ie, dans la !heífalie, fur le golfe
~e
Pag.afa
1
d'on partit le vaJífeau des Argonautes; c efr aUJour.
d'hui,
il golfo de volo.
.. APHIOM-KARAHISSART ,
(GJog,l1lod.
) villc
de la Natolie dans la T urquie Aíiatique.
Long, 48.
30.lat.
38.
,2.5•
..APHONIE >
f.
f.
~ Me~ecin.e.
)
privation de,la vOi,x./f
Ce mot
dI:
compofe de " pnvanf
&
de "''''." ,
YOIX.
L'aphonie
efr une incapacité de
produ~e ~es
fons ,
qui efr tOlljours accompagnée de la pnvanon d,e la
parole , accident alTez commun
?an~
les fuffo;atlOns
hyíléric¡ues; ou dans un fens mOlns etendu , ,e efr une
incapacité de produire des fons articulés 'ltll nalt de
'luel'lue défaut dans la langue, & dans les autres
organes de la parole.
Mais le mouvement d'une partie quclconque n'eíl:
diminué on anéanti que par la diminution ou la
cef~
fation du fluide nerveux dans les nerfs de cette par–
tie ; d'ou il s'enfuit que
I'aphonie
n,'a point d'an!re
cauíe que la diminution on la celTatlOn de ce flmdc
dans les nerfs
e[llÍ
fervent aux mouvemens de la lan-
gue.
,
. La difi'eél:ion des cadavres confirme ce fentlment.
Un mélancolique dont la trillefie avoit dégéne¡-é en
folie , fut frappé d'une
,apllOnie,
qlÚ. dura jufqu'a fa
mort; quand on le diífequa , on
1m
trouva le
c~r
vean fec, les nerfs qui vont a la langne pltlS petlts
qu'a l'ordinaire.
La paralyúe de la langue 'lui précede ou qui fuit
l'apoplexie ou l'hémiplégie ) eíl: tOlljours accompa–
gné
d'aphonie.
Les vieillarSs & les perfonnes d'un
tempérament af(oibli
[o~t
fujets
~
cet
a;c!d~nt., ~'il
parolt feul , il annonce
1
apoplexle ou
J
henuplegle.
S'il fllccede
a
ces maladies , & qu'il foit accompa–
gné de manque de mémoire & d'embarras dans les
tonél:ions de l'efprit , il annonce le retour de ces
maladies. La langue eíl: entierement affeél:ée dans
l'a~oplexie;
elle ne l'eíl: qu'a moitié dans I'hémi–
plegie.
L'
apltonie
pourra fe terminer heureufement , Ji elle
a pour cauCe la ílagnation de quelques
hu~eur~
fé–
reufes
qtú
compri.m nt les nerfs de la cmqmeme
paire qui vont a la langue. Elle peut étre occa{¡onnée
par les fuites de la petite vérole , I'interception des
fueurs, les catarrhes mal traités , des boutons ou des
pufrules féreufes rentrées, des efforts violens , des
chtLtes, des coups ; le trop de fang porté
a
la langue
&
a la gorge, la fuppreffion des regles , les mala–
dies hyilériques , des vers logés dans I'cíl:omac Oll
les intefrins , l'ufaae immodéré des liqueurs fpiri–
nletúes , les indigeftions fréqu'entes , la
fra~eur,
le
re&oidilTement , l'influence des fallons pluvJetúes &
des lieux marécageux ,
&(;.
Quant aux prognofrics de
I'aphonie ,
ils varientfe–
Ion la caufe.
L'apltonie
qui a pour caufe la préfence
des vers efr facile a guérir ; il en eíl: de meme de cel–
le
qtú
accompagne les affeél:ions hyíl:ériques ; mais
l'
flpltonie
qui nalt de la paralyiie de la langue, réíiíl:e
a
tous les effort; du Medecin, Ol! ne cede que pOUl'
un tems.
Il
fuit de ce que nous avons dit plus haut,
(flH':
pour guérir
l'aphonie,
il fam s'occuper
a
lev~r
les
obíl:acIes, ou di{Jiper les férofités 'lui compnment
les nerfs
&
le cerveau dans I'efrece
d'apllOnie
C¡l~i
nalt d'une paralyiie fur la langue. Pour cet
cff~t
, JI
faut recourir aux faignées, aux cIyfreres
émolllen~,
ame diurétiques , aux ílernutatoires , aux balfanu–
c¡ues propres dans l'affeél:ion des
n~rfs;
en un
m~t
,
a tous les remedes capables de reíl:ltuer aux parues
affeél:ées leurs fonél:ions. Pour cet effet ,
voyet
PARA-
LYSIE, HEMIPLEGIE.
.
..APHORISMES
en D roit
&
en.
Medecine ,
font de
COltrtes maximes ,'dont la vérité eíl: fondé fu!' l'e:\:-
















