
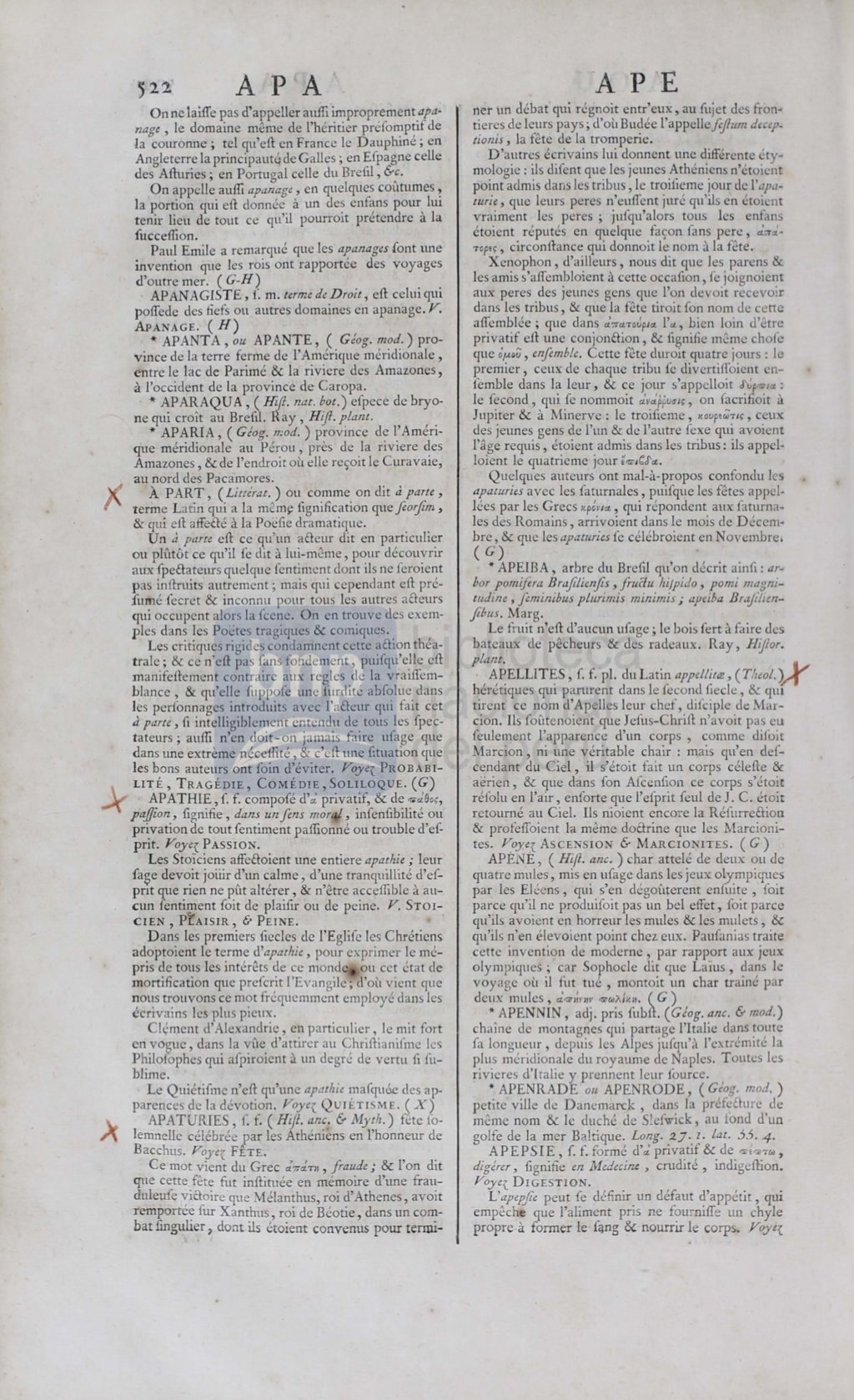
APA
On ne lailre pas d'appeller auRi improprement
apa–
nage
,
le domaine meme de I'héririer préfomptifde
la courorme; tel qu'efr en France le Dauphiné; en
Angleterre la principautó de Calles; en Efpagne celle
des Afruries; en Portugal celle du Breúl ,
&;.
On appelle auffi
apanage
,
en quelques coutumes
!
la porrion qlti efr donnée
a
un des enfans pour IUl
tenir lieu de tout ce qu'il pourroit prétendre
a
la
fucce1Iion.
Paul
Emile a remarqué que les
apanages
[ont une
invention que les rois om rapportée des voyages
d'outre mer.
(G-H)
APANACISTE,
f.
m.
termedeDroit,
efr celuiqui
poJTede des (iefs ou autres domaines en apanage.
V.
AI'ANAGE.
(H)
" APANTA,
ou
APANTE, (
G/og. mod.)
pro–
vince de la terre ferme de l'Amérique méridionale,
entre le lac de Parimé
&
la riviere des Amazones,
a
I'occident de la province de Caropa.
"APARAQUA,
(Hifl. nato bot.)
efpece de bryo–
ne qui crolt au Brefu. Ray,
HijI:. plam.
" APARIA, (
G/og. modo
)
province de l'Améri–
que méridionale au Péroll, pres de la riviere des
Amazones,
&
de I'endroie Olt elle rc¡;:oit le Curavaie,
au nord des Pacamores.
A
PART,
(Littérat.
)
ou comme on dit
ti
parte,
yerme Latin qui a la mem¡: fignification que
fiorjim,
&
Cjlti efr afFeél:é
a
la Poefie dramatique.
Un
ti
pam
efr ce qu'un aél:eur dit en particulier
ou pllltot ce qu'il fe dit
a
hti-meme, pour découvrir
aux fpeél:ateurs quelque fentiment dont ils ne feroient
pas iníl:rllits autrement; mais 'lui cependant efr pré–
fumé fecret
&
inconnu pour tollS les autres aél:eurs
qui occupent alors la fcene. On en trouve des exem–
pIes dans les Poetes tragi'lues
&
comi'lues.
Les critiques rigides condamnent cetre aétion théa–
trale;
&
ce n'efr pas fans fondement, puif'lu'elle efr
manifefrement contraire am( regles de la vraiJTem–
hlance,
&
qu'elle fuppo[e une li¡rdité abfolue dans
les perfonnages introduits avec l'aél:eur qui fait cet
a
parte,
fi intelligiblemem eneendu de tous les fpec–
tateurs; auili n'en doit-on jamais faire ufage que
dans une extreme néceilité,
&
c'eO: une fituation que
les bons auteurs ont foin d'éviter.
Voye{
PROBABI–
LITÉ , TRAGÉDIE, COMÉDIE, SOLILOQUE.
(G)
APATHIE,
f.
f. compofé d'd privatif,
&
de
"kd8o~,
pa./Jion,
fignifie,
dans unfins mor4/.,
infenfibilieé ou
privation de tout fentiment paílionné ou trouble d'ef–
prit.
Yoye{
PASSION.
Les Stolciens afFeél:oient une entiere
apathie;
leur
fage devoit joiür d'un calme , d'une tranquillité d'ef–
pnt que rien ne pih altérer ,
&
n'etre acceílible
a
au–
cun fenti2}em foit de p[aifrr ou de peine.
V.
STOI–
CIEN, PLAISIR,
{;>
PEINE.
Dans les premiers fieeles de l'Eg[ife les Chrétiens
adoptoient le terme
d'apathie,
pour exprimer le mé–
pris de tous les intérees de ce monde ou cet état de
mortification que prefcrit I'Evangile; d'oll vient que
nous trouvons ce mot fréquemment employé dans les
écrivains [es plus pieux.
Clément d'A[exandrie, en particulier, [e mit fort
en vogue, dans [a vne d'attirer au ChriO:ianifme les
Philofophes
qui
afpiroiem
a
un degré de vertu
íi
fu–
blime.
Le Qltiérifme n'efr qu'une
apathit
mafquée des ap–
parences de [a dévotion.
Voye{
QUJÉTISME.
(X)
\. APATURIES ,
f.
f. (
Hifl. anc.
&
Myth.)
fete fo–
A
lemnelle célébrée par les Áthéniens en l'honneur de
Bacchus.
Voyez
FETE.
Ce mot viene du
Crec
d."d.TII ,
fraude;
&
l'on dit
que ceete fete fut inO:imée en mémoire d'une frau–
dllleme vicroire que Mé[amhus, roi d'Athenes, avoie
remporté~
fur Xanthus, roi de Béotie, dans un com–
bar fingulier ) dont
ils
étoient convenus pour termi-
APE
ner un débat qui régnoit entr'eux, au fujet des fron–
tieres de leurs pays; d'Oll Budée l'appeUefllum
de ep_
tionis,
la fete de la tromperie.
D'autres écrivains lui donnent une difFérente •ty·
mologie: ils difem que [es jeunes Aehéniens n'étOient
point admis dans [es tribus, [e troiiieme jour de l'
apll–
turie,
que leurs peres n'eu/fem juré qu'ils en étoicnt
vraiment les peres; jufqu'alors tous les enfans
étoient réputés en quelque
fa~on
fans pere,
d."d–
TOP",
circonO:ance
qui
donnoie le nom
a
[a fete.
Xenophon, d'aillems, nous dir que les parens
&
les amis s'aJTemb[oient
a
cette occafion, fe joignoient
aux peres des jeunes gens que l'on devoit recevoir
dans les tribus,
&
que la fete tiroit fon nom de cene
aJTemb[ée ; que dans
d"'<l.TOÚpla.
l'
<L,
bien
[0111
d'etre
privatif efr une conjoncrion,
&
fignifie
m~me
chofe
que
(,/-,0" ,
enfimble.
Cette fete duroie quatre jours : [e
premier, ceux de chaque tribu fe diverti/foiellt en–
Ü~mble
dans la leur ,
&
ce jour s'appelloie
J'';1''''la.:
le fecond, qui fe nommoit
dvdppU"'~,
on facrifioit
a
J
upiter
&
a Minerve: le troifieme,
KOUP!¿;TI~,
ceux
des jeunes gens de l'un
&
de I'autre fexe qui avoient
l'age requis, étoient admis dans les tribus: ils appe!–
loiem le quaerieme jour ;""lbJ'a..
Quelques auteurs ont mal-a-propos confondu les
apaturíes
avec les fatumales, puifque [es fetes appcl–
lées par les Crecs
"P¿Vla. ,
qui répondem aux [aturna–
les des Romains, arrivoient dans [e mois de Décem–
bre,
&
que les
apacurits
fe célébroient en Novembre.
(
G)
" APEIBA, arbre du Brefu qu'on décrit ainfi:
ar·
bor pomÍjera Brafilienfis, fruflu IúJpido, pomí magni–
llldine
,
flminibus pturimis minimis; a}Jeiba Brafilien–
fib/ls.
Marg.
Le fruit n'efr d'aucun ufage; le bois fere a faire des
bateaux de pecheurs
&
des radeaux. Ray,
HiJior.
planto
APELLITES,
f.
f. pI. du Laein
appelliu¡¡, (Tluol.
~
hérétiques qui pamrent dans le {econd fiede ,
&
qlll
tirem ce nom d'Apelles leur chef, difciple de Mar–
cion. I1s (olItenoient que Jefus-Chri1l: n'avoit pas eu
feu[ement I'apparence d'un corps, comme diroit
Marcion, ni une véritab[e chair : mais qu'en del:"
cendant du Ciel, il s'étoir fait un corps céleO:e
&
a<irien,
&
que dans fon Afcenfion ce corps s'étoit
réio[u en ['air, enforte que l'efprit feul de
J.
C. étoit
retourné au Ciel. I1s nioiem encore [a Réfurreétion
&
proteifoient [a meme dofuine que les Marcioni-
tes.
Voye{
ASCENSJON
&
MARCIONITES.
(G)
APÉI'lÉ,
(Hifl. anc.
)
char attelé de deux ou de
quatre mules, mis en ufage dans les jeux olympiques
par les E[éens, qui s'en dégoitterent enCuite , foit
parce qu'il ne produifoit pas un be! efFet, foie parce
qu'i[s avoient en horrem les mules
&
[es mu[ees,
&
ql.l'i1s n'en é[evoient poim chez. eux. Paufanias traite
cerre invention de moderne, par rapport aux jeux
oIympique ; car Sophocle dir que Lalus, dans le
voyage
011
iI fllt tué , montoit un char trainé par
deux mldes,
d"'~"lIv
",,,,,,Ix,,. (G)
*
APENNIN, adj. pris fubil:.
(Glog. anc.
&
mod.)
chalne de montagnes qui partage l'Italie dans toute
fa longueur , depuis les Alpes jufqu'a ['extrémité la
plus méridiona[e du royaume de Naples. Toutes les
rivieres d'!talie y prennent leur fource.
*
APENRADE
Olt
APENRODE,
(G¿og. modo )
petite ville de Danemarck, dans [a préfcél:ure de
meme nom
&
le duché de Slefwick, au [ond d'un
go[fe de [a mer Ba!rique.
Long.
27·
l.
lal.
.5.5.4-
APEPSIE,
f.
f. formé d'd privatif
&
de
""'''''T''' ,
dig¿rer,
fignifie
en Medecine
,
crudité, indigcO:ion.
Yoye{
DIGESTION.
L'apepfie
peue fe définir un défaut d'appétit, qtü
empeche que l'aliment
pris
ne fOlrrnllfe un chyle
propre
a
former le fi}ng
&
nourrir le corps.
Voye{
















